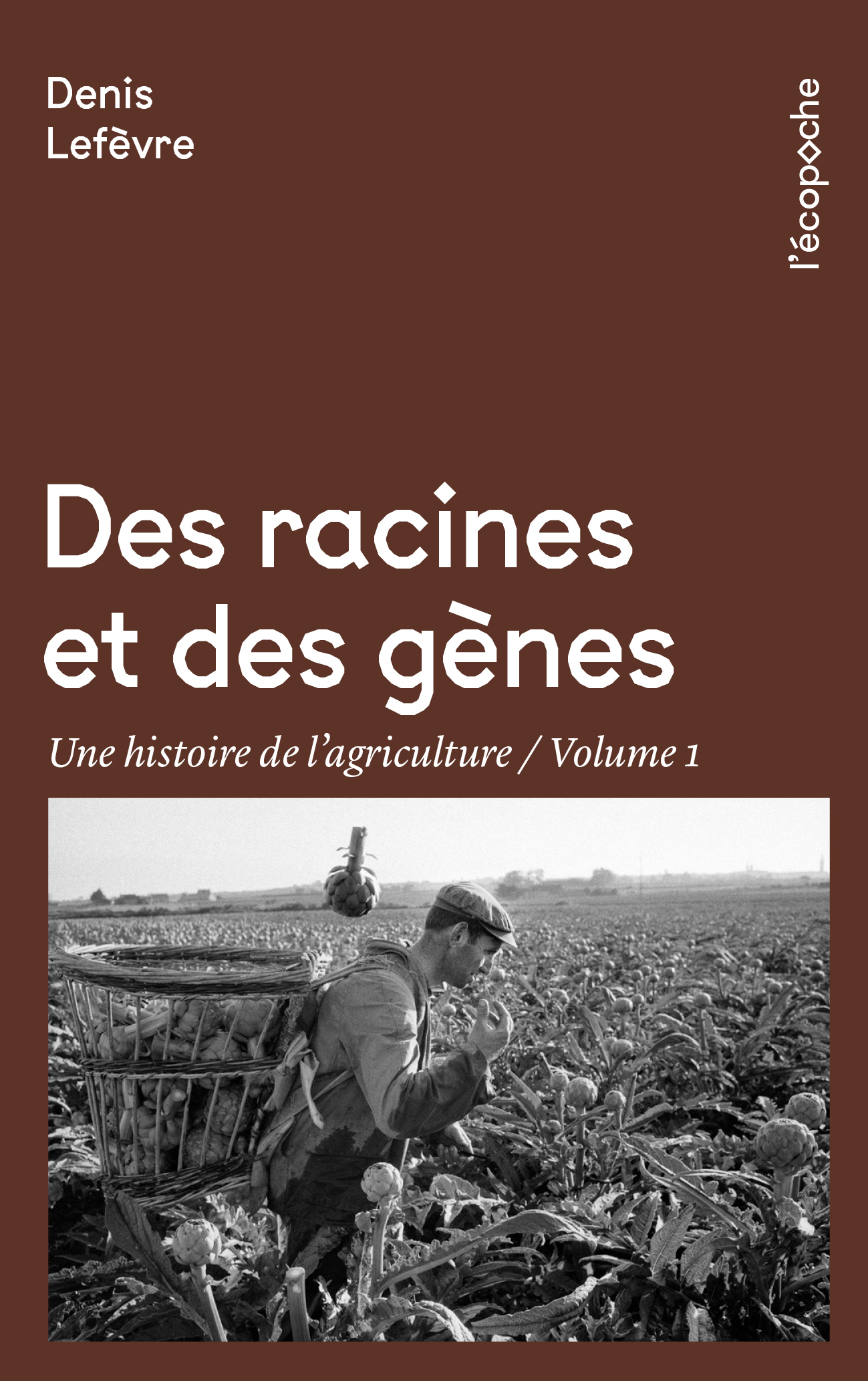Les Billets d’humeur
Giscard et l’Europe
A l’annonce de la mort de Valéry Giscard d’Estaing, la chaîne de télévision Arte a eu la bonne idée de diffuser une émission Réflexions de fin de siècle qui date de 1997, un dialogue passionnant animé par un journaliste de Die Zeit entre l’ancien président français et l’ancien chancelier allemand Helmut Schmidt sur l’évolution des rapports France/Allemagne au cours du prochain siècle.
Un dialogue qui avait un goût de suranné, tant en quelques années, le contexte européen avait bien changé. Giscard et Schmidt, très engagés dans la construction européenne, initiateurs de la monnaie commune à travers la mise en place du Système monétaire européen, et créateurs d’un parlement européen désormais élus au suffrage universel étaient sans doute les derniers hommes d’Etat à penser qu’une Europe fédérale pouvait influencer le monde du XXIème siècle.
On connaît la suite : la chute du mur de Berlin, les élargissements successifs qui vont entraver l’approfondissement de la construction européenne, la succession de crises, la montée en puissance des mouvements souverainistes. Helmut Schmidt estimait que l’on n’a pas assez expliqué que la coopération n’est pas une question affective mais correspond à des intérêts communs concrets tandis que Valéry Giscard d’Estaing pensait que le projet européen était devenu trop compliqué.
Une leçon qu’il ne retiendra pas, lorsqu’il présidera en 2004 la Convention chargée d’élaborer le Traité établissant une Constitution pour l’Europe. Au final, cela donnera un traité illisible de 448 articles, qui ne sera pas ratifié en 2005 par la France et les Pays-Bas, où le non l’a emporté lors des référendums. Toutefois la plupart des dispositions de cette convention seront reprises en 2009, dans le cadre du Traité de Lisbonne. Et l’on sait aujourd’hui les dégâts considérables qu’aura cette décision dans la rupture entre les peuples et l’idée européenne.
Démesure !
Après son décès, Diego Maradona, ce génie du ballon rond à qui l’on excuse tous les excès, ce symbole aussi d’une certaine revanche des pauvres contre les nantis, est devenu plus qu’un dieu du stade, tant la ferveur a atteint une forme de religiosité, que ne connaissent plus les religions monothéistes, du moins en Europe. Au lendemain de sa mort, le journal L’Equipe n’hésitait pas à titrer : « Dieu est mort ».
Démesure encore avec ces envolées boursières, – sur fond de crise économique majeure avec tous les indicateurs macroéconomiques dans le rouge -, qui traduisent cette déconnexion entre la Bourse et l’économie réelle. D’ailleurs, entre 50 et 70 % des opérations boursières sont effectuées par des robots. La semaine dernière, le journaliste François Lenglet, dans sa chronique économique sur RTL, évoquait l’exemple du fabricant californien de voitures électriques, Tesla, qui a vu ses cours boursiers multipliés par six en 2020, avec une capitalisation qui dépasse les 500 milliards dollars, soit 25 fois plus que le groupe Peugeot qui produit pourtant sept fois plus de véhicules et 50 fois plus que Renault. Démesure dans ce rêve (peut-être pas aussi écologique qu’on ne l’espère !) de voitures électriques, source de profits futurs !
Globalement, l’agriculture, en partie parce que, par nature, elle est très liée au monde réel, celui du vivant et des territoires, échappe à cette démesure, malgré ce démantèlement des politiques agricoles qui rend les marchés plus dépendants des soubresauts des cours mondiaux. Et pourtant le premier krach financier concerne une plante originaire de Constantinople, la tulipe, qui connaît, dans les années 1630, un fort engouement aux Pays-Bas. Symbole du luxe, elle fait l’objet de contrats de marché à terme. Les cours s’emballent pour atteindre 6 700 florins le bulbe, soit le prix d’une maison bourgeoise à Amsterdam ou encore 20 fois le salaire annuel d’un ouvrier, engendrant une bulle spéculative irrationnelle qui va exploser en 1637. Le cours du bulbe retombera alors à 50 florins.
Quand le ciel se révolte…
L’ampleur du changement climatique actuel nous amène à penser que la prise de conscience de l’impact des activités humaines sur le climat est un phénomène récent. A tort, pensent deux historiens de l’environnement, Jean-Baptiste Fressoz et Fabien Locher, dans Les Révoltes du ciel – une histoire du changement climatique XVe-XXe siècle. Ils voient l’origine de cette prise de conscience dès le XVe siècle à l’occasion de la colonisation européenne de l’Amérique. Pour les Conquistadors, les excès climatiques du Nouveau Monde seraient dus à l’absence de cultures et de déforestation. Ce qui conforte leur stratégie de peuplement et de développement agricole. La mise en culture, selon eux, tempérait les excès de la météo. Thomas Jefferson écrira que les Etats-Unis, dont il sera le président, sont devenus un pays de cocagne.
Tout change à partir de 1770, sous l’influence de savants, comme Pierre Poivre ou Bernardin de Saint Pierre, qui constatent les effets de la déforestation. L’enjeu est désormais de conserver la forêt pour préserver le climat. L’arbre, de par son impact sur le cycle de l’eau et donc sur la transformation climatique, sera pendant plus d’un siècle au cœur des controverses scientifiques, des débats politiques et des enjeux économiques.
« L’idée d’un agir humain sur le climat est très répandue parmi les élites françaises », constatent les auteurs qui nous font découvrir cette enquête lancée en 1821 par le gouvernement français sur la responsabilité de l’Homme dans le changement climatique. Après 1850, la révolution industrielle changera la donne : les progrès dans l’agriculture, le développement des transports, la fin des crises frumentaires, mais aussi la croyance en la toute-puissance de la technologie pour dompter la nature, font que « le climat a été délogé de nos consciences ». Une sorte d’interlude, d’un peu plus d’un siècle, avant que, par un effet boomerang, la question climatique ne réapparaisse, sous la forme de l’excès de CO2 et de l’effet de serre, nous faisant redécouvrir notre fragilité face aux révoltes du ciel.
Les Révoltes du Ciel – Le Seuil – 303 pages – 23
L’actualité de la Règle de saint Benoît !
Il y a une vingtaine d’années, enquêtant sur les CUMA pour un livre, j’avais été impressionné par le souci de certains responsables qui n’hésitaient pas à organiser pour leurs adhérents des formations à la gestion des conflits. De même, je me souvenais de cette conversation avec l’un des fondateurs d’un GAEC laitier dans l’Yonne qui avait imposé des règles strictes comme l’obligation pour chaque adhérent de payer le lait qu’il se procurait pour sa consommation familiale.
Je me remémorais ces conversations en lisant, il y a quelques jours, l’enquête de La Croix-L’Hebdo, titré : Management : Et si on s’inspirait des moines ? En effet des entreprises font aujourd’hui appel à l’expertise de moines et s’inspirent de la Règle de saint Benoît, fondateur de la tradition monastique occidentale. Cela peut surprendre qu’une Règle si exigeante et stricte qui, depuis plus de 15 siècles, organise pour chaque génération la vie de milliers de moines à travers le monde, suscite l’intérêt de chefs d’entreprises. Mais après tout, certaines congrégations ont fait leur preuve en matière de « management », comme les Bénédictins puis les Cisterciens qui avaient tellement réussi, notamment en gérant d’immenses domaines agricoles au Moyen-Age, qu’ils en avaient négligé le vœu de pauvreté.
Paradoxalement la Règle de saint Benoît répond au moins partiellement à quelques questionnements en ces temps de confinement, comme le télétravail, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises ou la gouvernance très horizontale des start-ups. Et puis face à la sophistication des modèles de management, il y a sans doute ce souci d’en revenir à des règles simples et pleines de bons sens, comme réfléchir au sens du travail parmi d’autres activités, valoriser l’écoute mutuelle et le silence pour bien décider, adopter la mesure pour résoudre les conflits et éviter les maladresses, et l’humilité pour valoriser ses erreurs et ses échecs… Toutes règles qui inspiraient ces responsables de CUMA, rencontrés il y a vingt ans.
La faim, la Covid-19 et nous
Compte rendu de l’intervention commune de
Valentin Brochard, Martin Willaume et Denis Lefèvre,
lors de l’assemblée régionale Hauts de France le 3-10-2020 Trois parties: état des lieux /impact Covid/ et ici?
Assemblée Régionale du CCFD-Terre Solidaire des « Hauts de France »
Samedi 3 octobre 2020
-
La faim dans le monde : un état des lieux
Intervention à deux voix :
Valentin Brochard, chargé de plaidoyer souveraineté alimentaire au CCFD-TS
Martin Willaume, chargé de mission Pays Andins pour le CCFD-TS
(Animation : Michel Bardoz)
Valentin Brochard : aspects et causes d’une situation dégradée
La faim repart à la hausse depuis cinq ans : 700 millions de personnes dans le monde (soit 9 % de la population) souffrent de sous-alimentation chronique. note 1
L’Asie reste la région où l’on trouve le plus grand nombre de personnes sous-alimentées, devant l’Afrique, l’Amérique Latine et les Caraïbes. Mais en pourcentage, c’est l’Afrique qui est la région la plus touchée (19% de sa population), et la situation continue de s’y aggraver, surtout en Afrique de l’Est.
Le récent rapport annuel des agences onusiennes sur « L’état de la sécurité alimentaire dans le monde »note2 introduit un nouvel indicateur, qui élargit la perspective et saisit plus finement les évolutions en cours. Il permet de mesurer l’insécurité alimentaire, à différents niveaux de gravité.note3 Une insécurité alimentaire modérée est déjà préoccupante : pour ceux qui en pâtissent, l’accès à la nourriture est incertain ; quand ils peuvent manger, ils consomment souvent les aliments les plus facilement disponibles ou les moins chers, qui ne sont pas forcément les plus nutritifs et les plus sains.
Deux milliards de personnes (un quart de la population mondiale) souffrent d’insécurité alimentaire, modérée ou grave, principalement dans les pays à faible revenu. Toutefois ce problème d’accès régulier à une nourriture suffisante, saine et nutritive existe aussi dans les pays du Nord à revenu moyen élevé, y compris 9% de la population en Europe et en Amérique du Nord.
Cette situation a des causes multiples: la multiplication des conflits, l’impact des dérèglements climatiques, mais aussi l’incapacité de nos systèmes agro-alimentaires mondiaux à nourrir convenablement la planète. Ces systèmes contribueraient plutôt à aggraver la situation par leurs impacts économiques, sociaux, écologiques, et la piètre qualité nutritionnelle des produits obtenus.
A vrai dire, la faim est aujourd’hui moins un problème de production –elle pourrait suffire à la tâche- qu’un problème de répartition, de pauvreté et de justice sociale. On sait bien que les victimes de la faim sont d’abord des ruraux, particulièrement de petits agriculteurs, des femmes et des enfants.
On observe aussi dans les pays latino-américains une relation entre : la dépendance des marchés internationaux et l’insécurité alimentaire…Au moins 3 milliards de personnes en ce monde ne peuvent pas se permettre une alimentation saine de façon durable ; c’est le cas de plus de la moitié de la population africaine. Or, le rapport onusien indique qu’une telle alimentation coûte bien plus de 1,90 dollar américain par jour (seuil de pauvreté international) ; le prix d’une alimentation saine, même la moins chère, est cinq fois plus élevé que celui à payer pour se remplir l’estomac de seuls féculents.
C’est d’un véritable changement de paradigme que nous avons besoin. La promotion de l’agro-écologie en est l’une des facettes.
Echos des pays andins, par Martin Willaume
La situation latino américaine n’est pas la pire qui soit – si l’on considère son insertion correcte dans les circuits internationaux et ses statistiques globales- Mais on y relève des tendances inquiétantes, notamment en Bolivie (15% de population sous-alimentée, contre 7% au Pérou), ou au Venezuela qui connaît une crise très forte qui rejaillit sur les pays voisins (un million et demi de Vénézuéliens sont réfugiés en Colombie, vulnérables face à la faim).
En outre, les inégalités sont parfois très fortes au sein d’un même pays. Ainsi, le « miracle minier »note4 et les indicateurs économiques globaux positifs du Pérou cachent de grandes disparités entre le littoral, la zone andine et le versant amazonien. Les régions rurales reculées sont plus exposées aux risques. La moitié des péruviens vivent sous le seuil de pauvreté.
L’insertion du Pérou dans le commerce international menace la sécurité et la souveraineté alimentaires du pays en modifiant les rapports au marché et les habitudes alimentaires. Le boom international du quinoa conduit les communautés paysannes à exporter une partie de leur production, au détriment de la consommation locale. Les pâtes et le riz importés progressent aux dépens des produits locaux traditionnels. La production des pommes de terre se concentre sur quelques espèces, les plus rentables à l’export, aux dépens d’autres espèces natives, nutritives mais délaissées. Le Pérou importe les surgelés nécessaires à ses fast-foods…
Le soutien au modèle d’agriculture familiale et paysanne s’impose. C’est l’une des tâches majeures des partenaires andins du CCFD-TS, tels que CIPCA (Bolivie), ou l’IMCA (Instituto Mayor Campesino, Colombie), et des partenaires engagés dans le programme de « Transition pour une Agro écologie Paysanne au service de la Souveraineté Alimentaire » (TAPSA).note5
C’est une tâche multiforme, qui au-delà des aspects proprement agricoles (diversification des cultures et des techniques, agroforesterie, …) intègre des aspects culturels et sociaux (reconnaissance du droit des femmes, droits des indigènes) et des actions de plaidoyers (obtenir des politiques publiques favorables).
*****
Note 1 : La sous-alimentation chronique désigne l’insuffisance durable de la ration calorique quotidienne. On retrouve le chiffre plus connu de 820 millions personnes « souffrant de la faim » si l’on prend aussi en compte les formes de malnutrition (mauvais état nutritionnel et carences dues à une alimentation mal adaptée ou mal équilibrée).
Le pourcentage global de personnes sous-alimentées (la prévalence mondiale de la sous-nutrition) évolue peu : il se situe plus ou moins autour de 9 pour cent. Ce sont les chiffres en valeurs absolus (les effectifs) qui augmentent depuis 2014 ; ce qui veut dire que la faim a augmenté au même rythme que la population mondiale.
Note 2 : le rapport dit « SOFI » est co-rédigé par cinq organismes spécialisés de l’ONU : la FAO (Organisation pour l’alimentation et l’agriculture), le FID (Fonds international de développement agricole), le PAM (Programme alimentaire mondial, prix Nobel de la Paix 2020), l’UNICEF (Fonds pour l’enfance) et l’OMS (Organisation mondiale de la santé). Le rapport souligne chaque année davantage la probable perspective d’un échec de la communauté internationale dans la poursuite de l’objectif « faim zéro » en 2030. La course contre la malnutrition est aussi mal engagée : entre un quart et un tiers des enfants de moins de cinq ans souffrent d’un retard de croissance ou d’émaciation. Les organismes onusiens invitent donc à des « actions plus audacieuses » et plus globales (tout au long de la filière alimentaire, et dans l’économie politique qui façonne le la dépense publique, l’investissement, et l’activité commerciale)
Note 3 : Une personne est en situation d’insécurité alimentaire «lorsqu’elle n’a pas un accès régulier à suffisamment d’aliments sains et nutritifs pour une vie saine et active ou une croissance ou un développement normal » (définition de la FAO). L’insécurité peut être due à l’indisponibilité de la nourriture ou au manque de ressources pour se la procurer.
Elle peut être ressentie à divers niveaux de gravité que la FAO mesure à l’aide d’une échelle de « l’insécurité alimentaire vécue » (FIES, Food Insecurity Experience Scale) :
-insécurité légère : apparition d’une incertitude sur la capacité de se procurer la nourriture) ;
-insécurité modérée (1): la qualité et la diversité de l’alimentation sont compromises ;
-insécurité (2) : réduction des quantités et repas sautés ;
-insécurité grave : privation d’alimentation pour un jour ou plus
Note 4: Cette thématique de l’exploitation minière, des conflits et dégâts qu’elle provoque est bien documentée :
https://ccfd-terresolidaire.org/nos-publications/fdm/2015/290-novembre-decembre/perou-la-mine-5290
Note 5: on en saura plus sur les partenaires andins du CCFD-TS en se reportant au site internet national :
https://ccfd-terresolidaire.org/projets/ameriques/bolivie/en-bolivie-l-5300
présentation de CIPCA, partenaire bolivien, janvier 2016
https://ccfd-terresolidaire.org/nos-combats/6-histoires-6-combats/l-histoire-de-seferino-6713
l’histoire de Seferino, paysan bolivien passé à l’agroforesterie » septembre 2020
interview de E.I.D. Pabon, directeur de l’IMCA (Instituto Mayor Campesino) mis en ligne en janvier-février 2020
Le programme TAPSA, déployé sur quatre ans (2018-2022) a pris la suite du programme Paies ; il implique des partenaires de cinq régions du monde, dont des pays andins ; voir :
2. Les impacts de la pandémie de COVID-19
Intervention à deux voix: Valentin Brochard, chargé de plaidoyer souveraineté alimentaire au CCFD-TS et Martin Willaume, chargé de mission Pays Andins pour le CCFD-TS
(Animation : Michel Bardoz).
Une crise alimentaire durable (Valentin Brochard)
La pandémie de covid-19 a déclenché une crise alimentaire dont l’impact ne s’arrêtera pas avec la fin de la crise sanitaire, ne serait-ce qu’en raison de la profonde déstructuration de certaines filières. Elle agit comme un accélérateur : d’après les estimations de l’ONU, 132 millions de personnes supplémentaires souffriront de sous- alimentation d’ici la fin 2020, et 900 millions de plus connaitrons l’insécurité alimentaire (y compris des européens)note 6.
Le confinement général, la fermeture des frontières et des marchés (à diverses échelles) ont écorné les chaînes d’approvisionnement et de valeur (production non-alimentaire comprise d’ailleurs, comme le dit l’exemple des fleurs au Kenya), et singulièrement compliqué l’accès à une alimentation saine et diversifiée.
La crise est une crise de l’accès à l’alimentation. Accès physique en premier lieu, en raison d’atteintes aux circuits (production-consommation), des récoltes laissées sur pied et difficultés d’écoulement (les producteurs de pommes de terre du Fouta Djalon , en Guinée, en ont fait l’amère expérience) jusqu’à la fermeture de toute sorte de centres de distribution (par exemple la fermeture des cantines)
Crise de l’accès monétaire, aussi, en raison des pertes de revenus des travailleurs du secteur agricole ou du secteur informel. Les plus vulnérables sont comme toujours les populations les plus pauvres ou celles qui survivent grâce à un travail précaire.
Suivent dans un second temps, un certain nombre d’«impacts différés ». Notamment la volatilité des prix sur les marchés internationaux (flambée des céréales) et nationaux (au Mexique le prix du maïs est multiplié par trois), qui creuse les différences entre villes et campagnes. Conjuguée avec la baisse générale du pouvoir d’achat (donc la diminution des moyens consacrés à l’alimentation des ménages), elle installe durablement les populations modestes dans l’incertitude. Le repli sur quelques aliments bon marché qui s’ensuit pèse sur la qualité et la diversité de l’alimentation.
Beaucoup dépend et dépendra de la réponse des états et de l’attention qu’ils portent aux plus vulnérables : les pauvres des villes et des campagnes, les travailleurs du secteur informel, les femmes et les migrants. Cette attention est comme on sait très variable d’un pays à l’autre.
La crise révèle en les intensifiant les vulnérabilités et les insuffisances des systèmes alimentaires mondiaux, finalement peu résilients face à des chocs inattendus, et peu durables. Les pays les plus touchés sont souvent les plus dépendants des marchés internationaux pour leurs exportations et importations alimentaires. La pandémie devrait donc conduire à repenser nos systèmes internationalisés.
La crise suppose encore une réponse internationale à la hauteur de la situation, qui tarde à venir et que plusieurs ONG appellent de leurs vœux. Réaction internationale cohérente et coordonnée, qui implique notamment que le Comité de Sécurité Alimentaire mondiale (CSA) joue pleinement son rôle.
Des pays andins fortement touchés (Martin Willaume)
Les pays andins sont très touchés par l’épidémie et la crise qui s’ensuit. Le Pérou par exemple enregistre une mortalité due au covid élevée, la plus forte au sein de ce groupe de pays.note 6b
La tension entre deux nécessités -se protéger, et travailler – est très forte dans un pays où la majorité des emplois relève du secteur informel (sans couverture sociale, ni conditions de travail normalisées): les travailleurs, contraints de travailler, sortent en toutes circonstances. Les mesures prises par les autorités sont en partie inadaptées, en porte-à-faux par rapport aux réalités vécues par la population. Une partie d’entre elle ne comprend pas l’importance de la distance sociale, du lavage répété des mains, et du port du masque. Les mesures fortes (couvre-feu et état d’urgence), n’ont pas été totalement respectées ni efficaces.
Dès le printemps sont apparues des situations d’insécurité alimentaire, qui touchaient par exemple les enfants qui n’étaient plus scolarisés ou certains quartiers confinés (Pérou, Colombie…) Les associations partenaires du CCFD-TS se sont donc consacrées à la distribution de repas, pour secourir des familles qui ne pouvaient plus travailler et ne recevaient aucune aide financière.
Travail d’urgence, pour ces partenaires qui en temps normal travaillent sur la durée longue et accompagnent patiemment la transformation sociale et le cheminement vers l’autonomie. Mais aussi confirmation pour ces associations travaillant déjà sur la coopération et les logiques solidaires des solutions agro-écologiques, qui pour le coup ont montré toute leur pertinence. Cela dit, la crise est aussi une « bonne occasion » pour d’autres acteurs, porteurs de ‘solutions’ productivistes ; la Bolivie vient ainsi en mai de mettre fin au moratoire sur les OGM. pour les cultures du blé, du maïs, du soja et du coton.
La solidarité doit s’exprimer aussi à l’égard des femmes, qui portent pleinement le poids de la crise, à la ville comme à la campagne. Elles affrontent la situation d’urgence quand tout manque, et le souci de l’éducation des enfants qui ne sont plus scolarisés. Certaines sont privées de leur emploi (ouvrières agricoles, vendeuses sur les marchés, travailleuses du secteur informel). A la campagne, leur charge de travail s’en trouve plutôt accrue –tâches domestiques et travail agricole conjugués– Enfin, les violences de genre se sont multipliées.
*****
Note 6 : voir sur ce point :
https://ccfd-terresolidaire.org/nos-combats/souverainete/crise-alimentaire/le-virus-affame-6736
note 6b : Le Pérou (33 Mn habitants) connaît une crise sanitaire majeure ; en nombre de personnes touchées c’est le pays le plus atteint après le Brésil, et son taux de décès dû au covid était en septembre 2020 de 87 pour 100 000 (plus que le Brésil, le Mexique ou les Etats-Unis). Ici se conjuguent les déficiences du système sanitaire et hospitalier, la précarité économique et une incontournable promiscuité : « Comment se protéger dans un pays où près de 70% de la population travaille dans le secteur informel ? » interrogeait en avril un article sur le site national :
https://ccfd-terresolidaire.org/actualites/covid-19/perou-amazonie-la-crise-6593
(cet article comporte une brève présentation de partenaire Manthoc, association d’éducation populaire, partenaire du CCFD-TS)
3. Et ici ..? Quelques aperçus de l’intervention de Denis Lefèvre
(extraits de l’interview conduite par Jean Wambergue )
Denis Lefèvre est journaliste et écrivain, spécialiste du monde rural et agricole. Son dernier livre s’intitule: «Des racines et des gênes : une histoire mondiale de l’agriculture », 2018, Editions Rue de l’Echiquiernote7
Les constats qui précèdent nous invitent à nous interroger sur nos modes de production et de consommation, à mieux cerner les enjeux éducatifs et la couleur de notre action « ici ».
En grippant les échanges commerciaux, l’épidémie de Covid-19 a aussi révélé quelques –unes de nos dépendances et remis en lumière certaines réalités nationales…
Les villes françaises loin de « l’autosuffisance » :
En 2017 le degré d’autosuffisance des 100 premières aires urbaines françaises est en moyenne de 2% Autant dire que la part du local dans le total des produits alimentaires intégrés dans l’alimentation urbaine reste marginale. En moyenne, 98% de la consommation alimentaire de ces aires est donc « importé ». Situation paradoxale puisque dans le même temps 97 % de ce qui est produit dans un rayon de 80-100 km autour de ces agglomérations est « exporté » !
Cette autosuffisance varie selon les aires urbaines. Avignon vient en tête avec 8%, suivie par un petit groupe de villes situé autour de 6-6,5 %, comprenant notamment Valence, Nantes, Angers, Saint- Brieuc. Certaines aires présentent d’ailleurs un bon niveau d’autonomie pour certains produits : les fruits et légumes à Avignon (30%), les volailles et les œufs à Saint-Brieuc, les produits laitiers à Rennes. A l’extrême opposé, les aires de Thionville, Forbach, Compiègne et Creil, sont en queue de peloton avec des taux inférieurs à 0.2% note 8
En moyenne, les habitants des aires urbaines consomment tout juste chaque année 15,50 euros par tête de produits locaux. On retrouve ici les contrastes régionaux : c’est davantage pour Avignon où 55 euros reviennent aux producteurs locaux, mais c’est moins d’un euro pour les villes mal classées.
L’essentiel de la production agricole des aires urbaines est en fait incorporé dans des produits alimentaires consommés hors de leur territoire.
Au bout du compte, l’autonomie alimentaire des aires urbaines est souvent très réduite, même pour de très grandes villes ; Paris par exemple dispose seulement de trois ou quatre jours de réserve.
L’amélioration de la situation peut emprunter plusieurs voies…
Repenser la distribution
Cela peut se faire en développant les « supermarchés paysans », « coopératifs », ou « 100% local », et par le soutien à la vente en « circuit court ».
Les AMAP (association pour le maintien d’une agriculture paysanne) sont désormais bien connues. Le premier exemple de dispositif de ce genre est apparu au Japon, suite à un scandale sanitaire; des mères de famille ont établi dès 1965 les premières « coopérations » pour disposer de produits alimentaires obtenus sans produits chimiques et exempts de mercure. En France, la création des Amap se fait en 2001, en réaction contre la « malbouffe ». On en compte aujourd’hui environ 3000, qui concernent 7000 producteurs et touchent 70 000 familles. Cela correspondrait à 15% de leur consommation alimentaire.
S’y ajoutent d’autres acteurs et modalités : des « entreprises » (comme les marchés forains, les tournées, les réseaux comme ‘la ruche qui dit oui’), ou ceux qui naissent ‘d’initiatives citoyennes’ (coopératives, cantines scolaires…).
L’idée est bien de nature économique : il s’agit de conjuguer un schéma de distribution direct (=le moins possible d’intermédiaires) et la proximité géographique pour le bénéfice commun des producteurs et des consommateurs. Mais on vise aussi à favoriser la transparence et l’équité des échanges, le lien social, et la préservation de l’environnement.
Les produits commercialisés sont encore majoritairement issus d’une agriculture traditionnelle. Local n’est pas nécessairement synonyme de ‘bio’. La part du bio représente 6% des achats alimentaires français. Mais il progresse vite dans les esprits et dans les comportements, comme dans la production ; l’agriculture bio en France concerne 9.5% des exploitants et occupe désormais 8% des superficies agricoles.
L’écho grandissant de « l’agriculture urbaine »
Pour améliorer l’autonomie alimentaire on peut aussi chercher à rapprocher la production agricole locale de la demande des consommateurs résidents. Une première façon de faire consisterait à réorienter l’agriculture locale environnante. Le potentiel agricole local pourrait être réorienté vers la consommation locale, ou modifié pour mieux coller aux besoins locaux. Le potentiel des cent premières aires urbaines pourrait ainsi couvrir plus de la moitié (en valeur) des besoins agricoles incorporés dans la consommation alimentaire.
La promotion d’une « agriculture urbaine » est une autre piste, tout à fait dans l’air du temps.
Pour diminuer la dépendance alimentaire des villes entreprennent ou envisagent de produire sur leur territoire une partie de leur alimentation, via la création de jardins maraîchers, de vergers, de petits élevages, ou autres « fermes urbaines ». C’est aussi l’une des solutions proposée par la FAO pour répondre aux besoins de la sécurité alimentaire dans villes de pays à faible revenu.
Il existe des précédents : les activités agricoles ont toujours existé en ville ou à proximité. Mais les expériences et projets contemporains s’inscrivent dans une perspective de reconquête territoriale, ouvertement « localiste», soucieuse de réduire la consommation d’énergie et les émissions de gaz carbonique, ou de recycler les déchets organiques.note 9 Ces « initiatives de transition », lancées par divers acteurs –municipalités, groupes de citoyens, associations…-, revêtent en outre une vocation pédagogique et une dimension sociale (favoriser les rencontres et les échanges).
Les lieux où se déploie cette agriculture urbaine sont en partie originaux : outre les potagers partagés, on sollicite les cours, les toits, et on verra bientôt des formes nouvelles « d’agriculture verticale ». Les projets urbains doivent il est vrai surmonter quelques obstacles particuliers, tels que la faible disponibilité et le coût du foncier, l’accès à l’eau, la pollution.
Le gaspillage alimentaire: un autre enjeu majeur
environnemental, éthique et éducatif
Dix millions de tonnes: c’est le poids estimé du gaspillage alimentaire annuel en France. Cela équivaut à peu près à 6 milliards de repas, quand les ‘Restos du Cœur’ en distribuent 140 à 150 millions ! Nous jetons 20 à 30 kg d’aliments par personne et par an, dont 7 kg encore emballés; un gâchis estimé à 108 euros par personne et par an.note10
Ce gaspillage déconcertant s’effectue à toutes les étapes du circuit, de la production (un tiers du total) à la consommation (un autre tiers, restauration comprise) en passant par la transformation (21%) et la distribution (14%). Tous ces secteurs sont concernés, pour des raisons différentes: surproduction, récoltes laissées sur pied, calibrage strict et critères « esthétiques », rupture de la chaîne de froid, mauvaise gestion des stocks …
Le gaspillage alimentaire est en réalité mondial, et coûte très cher : l’ONU estime qu’un tiers de la production agricole mondiale est gaspillée. Ce gaspillage pourrait pourtant être en bonne partie évité… et le monde pourrait envisager de manger à sa faim.
[Compte rendu établi par G. Jovenet, à partir de ses notes]
*****
Note 7 : Denis Lefèvre est issu du monde rural (Aisne) et s’intéresse particulièrement à son évolution. Il a écrit bon nombre d’articles et d’ouvrages. Sa synthèse récente, copieuse et très lisible – « Des racines et des gênes » – se déploie en deux tomes : 1. Du Néolithique à la deuxième guerre mondiale » et 2. « La période contemporaine » (éditions Rue de l’échiquier, 2018), qui existent au format poche. D. Lefèvre s’est aussi beaucoup intéressé à Emmaüs (à son fondateur comme à son action) et engagé dans la vie associative.
Note 8 : Une soixantaine d’aires urbaines présentent des valeurs inférieures à la moyenne générale de 2%. C’est en Bretagne et dans les Pays de Loire qu’on trouve le plus grand nombre d’aires urbaines présentant des taux d’autosuffisance élevés. C’est dans le Grand Est et les Hauts de France qu’on recense la plupart des aires les moins autosuffisantes. Lille (3.16 %), Saint Omer (2.76), Béthune (2.17) devancent Boulogne, Dunkerque ou Arras (entre 1,5 et 1,9 %) en meilleure posture que Valenciennes, Calais ou Lens (moins de 1%).
Note 9 : Plusieurs villes comme Rennes ou Albi se sont récemment lancées dans un projet « d’autosuffisance alimentaire » qui s’inscrit dans un ensemble d’enjeux de « résilience » territoriale : sécuriser les approvisionnements, diminuer la dépendance, améliorer la qualité et la traçabilité des produits, réduire l’empreinte carbone
Note 10 : Sur ce thème du gaspillage, Denis Lefèvre a fait référence à l’ADEME, agence de la transition écologique www.ademe.fr , « çà suffit le gâchis » (12 octobre 2020).
Signalons aussi le CeRDD, centre de ressource du développement durable (groupement d’intérêt public) qu’on retrouvera sur www. cerdd.org , et l’association France nature environnement www.fne.asso.fr qui proposent une documentation claire sur le sujet.
La culture du pain, le terroir de l’esprit
Ce 16 octobre est à la fois journée mondiale de lutte contre la faim et journée internationale du pain. Cette concomitance, le fait du hasard ou pas ? Toujours est-il qu’on ne peut que constater, comme l’historien Fernand Braudel, « combien la trinité blé, farine, pain remplit l’histoire de l’Europe ». Pendant des siècles, les terres cultivées étaient appelées « terres à pain » et les céréales ont joué un rôle central dans l’alimentation des peuples, représentant jusqu’à plus de 80 % des dépenses. C’était la nourriture la moins chère mais les rendements céréaliers demeuraient faibles : cinq grains récoltés pour un grain en terre, jusqu’au XVIIIème siècle (contre 45 à 50 grains aujourd’hui), les bonnes années. Les mauvaises, c’était cet engrenage tyrannique : mauvaises conditions climatiques, récoltes en baisse, spéculation, cherté, disettes, voire famines, avec parfois les émeutes, comme la guerre des farines qui mettra à mal la politique libérale de Turgot.
Tout change à partir du XIXème siècle et surtout dès le milieu du XXème siècle, où l’on ne gagne plus son pain, mais son bifteck. La consommation de pain chute : 900 grammes par jour et par personne en 1900, 225 grammes en 1960 et 90 grammes aujourd’hui. Alors ringard le pain en ces temps d’Internet, de smartphone et de malbouffe ? s’interroge l’historien américain Steven L. Kaplan, amoureux de la France et du pain… français (il lui a consacré une vingtaine d’ouvrages), et qui a fait sienne cette phrase du dramaturge Jean Anouilh : « J’aime la réalité, elle a le goût du pain ». Dans son dernier livre Pour le pain (1), il s’inquiète du goût « qui fout le camp même dans ce pays qui se targue d’être la Mecque de l’art de vivre » et en appelle à l’esprit de résistance face à cette détérioration de la culture du pain qu’il appelle « terroir de l’esprit ». Car au-delà de la consommation de pain, c’est toute une culture qui, du champ de céréales au fournil en passant par le moulin, est remise en cause. D’où ce vibrant appel à renouer avec la qualité (comme a su le faire le monde du vin) et à reprendre le chemin des boulangeries…
- Pour le Pain – Steven L.Kaplan – Fayard – 2020 – 22 €
Perte de repères
Octobre est là, comme par mégarde. Dixième mois de l’année mais qui doit son nom, comme les quatre derniers mois de l’année de notre calendrier grégorien, au calendrier romain qui ne comptait que dix mois ; octobre étant avant le XVIème siècle le huitième mois. L’on s’y perd déjà, d’autant que cette année, le Tour de France vient de se terminer tandis que débute le tournoi de Roland Garros. Oui, nous sommes en octobre ! Les vendanges sont terminées depuis des semaines. Les prés et les pelouses sont ocres, comme après une canicule. Les champs moissonnés demeurent couleur terre, pas une touche de repousse verdâtre. Même chose pour ceux ensemencés dès la fin de la moisson, le colza ne lève pas. Et même les champs de betteraves sont jaunes, non du fait de la sécheresse mais par ce puceron qui leur donne la jaunisse. Depuis le début du confinement, il a fait chaud, très chaud, sec, très sec, même dans ces régions que l’on dit tempérées des plaines des Hauts de France. Bref le temps qu’il fait n’est plus vraiment en phase avec le temps qui passe. A y perdre ses repères.
Le week-end dernier, comme un retour au rythme des saisons, nous sommes passés sans transition des fortes chaleurs de juillet à des températures dignes de novembre. La neige a même fait son apparition sur les massifs alpins et pyrénéens à plus de 1 500 mètres d’altitude.
Autre perte de repères : nos gouvernements dépensent à tout va, et c’est tant mieux pour nous éviter un naufrage économique et social, mais, il y a quelques mois, le désendettement était la priorité des politiques économiques et financières. Quid du futur ! Et la Covid 19 qui n’arrange rien, avec ces experts en épidémiologie ou ces spécialistes des maladies infectieuses qui s’écharpent sur les plateaux de télévision, et ces journalistes qui en rajoutent dans le registre « Monsieur Je sais tout », tandis que nos politiques semblent démunis dans la gestion de l’imprévisible, en un temps où il leur faut communiquer dans l’immédiateté. A défaut de repères, osons reconnaître notre droit à l’ignorance !
Jobs à la con…
Pour beaucoup de citadins contraints au confinement dans des espaces réduits, le bonheur est désormais au jardin, avec ce rêve de changer de lieu de vie et de redonner sens à sa vie. Ce phénomène n’est pas nouveau, mais il prend de l’ampleur, du moins dans les intentions. Deux publications récentes, le trimestriel Zadig qui titre en couverture Changer de vie et le magazine Village avec un dossier leur nouvelle vie à la campagne témoignent de nombreux exemples de réussites d’une conversion (non sans difficultés le plus souvent). On y croise un ex-gendarme devenu chevrier, une ingénieure reconvertie en boulangère bio, une calligraphiste recyclée en bergère, un directeur de la communication qui a choisi la restauration… Trait commun de ces changements de cap : redonner du sens à son travail, quitte à y perdre (parfois beaucoup !) en termes de revenu.
C’est vrai qu’entre parcellisation et complexité des tâches, on s’y perd. Il suffit de lire certaines définitions de carrière, au verbiage truffé d’anglicismes et de concepts fumeux, à se demander ce que ces métiers (notamment dans les secteurs du marketing, du management ou de la finance) recouvrent véritablement. Des sondages réalisés, il y a quelques années, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni montraient que 37 à 40 % des personnes interrogées reconnaissaient que la disparition de leur emploi n’aurait aucune incidence. L’anthropologue et économiste américain, David Graeber, décédé ces derniers jours, avait théorisé ce malaise dans Bullshit Job, titre de son livre paru en France et que l’on peut traduire par « boulots à la con », dans lequel il estimait que la technologie avait créé des emplois inutiles, superficiels et vides de sens. Bien avant la pandémie, ce contempteur du capitalisme, auteur également d’un magistral ouvrage Dette : 5000 ans d’histoire, avait montré ce paradoxe que plus un travail est utile à la société, moins il est rémunéré, et que les premiers de corvée étaient plus essentiels que les premiers de cordée…
Effacer l’historique
Je ne suis pas adepte du cyberachat, mais lorsque l’on vit à la campagne, acheter en ligne peut parfois vous faciliter la vie, évitant notamment de longs déplacements… Le cyberacheteur que j’étais, pour l’occasion, était loin d’imaginer les désagréments qui l’attendaient. Mon colis devait être livré le 3 août via Chronopost, entre 8 et 13 heures. Ce jour-là, j’étais chez moi, attentif et je n’ai rien vu. Même scénario les jours suivants. Débute alors ce parcours du combattant, avec ces nombreux coups de téléphone, marqués par de longs délais d’attente, (jamais moins d’un quart d’heure), ce message récurrent : « Votre communication vous sera facturée 15 centimes d’euros la minute », les mêmes questions et toujours la même réponse : « L’on vous rappelle ». Bien évidemment l’on ne vous rappelle jamais. Un mois plus tard, aux dernières nouvelles, il serait aux objets perdus avant d’être renvoyé à l’expéditeur…
Le plus exaspérant dans cette mésaventure, c’est cette impression de se trouver face à un mur, avec au bout du fil des interlocuteurs dont on peut se demander s’ils ne sont pas des robots. Chaque appel vous met de mauvaise humeur pour la journée, vous donne des aigreurs d’estomac, vous mine le moral… Certes l’on peut se consoler à lire la longue litanie de récits de clients mécontents (et parfois violents), victimes de colis abîmés, retardés, disparus…
Alors pour décompresser par l’humour, je suis allé voir le film de Benoît Delépine et Gustave Kervern, Effacer l’historique. Une satire décapante, grinçante et hilarante, qui traite par l’absurde ce monde de l’intelligence artificielle à travers les déboires d’un trio de personnages (joués par Blanche Gardin, Corinne Masiero et Denis Podalydès), tous trois gilets jaunes qui se sont rencontrés sur un rond-point d’un bourg des Hauts-de-France. Victimes des nouvelles technologies, ils décident de partir en guerre contre les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft)… Un film touchant d’humanité, dans un monde, celui des algorithmes, qui en manque singulièrement !
Territoires contrastés
C’est le retour des territoires, du moins au sommet de l’Etat. Dans son discours de politique générale, Jean Castex a cité à 25 reprises le mot. Les territoires font aussi l’objet de nombreuses publications parfois contradictoires. Dans le genre pessimiste, Pierre Bonte, le célèbre animateur dans les années 1960 de l’émission Bonjour Monsieur le Maire, et la journaliste Céline Blampain publient un cri d’alarme, Ces villages qu’on assassine (Editions Le passeur), n’hésitant pas à comparer l’état de la France rurale à la situation des vieillards en soins palliatifs. Sous un angle beaucoup plus optimiste, Vincent Grimault, journaliste à Alternatives économiques, explore, dans La Renaissance des campagnes (Le Seuil), de nombreux territoires innovants.
Force est de constater que les campagnes sont diverses et contrastées. Evitons les représentations caricaturales, et l’amalgame, comme dans un registre plus urbain, entre Neuilly-sur-Seine et Aubervilliers, pense Benoît Coquard, sociologue à l’INRAE, qui s’est penché sur cette France périphérique du Grand Est, région dont il est originaire, avec ses vastes forêts, ses grandes plaines et ses villages qui se dépeuplent et s’appauvrissent. Dans Ceux qui restent (La Découverte), il analyse ce groupe social mal connu qui n’a pas forcément choisi de rester. Cette population, qui se juge sans histoire, vote massivement Rassemblement national et sait cultiver une sociabilité intense, mais se sent loin de tout.
L’isolement est aussi au centre des témoignages recueillis par Salomé Berlioux et Erkki Maillard, dans Les Invisibles de la République (Ed. Robert Laffont). Le livre témoigne des difficultés de cette jeunesse des régions rurales et des petites villes, qui, éloignée des grands centres urbains, se retrouve souvent « assignée à résidence », par peur d’aller à la ville, de ne pas avoir les codes, de n’être pas à la hauteur, aussi parce qu’elle n’a pas toujours les moyens financiers! Les auteurs, qui ont créé l’association Chemins d’avenirs qui accompagne des milliers de filles et garçons issus des zones isolées, n’hésitent pas à parler de sacrifice de la jeunesse de la France périphérique. Une situation qui met à mal l’égalité des chances et la cohésion sociale.
Sursaut de l’Europe ?
Avec ces longues journées et nuits de tractations, entre tensions et suspensions de séances, éclats de voix et coups de bluff, pour aboutir à un compromis de dernière minute, quand l’Europe se retrouve au pied du mur, le récent Conseil européen n’échappe pas à cette dramaturgie bruxelloise. Car la construction européenne, de la chaise vide du général de Gaulle aux demandes de rabais de Madame Thatcher, s’est toujours faite dans la douleur. Voilà pour la forme. En ce qui concerne le fond, après des décennies d’alignement sur les théories libérales, l’accord, obtenu la semaine dernière et porté par un axe franco-allemand retrouvé, marque un changement de taille. La Covid 19 est passée par là, avec ce changement de pied de l’Allemagne, hier intransigeante avec la Grèce, aujourd’hui acceptant une mutualisation de la dette et un emprunt de 750 milliards d’euros, dont la moitié sera reversée sous forme de subventions aux pays qui ont le plus souffert de la pandémie. Ce qui va se traduire par plus de solidarité au sein de l’Union, après des années de chacun pour soi. Un retour aux sources, lorsque les Pères de l’Europe mettaient en bonne place au fronton des institutions communautaires la solidarité.
Certes il a fallu rogner sur les dépenses, la PAC et les politiques de cohésion territoriale connaîtront une érosion tandis la défense, la sécurité et la santé ne disposeront pas les fonds escomptés. Certes les divergences demeurent et les égoïsmes nationaux n’ont pas disparu, comme en témoigne l’attitude des « Frugaux », Pays-Bas en tête, avec la Suède, le Danemark, l’Autriche et la Finlande, qui, menace de véto en main, ont obtenu de nouveaux rabais dans leur contribution au budget de l’Europe. Mais le rapport de force a changé. Le Royaume Uni a quitté le navire européen, tandis que l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et l’Irlande, conscients des risques de désintégration, ont choisi plus d’intégration rejoignant la position de la France et des pays du Sud. Un signe positif, en ces temps de pandémie qui aurait pu nous mener au repli sur soi…
L’ours, les brebis et la délation
Cela fait penser au Far West, et à ces affiches d’appels à la délation contre récompense, placardées dans les bureaux des shérifs et popularisées par les westerns. Tandis que le 9 juin, en Ariège, un ours est retrouvé abattu, une ONG, Sea Shepherd, décidait d’offrir une récompense de 10 000 €, portée depuis à 30 000 €, à quiconque donnerait des informations pour faire avancer les investigations. Fondée par un écologiste canadien, Paul Watson, qui avait quitté Greenpeace, dont il avait été l’un des fondateurs, parce qu’il jugeait son action trop passive, l’association Sea Shepherd, spécialisée dans la sauvegarde des océans, est coutumière d’opérations coups de poing, très médiatiques. Ses méthodes sont contestées même au sein d’autres organisations écologistes.
Cet épisode n’apaisera pas les relations déjà difficiles et complexes entre défenseurs du pastoralisme (éleveurs et bergers) et promoteurs du plantigrade. Relations qui n’ont cessé de se dégrader depuis les années 1990, lorsque l’Etat a engagé un programme de sauvetage de l’ours brun des Pyrénées, avec l’introduction de plantigrades venus de Slovénie. Aujourd’hui les Pyrénées accueillent une cinquantaine d’ours mais, en 2019, les éleveurs ont été indemnisés pour la perte d’un millier de brebis. Si bien qu’une rallonge de 500 000 € a dû être allouée à la cohabitation entre pastoralisme et ours.
Depuis trois décennies, deux légitimités « écologiques » s’opposent. D’un côté, celle d’une nature, vue souvent par des urbains, et qui laisse une place grandissante à la faune sauvage. De l’autre, celle du pastoralisme qui a inventé, depuis des millénaires, une relation originale entre les hommes, les animaux et la nature, rendant la montagne si attrayante. En effet, quoi de plus écologique que ces pâturages extensifs, ces estives et ces parcours, qui valorisent les ressources fourragères de ces vastes espaces naturels ! L’écologie n’est pas toujours là où elle est le plus vigoureusement revendiquée.
De Gaulle et le monde agricole
L’appel du 18 juin fête ses 80 ans, en cette « année De Gaulle » qui commémore également les 130 ans de la naissance du chef de la France libre et le 50ème anniversaire de son décès. Le fondateur de la Cinquième République qui avait une tendresse pour « ce pays des villages immuables, des églises anciennes, des familles solides, de l’éternel retour des labours, des semailles et des moissons », aura été l’un des plus réformateurs de l’agriculture française. Si son arrivée au pouvoir satisfait plutôt les agriculteurs, très vite les relations s’enveniment après la décision de désindexer les prix agricoles. La France gaullienne s’engage alors dans une modernisation de son agriculture, qui rompt avec la vision agrarienne du personnel politique (toutes tendances confondues) de la Troisième et de la Quatrième République, avec le vote des lois d’orientation de 1960 et 1962 et la mise en place de la PAC qui devaient permettre à l’agriculture « d’épouser son temps ». Pour cela, le pouvoir gaulliste s’appuiera sur les jeunes agriculteurs, cette « génération Debatisse », qui allie un fond d’humanisme, hérité de sa formation à la JAC (Jeunesse Agricole Catholique), et une vision productiviste de l’agriculture.
Par contre les relations ne sont pas bonnes voire exécrables avec bon nombre de responsables de la FNSEA et des Chambres d’agriculture, qui avaient fait leurs classes à la Corporation paysanne sous Vichy. Pro-américains, ils n’ont jamais accepté que le général de Gaulle nomme en 1944 un socialiste, François Tanguy-Prigent, rue de Varenne. Lors des élections présidentielles de 1965, le vote des agriculteurs ne sera pas étranger à la mise en ballotage du général de Gaulle, puisque seules 38 % des voix paysannes se porteront au premier tour sur le fondateur de la France libre.
Après le départ du général de Gaulle du pouvoir en 1969, le vote paysan sera largement acquis aux partis se réclamant du gaullisme. Au cours de la seconde moitié du XXème siècle, le monde agricole aura été plus pompidolien puis chiraquien que gaulliste, tant sa relation avec le général pourrait se résumer par cette formule : « Je t’aime moi non plus ».
Les mots de la pandémie
Chaque crise engendre sa cohorte d’expressions, de mots, de comportements, de symboles… Ainsi le masque est passé de son rôle de déguisement à un geste de barrière sanitaire. On a découvert les clusters, (qui signifie foyers de contamination en la circonstance, mais qui a bien d’autres sens), le pangolin et l’hydroxychloroquine du professeur Raoult. Les coronavirus n’ont plus de secret pour nous et l’on voit même des journalistes des chaînes d’information continue faire la leçon (médicale !) à certains mandarins. Chacun d’entre nous maîtrise désormais parfaitement les concepts de comorbidité et de létalité, dans le domaine médical, et de chaîne de valeurs, dans celui de l’économie mondialisée.
Côté social, les premiers de corvée ont pris la place des premiers de cordée. Côté nature (celle-ci a pris ses aises pendant les deux mois de confinement), les faisans n’ont même plus peur des voitures, après le déconfinement. On a changé nos comportements. Le télétravail sort de la marginalité, et les circuits courts sont en expansion. Quant au monde d’après, chacun a sa petite idée, entre espérance en un monde meilleur et retour au monde ancien, entre ceux qui privilégient la priorité à la lutte contre les inégalités, au réalisme économique ou à la transition écologique. A moins que ce ne soit les trois en même temps !
On a pu se réjouir des réflexions de certains intellectuels, comme Edgar Morin, qui comparait ce moment à « un voyage d’humanité dans un festival d’incertitudes », beaucoup moins de ce propos de Donald Trump proposant l’injection d’eau de javel pour tuer le virus. Certaines expressions se sont imposées comme « Prenez soin de vous ! », qui clôt désormais toutes nos conversations. D’autres sont moins appropriées comme distanciation sociale (au lieu de physique !). Qui, dans les hautes sphères de l’Etat, a pu inventer une telle formule ô combien méprisante ? « Mal nommer les choses, jugeait Albert Camus, c’est ajouter au malheur du monde. » Comme quoi les mots peuvent se transformer en maux !
Des villes si peu nourricières
Le confinement a modifié nos habitudes de consommation alimentaire. En amont, les producteurs ont dû s’adapter à la fermeture des restaurants et des marchés locaux, en innovant notamment dans la vente directe ou le « drive ». A l’autre bout de la chaîne, les consommateurs ont prisé les circuits courts, qui jusqu’alors ne représentaient que 15 % de l’approvisionnement. Cette situation perdurera-t-elle ? Ce n’est pas gagné. Mais au moment où pourrait s’instaurer fort opportunément un débat autour de la question de la souveraineté alimentaire, il n’est pas inutile de la considérer à un niveau plus local.
En 2017, une société de conseil, Utopies, avait calculé le degré d’autonomie alimentaire des cent plus grandes aires urbaines françaises. Les résultats furent édifiants avec une autonomie alimentaire moyenne de… 2 %. Ce qui signifie que 98 % de la production agricole et alimentaire locale (produite dans un périmètre jusqu’à 50 voire 100 kilomètres autour de ces villes) étaient exportés hors de ce périmètre. Dans le même temps, 98 % de l’approvisionnement alimentaire de ces villes étaient importés. Avec toutefois des disparités : si Avignon, Valence, Nantes ou Angers se situent à plus de 5 %, Thionville, Compiègne, Creil ou Forbach se placent en deçà de 0,2 %. Autre chiffre édifiant, la dépense agricole locale (c’est-à-dire l’argent qui revient aux producteurs locaux) est en moyenne de 15,50 € par an et par habitant de ces villes !
Une reconquête même partielle de l’ordre de 10 à 15 % de la production locale (il serait inconcevable d’être totalement autonome !) permettrait de limiter les flux de transports, et donc l’empreinte carbone, mais aussi de créer des emplois localement et de sécuriser une chaîne d’approvisionnement qui a montré ses failles avec le Covid-19. Paris ne dispose que de trois à quatre jours de réserves et les produits agricoles et alimentaires qui y sont consommés font en moyenne 600 kilomètres. Une situation plus que problématique en cas de crises, qu’elles soient pandémiques, climatiques, énergétiques ou sociales comme une grève des transports !
Le modèle allemand
C’était quelques jours avant que le Covid-19 ne nous frappe de plein fouet. Une amie allemande me disait, en plaisantant : « Vous, Français, vous n’aimez pas trop votre président ; nous, Allemands, nous aimons moins notre chancelière, au pouvoir depuis 15 an. Alors échangeons nos dirigeants ! ». Aujourd’hui, cette amie ne propose plus cet échange extravagant… La crise pandémique est passée par là, avec outre-Rhin quatre fois moins de décès qu’en France. Certes l’Allemagne a peut-être eu un peu plus de chance dès le début de l’épidémie, le virus touchant plutôt des gens jeunes, avec donc moins de risque de létalité. Mais, par la suite, à défaut de gérer l’imprévu, elle a tout fait pour l’éviter, avec une meilleure anticipation, grâce à un dépistage précoce et massif, et un système hospitalier mieux équipé. Si bien que 80 % des Allemands se disent aujourd’hui satisfaits de l’action de la chancelière. Deux fois plus que le président français victime de rétropédalage dans la communication gouvernementale. Question de style aussi ! Pendant que notre président tenait un discours martial, Angela Merkel s’exprimait sans effet de manche, se voulant à la fois pragmatique, rassurante et prudente.
Reconnaissons toutefois qu’il est plus simple de gouverner ce peuple allemand, que l’on dit discipliné, plutôt que ces « gaulois réfractaires au changement ». L’Allemagne, sur le mode fédéral, repose sur une culture du consensus avec un dialogue social riche, tandis que la France centralisatrice, malade de sa bureaucratie tatillonne, affectionne la confrontation. Le modèle allemand, que l’on disait mal en point, paraît mieux doté pour gérer la crise à venir et jouer un rôle central en Europe. La chancelière, encore au pouvoir pour 16 mois, et présidente de l’UE à partir du 1er juillet, saura-t-elle convaincre son opinion publique et ses voisins du Nord pour insuffler plus de solidarité (notamment en mutualisant la dette) soulageant ces pays du Sud, ces pays du « club-med », qui soit dit en passant font marcher l’industrie allemande ? Il y va de la survie de l’Union européenne !
Controverses scientifiques
Le débat autour de la chloroquine, comme éventuelle solution pour faire baisser la charge virale du Covid 19, qui divise la communauté médicale entre partisans et détracteurs du professeur Didier Raoult, n’est pas une nouveauté. Du procès de Galilée au débat sur la mémoire de l’eau de Jacques Benveniste, l’histoire des sciences est truffée de controverses. L’origine des espèces de Charles Darwin avait en son temps suscité bien des critiques. Gregor Mendel avait découvert les lois de l’hérédité dans l’indifférence générale. Louis Pasteur n’était pas considéré par le monde médical parce qu’il n’était pas médecin. Le grand botaniste russe Vavilov est mort de faim dans les geôles staliniennes parce qu’il s’était opposé aux théories agronomiques farfelues de Lyssenko.
Les exemples abondent, témoignant souvent des duels d’égo, comme ces rivalités passionnelles entre Lamarck et Cuvier sur la transmission héréditaire des caractères, Pasteur et Pouchet sur la génération spontanée, Buffon et Linné à propos de la classification des plantes… Les débuts de la médecine vétérinaire en France furent marqués par l’opposition entre deux fortes personnalités, Claude Bourgelat, un avocat qui créera les premières écoles vétérinaires, et Etienne Lafosse, qui appartient à l’élite des maréchaux ferrants. Ces derniers tiennent alors le haut du pavé en matière de médecine vétérinaire. Mais les projets de Lafosse seront systématiquement contrecarrés par Bourgelat qui dispose de nombreux appuis.
Récemment Arte a diffusé un documentaire « Pasteur – Koch, un duel de géants dans le monde des microbes » (1) qui témoigne de la rivalité féroce entre les deux savants, sur fond de nationalisme exacerbé après la guerre de 1870. Le Français découvrira le vaccin contre la rage, l’Allemand identifiera la bactérie de la tuberculose et tous deux révolutionneront la médecine. Ce n’est que peu avant la mort de Pasteur qu’ils se rapprocheront, chacun exprimant à l’autre son estime. L’on aimerait que les débats actuels entre médecins se terminent ainsi !
(1) Le documentaire s’est inspiré du livre d’Annick Perrot et Maxime Schwartz : Pasteur-Koch, un duel de géants – Odile Jacob – 2014.
Redécouvrir l’essentiel !
La planète vit au ralenti et la population mondiale est en grande partie confinée. Les cieux sont vides d’avions et les artères des cités vides de monde. Le printemps est silencieux tandis que les économies sont en panne et sous perfusion. Si l’e-commerce et le télétravail vont sans doute sortir renforcés de cette crise, constatons toutefois combien les activités traditionnelles et vitales, la santé bien évidemment à travers cette pandémie, mais aussi l’agriculture, le transport, le commerce nous sont indispensables pour nous soigner et avoir accès à la nourriture. Pourtant ces métiers modestes mais de grande dignité sont globalement peu considérés à l’aune du revenu qu’ils procurent, qu’il s’agisse des paysans et des salariés agricoles, des routiers et des livreurs, des caissières de supermarchés, des éboueurs…, et bien sûr des infirmières et des aides-soignantes, toutes et tous chevilles ouvrières dans la fourniture des biens et services vitaux d’une économie en panne, qui nous invite à faire la part des choses entre l’essentiel et le futile. Les derniers de cordée sont ainsi devenus les premiers, renversant brutalement cette hiérarchie macronienne dont on découvre aujourd’hui la cécité et l’imposture.
Depuis des décennies, nos sociétés se sont complexifiées, au point que les services qui entourent les produits de base se sont accaparés la plus grande part de la valeur ajoutée. Ainsi dans l’alimentaire, les investissements immatériels, comme la publicité, la finance, le marketing…, sont, depuis 1989, supérieurs aux investissements matériels, au point de marginaliser la valeur du produit de base (la matière première agricole) au bénéfice de nouveaux services que la société valorise beaucoup mieux avec des métiers bien plus rémunérés. Depuis des années, cette évolution n’a pas cessé de s’accélérer. L’économie moderne très axée sur les services (il y a 70 ans, pour un actif dans l’agriculture, on avait un actif dans l’industrie et un troisième dans les services ; aujourd’hui pour un actif dans l’agriculture, on a 22 actifs dans les services) a marginalisé les producteurs de biens et services vitaux, tout comme elle a négligé les biens communs essentiels : l’air, l’eau, la biodiversité… Que le drame que nous vivons aujourd’hui nous aide à en prendre conscience !
Fragilités
Ce dont témoigne cette pandémie, c’est de notre fragilité, de nos fragilités. Fragilités que l’on semblait oublier dans nos sociétés technologiquement sophistiquées, rêvant parfois de transhumanisme et d’immortalité et exprimant un fort sentiment de solidité comme pour masquer une vulnérabilité grandissante. Or nous redécouvrons que nous, humains, sommes mortels et, ô combien, fragiles et que, nous, civilisations, sommes aussi mortelles. Car le coronavirus met en évidence toutes nos fragilités collectives : fragilité d’un monde éclaté qui ne semble plus croire aux vertus du multilatéralisme ; fragilité de l’Europe, épicentre de l’épidémie, mais inexistante ; fragilité de la planète devant les enjeux environnementaux ; fragilité de l’économie financière mondiale, avec la plongée des places boursières. Plus concrètement nous avons pris conscience de la fragilité de nos circuits logistiques, quand, à force de délocalisations industrielles et de gestion en flux tendus, on en vient à constater que notre approvisionnement en principes actifs médicamenteux dépend à 80 % de la Chine et de l’Inde. Nous semblons aussi découvrir la fragilité de nos systèmes de santé marqués depuis plus d’une décennie par une gestion comptable des hôpitaux et, depuis bien plus longtemps encore, par un manque flagrant de reconnaissance à l’égard des personnels soignants. Le tout sur fond de fragilité de nos idéologies, où le tout marché remet régulièrement en cause l’action des Etats. Il nous faut ces temps de crise pour nous rendre compte de l’importance de l’Etat dans la régulation de certains secteurs producteurs de services ou de biens vitaux comme la santé, mais aussi l’agriculture, le logement, l’éducation, la recherche, la culture… Enfin, il y a cette dernière fragilité qui nous fait dire qu’après une crise de cette ampleur, plus rien ne sera comme avant, alors qu’une fois la crise passée, nous avons tendance oubliant les leçons à retourner vers nos vieux démons. Cette fois-ci, saurons-nous en tirer les conséquences ? Et réapprendrons-nous à prendre conscience de nos fragilités pour mieux s’en enrichir et les vivre ?
Tanguy Prigent, le ministre paysan
Il est aujourd’hui tombé dans l’oubli et pourtant François Tanguy Prigent, décédé il y a 50 ans, fut le premier paysan authentique à avoir été nommé ministre de l’Agriculture. Il a sans doute été l’un des plus réformateurs avec Georges Monnet sous le Front populaire et Edgard Pisani au début des années 1960. En 1944, le général de Gaulle choisit ce petit paysan breton, né en 1909, titulaire du seul certificat d’études (mais premier de son canton), militant socialiste engagé très jeune en politique, au point qu’en 1934 il est élu conseiller général de Lanmeur, mais son élection est invalidée car il n’a pas 25 ans. En 1936, il est élu député. Benjamin de l’Assemblée nationale, il soutient Georges Monnet. En 1940, il fait partie des 80 députés qui refusent les pleins pouvoirs à Pétain, avant de coordonner les réseaux de résistance rurale dans les 19 départements de l’Ouest. Son courage séduit le général de Gaulle qui le nomme rue de Varenne, dans un contexte de pénuries et de marché noir, au point qu’il doit rétablir la carte du pain. Ce qui lui vaut ce surnom de Tanguy Prive Gens. Mais ce sobriquet ne saurait faire oublier la forte inspiration sociale de son action durant trois années passées rue de Varenne, lui qui voulait « abolir l’infériorité dont souffrent les paysans ».
A son bilan : les allocations familiales pour les familles paysannes et les premiers prêts d’installation pour les jeunes agriculteurs, un réforme du statut de la coopération, la création de l’INRA, du Fonds forestier national et des foyers ruraux. Et surtout le statut du fermage et du métayage, l’une des grandes réformes de la Libération, adopté à l’unanimité (fait rarissime !) à l’Assemblée nationale. Statut du fermage qui concerne aujourd’hui 75 % des terres cultivées et devrait ces prochains mois dans le cadre d’une nouvelle loi foncière être adapté au nouveau contexte, entre des bailleurs qui dénoncent le carcan du statut, des preneurs soucieux de sécurité, et une conception du sol considérée par beaucoup comme patrimoine commun de la Nation…
Toujours plus !
Le nouveau monde (politique) est parfois difficile à déchiffrer. Ainsi la demande du Président de la République à l’actuel ministre de l’Agriculture, Didier Guillaume, de renoncer à se présenter comme tête de liste à la mairie de Biarritz, est apparue comme une sanction. Dans l’ancien monde, devenir ministre était considéré comme l’apothéose d’une carrière politique. Désormais, cela ne semble plus le cas. Il est vrai qu’être élu maire ou sénateur assure une plus grande longévité politique qu’un maroquin ministériel qui peut vite se transformer en siège éjectable. Il faut donc assurer les arrières.
Ce que font de plus en plus de maires de droite et de gauche, souvent de grandes villes, ne pouvant plus cumuler les mandats politiques, mais aussi d’anciens ministres ou chefs de gouvernement, qui deviennent avocat d’affaires ou lobbyiste, monnayant chèrement leur carnet d’adresses, multipliant les jetons de présence dans des conseils d’administration ou investissant dans des fonds de pension, ce qui leur permet allègrement de décupler (voire plus !) leurs indemnités de fonctions. Vincent Jauvert, grand reporter à L’Obs, dans son livre Les Voraces, les élites et l’argent sous Macron (1), cite de nombreux exemples, qui laissent à penser qu’il ne s’agit pas d’un phénomène marginal. Cela concerne aussi l’administration, avec des hauts fonctionnaires qui pantouflent et rétropantouflent passant du public au privé, de l’entreprise à la politique et inversement, au gré des opportunités et du copinage.
Ces attitudes alimentent le sentiment de frustration et d’injustice et nourrissent la défiance entre les Français et leurs élites. Notons toutefois que bon nombre d’hommes politiques résistent à cet attrait insatiable pour l’argent et réclament plus de transparence et d’éthique, mais se heurtent trop souvent à un establishment trop engoncé dans ses privilèges. Dans ce contexte, ne soyons pas étonné qu’il soit de plus en plus difficile de faire passer le message des réformes auprès de l’opinion publique…
(1) Les Voraces – Vincent Jaubert – Robert Laffont – 201 pages – 19 €.
Territoires zéro chômeur
François Mitterrand avait tort lorsqu’il déclarait au début des années 1990 à propos de la lutte contre le chômage : « on a tout essayé ! ». Certes, depuis, les innovations furent peu nombreuses. La plus originale est ce projet de « territoires zéro chômeur de longue durée », conçu par ATD Quart Monde, et qui a fait l’objet d’une loi votée en 2016 à l’unanimité des parlementaires, pour l’expérimenter sur dix territoires. Le projet est original à plusieurs points de vue. Il vise à mettre l’économie au service de la société. Sachant qu’un chômeur de longue durée coûte en moyenne à la collectivité 18 000 € par an (RSA, chômage, CMU…), le principe vise à ne plus verser l’argent au chômeur mais à l’entreprise à but d’emploi (EBE), qui l’embauche (en CDI et au Smic) et l’accompagne pour créer une activité nouvelle qui ne soit pas concurrentielle.
A Mauléon, dans les Deux-Sèvres, l’un des territoires en expérimentation, l’EBE, après 4 ans d’activité, embauche actuellement 90 salariés. Une vingtaine de salariés ont trouvé un emploi ailleurs et l’entreprise a vu son chiffre d’affaires passer de 7 500 € en 2017 à 400 000 € en 2019, avec la perspective d’atteindre prochainement le million d’euros. Signe que ces entreprises peuvent répondre à des besoins nouveaux dans les territoires. Surtout ce projet montre que personne n’est inemployable. Ce dont témoigne le documentaire « Nouvelle cordée » de Marie-Monique Robin, qui a filmé à Mauléon, pendant 4 ans les initiateurs du projet. Il nous fait voir des gens transformés physiquement et psychiquement, qui ont retrouvé de la dignité. Ce qu’oublient les experts de l’Inspection générale des affaires sociales qui, dans un rapport récent, considéraient le projet plus coûteux que prévu. Le diktat des chiffres ! La raison : un tiers des bénéficiaires ne touchaient pas les aides dont ils avaient droit ! Un nouveau projet de loi devrait être voté fin 2020, visant à poursuivre l’expérimentation et à l’étendre à une cinquantaine d’autres. 180 territoires ont déjà fait acte de candidature… Ce qui promet beaucoup de déçus !
Paysages d’apocalypse
Vingt-huit morts, dix millions d’hectares de terres, de landes et de forêts partis en fumée (soit deux fois la superficie de la Belgique), plus d’un milliard d’animaux morts, des fumées qui atteignent désormais le Chili et l’Argentine situés à plus de 12 000 kilomètres…, le tout sur fond de sécheresses récurrentes, de chaleur record, de vents violents, entretenant des feux de brousse devenus inextinguibles, tel est tragique bilan des incendies qui minent l’Australie depuis quatre mois. Depuis qu’Homo erectus l’a maîtrisé, il y a peut-être 2 millions d’années, le feu a suscité fascination et terreur. L’Homme de Neandertal, il y a 400 000 ans, s’en servira pour cuire ses aliments, se procurer de la chaleur et se protéger des prédateurs. Au néolithique, le feu a permis de défricher, et donc d’inventer l’agriculture, selon la technique de l’abatis-brûlis itinérant, et le restera jusqu’à nos jours, avec l’écobuage, technique longtemps considérée comme naturelle et écologique.
Par la suite l’homme jouera parfois avec le feu, en particulier récemment, négligeant l’entretien des forêts, se montrant imprudent et parfois criminel.
Aujourd’hui le feu suscite plus de terreur qu’il ne fascine, tant les images de ces méga-feux font froid dans le dos. Violents, brutaux, incontrôlables, ces sortes de « Tsunami de flammes » marquent une rupture dans la relation de l’Homme à la nature, laissant des paysages d’apocalypse et effaçant toute mémoire, comme ce fut le cas ces dernières années en Grèce, au Portugal, en Californie, en Indonésie, en Bolivie, en Amazonie, en Australie… et même sur les plaines enneigées du Groenland en 2017 ou en Suède et en Lettonie en 2018 !
Nos forêts brûlent, et pourtant, bon nombre de dirigeants de la planète regardent ailleurs, niant toute responsabilité humaine dans le changement climatique à l’instar du premier ministre australien, Scott Morrison, dans le droit de fil de ses collègues Donald Trump et Jair Bolsonaro, pourtant tous concernés dans leur pays par ces méga-feux. Pour autant, en France, nous ne sommes pas à l’abri. Les experts estiment que d’ici 2050, plus de la moitié des communes françaises pourraient être concernées par le risque de feux.
Débat autour du documentaire Faut-il arrêter de manger les animaux ? à l’aiguillage à Château-Thierry, le 17 décembre 2019
Introduction et animation du débat
Ce film, « Faut-il arrêter de manger les animaux ? », de Benoît Bringer, grand prix du Festival international du grand reportage d’actualité, nous interpelle au plus profond de nous-même de manière ni idéaliste, ni moralisatrice.
On a tendance à penser qu’il s’agit de préoccupations nouvelles, parce que dans nos sociétés modernes l’on croit que l’on a tout inventé, alors que l’on ne fait que réinventer des questionnements essentiels. Or ce débat sur la relation animale, sur la consommation de chair animale, a traversé toutes les civilisations, même s’il prend des formes nouvelles aujourd’hui. De tout temps, dans toutes les civilisations, l’homme a entretenu un rapport ambigu, parfois tabou à la chair animale. Les religions ont codifié des rites, ont instauré des interdits alimentaires, ont mis en avant le côté sacrificiel de la mise à mort de l’animal.
Les Pythagoriciens, philosophes grecs, condamnaient le sacrifice animal. L’hindouisme, le bouddhisme, le taoïsme prônaient le végétarisme, comme également, au sein du christianisme, les pères du désert, les trappistes et les bénédictins…
Au XIXème siècle le débat sur l’hippophagie, (pouvait-on manger de la viande de cheval ?) a divisé la société. Des romanciers comme Victor Hugo, Larousse, le père du fameux dictionnaire, l’astronome Maupertuis, plaidaient pour le bien-être animal, et s’insurgeaient contre la conception de Descartes sur les animaux machines. Conception qui va inspirer les fondateurs de la zootechnie. Ces intellectuels vont susciter la création de la SPA.
Quant au végétarisme, Il suffit de regarder la liste des personnages historiques qui étaient végétariens. Et elle est impressionnante : de Platon à Lanza del Vasto, de Confucius à Kafka, de François d’Assise à Martin Luther, de Charles Darwin à Théodore Monod, de Georges Cuvier à Albert Schweitzer, de Virgile à Marguerite Yourcenar en passant par Pascal, Montaigne, Rousseau et Voltaire qui avaient au moins cela en commun, Lamartine, Tolstoï, Einstein et plus près de nous Robert Redford, Steve Jobs… Songer du peu !
Le plus grand ethnologue français, Claude Lévi-Strauss a écrit : « Un jour viendra où l’idée que pour se nourrir les hommes du passé élevaient et massacraient des êtres vivants et explosaient complaisamment leur chair en lambeaux dans ces vitrines, inspirera sans doute la même répulsion qu’aux voyageurs du XVI et XVIIème siècles, les repas cannibales des sauvages américains, océaniens ou africains. »
Ce qui a changé aujourd’hui, c’est qu’on est passé de préceptes religieux ou philosophiques à des considérations éthiques, environnementales, hygiénistes et de santé. Ce qui a changé encore, c’est notre rapport à la mort. La logique sacrificielle, la dimension sacrée de la mise à mort de l’animal a disparu. On le voit bien dans ce film. Ce qui a changé enfin, c’est l’accroissement de la consommation de viande depuis deux siècles. Car la consommation est restée plutôt faible durant les deux derniers millénaires. Et sans doute a-t-on consommée beaucoup plus de viande durant la Paléolithique, ce qui a permis à l’Homme du Paléolithique de survivre pendant périodes glaciaires, qu’au Néolithique où nos ancêtres chasseurs cueilleurs sont devenus agriculteurs et ont domestiqué le bœuf, le mouton et le cochon. Il n’y a guère qu’au XIVème et XVème siècles, après l’épidémie de peste, que le peuple a mangé plus de viande. Les historiens ont parlé de Moyen Age carnivore.
Durant les dernières décennies, on a industrialisé l’élevage, on a construit des abattoirs loin des centre-ville. Durant les Trente glorieuses, du fait de l’amélioration du niveau de vie, on a mangé de plus en plus de viande. Après la Seconde guerre mondiale on a gagné son bifteck, alors qu’avant on gagnait son pain. En 1890, on consommait quotidiennement 900 grammes de pain et 110 grammes de viande ; en 1985 on consommait 200 grammes de viande (un pic) pour un peu plus de 200 g de pain et, en 2019, 135 g de viande pour 120 à 130 g de pain.
A partir des années 1980, la consommation a baissé, avec aussi un transfert sur les viandes blanches au détriment des viandes rouges. Le scandale du veau aux hormones dans les années 1970, puis la vache folle à partir de 1996, et les inquiétudes autour de Dolly, la première brebis clonée, ont accéléré la tendance.
Au-delà de la consommation de viande, c’est le rapport à l’animal qui change. On est loin des animaux machines de Descartes. Depuis on a découvert que l’animal était un être sensible. Si bien qu’aujourd’hui la viande est très éloignée de l’animal, tant elle est transformée. On n’imagine pas servir des yeux de bœuf dans un restaurant, ce qui était le cas au début du 20ème siècle.
Ces bouleversements touchent au-delà de la consommation de viande, les questions autour du bien-être animal, de la réintroduction d’espèces sauvages comme l’ours, le loup dans les espaces montagnards, du rapport à la chasse, à la tauromachie, au cirque et au zoo…
En même temps, une société complètement végétarienne, ou qui privilégierait la viande cultivée in vitro en laboratoire, ce serait la fin d’une civilisation, la fin de l’élevage, des campagnes bouleversées par la disparition des prés qui sont très utiles pour la captation du CO2, alors que l’on accuse les vaches d’être un gros producteur de méthane, un des GES. Et je ne parle pas des conséquences sur nos paysages…
Débat avec
Benoît Bringer, journaliste réalisateur du documentaire, Sébastien Hincelin, agriculteur bio à Rocourt-Saint-Martin, Jean-François de la Monneraye, ancien médecin généraliste à Soissons, Thierry Guyon, éleveur à Epaux-Bézu, commercialisant en circuits courts, Philippe Meurs, Président d’arrondissement de l’Union des Syndicats Agricoles de l’Aisne, Benoît Perin, président de l’AMAP les Saveurs du Tardenois.
Conclusion du débat
L’ampleur des enjeux actuel est telle (changement climatique, eau, sols, biodiversité…) que le temps est compté. Le problème est que les changements dans l’agriculture se font sur le temps long.
Et à ce titre, l’agriculture est une activité qui apparaît en contradiction avec toutes les tendances actuelles, il est vrai difficile à déchiffrer :
Une activité qui réclame du temps long dans un monde qui s’accélère de matière vertigineuse ;
Une activité qui a connu des bouleversements considérables en sept décennies, notamment démographique…
Une activité sédentaire dans un monde qui se nomadise de plus en plus ;
Une activité très concrète, productrice de nourritures et de matières premières dans un monde où dominent les biens immatériels : le virtuel, la financiarisation de l’économie contre l’économie réelle.
Une activité en lien avec le vivant dans un monde de plus en plus virtuel ;
Une activité ancrée dans les territoires au sein d’un monde globalisé fonctionnant en réseau ;
C’est aussi une des rares activités de dimension globalement artisanales à être directement confronté au marché mondial. Du local au global ;
C’est une activité qui pour plein de raison n’entre pas dans les schémas classiques de l’économie politique (libéral comme marxiste), et que l’on fait rentrer de force aujourd’hui dans un schéma libéral. Notons que les élites sont peu à même de comprendre les spécificités de l’agriculture ;
Tous ces questionnements bouleversent notre rapport au vivant, notre rapport au temps, notre rapport aux territoires, notre rapport aux paysages…
En même temps, c’est une activité qui est au cœur des enjeux de société, voire de civilisation : Environnement, santé alimentaire, aménagement du territoire, enjeux technologiques (OGM, clonage enjeux culturels (la question des paysages, la gastronomie…), enjeux économiques et sociaux…
Une activité au cœur de toutes les contradictions et tous les paradoxes. Car entre vaches folles et Dolly, entre malbouffe et gastronomie, entre grande distribution et circuits courts, entre productions intensives et agriculture bio, entre mode de production familial et mode de production industriel, entre fonction nourricière et diversifications dans la production énergétique, la société s’interroge et les agriculteurs aussi. C’est un choix de société. Et je crois que de la manière dont on gèrera la question agricole et alimentaire, dépendra notre type de société.
En fait, nous sommes tous responsables de la situation actuelle. C’est trop facile de pointer du doigt les seuls agriculteurs. A partir des années 1960, ils ont répondu aux demandes des politiques, des pouvoirs publics, des consommateurs qui veulent à la fois des prix bas et des produits de qualité. Aujourd’hui, le monde urbain, de plus en plus déconnecté des réalités campagnardes, semble croire que l’on peut tout changer d’un coup de baguette magique. Or il faut du temps et un accompagnement financier. Le contribuable est-il prêt à payer plus d’impôt pour une agriculture plus respectueuse de l’environnement ? Le consommateur est-il prêt à payer plus cher sa nourriture ? Les pouvoirs publics sont-ils prêts à proposer un nouveau pacte agricole, alimentaire, environnemental de même ampleur que celui engagé par Pisani dans les années 1960, mais à contre-courant ? En fait nous sommes tous un peu hypocrites !
Dans ce contexte, pas sûr que le choix de victimisation tel qu’on l’entend aujourd’hui soit la meilleure façon de répondre à cette impérieuse nécessité de dialogue entre rats des villes et rats des champs…
Le vertige de l’infiniment grand !
Bien sûr, il y a ces clichés de Notre Dame en flammes, de ces odieux bombardements du pauvre peuple kurde et des drames climatiques qui s’enchaînent, mais l’image que je retiens de 2019, comme un clin d’œil aux 50 ans des premiers pas de l’homme sur la Lune, c’est cette carte en 3D de la Voie Lactée, en forme de disque voilé et tordu, d’un diamètre de 500 000 années-lumière, et comprenant plus de 200 milliards d’étoiles.
Les rois mages, fins observateurs du ciel étoilé, considéraient, comme tous leurs contemporains, la Terre au centre de l’univers. Bien plus tard Copernic puis Galilée montreront qu’en fait la Terre tourne autour du Soleil. Au début du XIXème siècle, les astronomes découvriront l’existence de notre galaxie, la Voie Lactée, avec le Soleil éloignée en périphérie. Puis Hubble nous fera découvrir l’existence d’autres galaxies. Aujourd’hui elles se comptent en milliards, – chacune contenant des centaines de milliards de Soleils -, dans cet univers visible qui ne représente que 0,5 % de sa totalité, soit 47,8 milliards années-lumière de visibilité, sachant que la vitesse de la lumière est de 300 000 kilomètres par seconde… Vertigineux ! « C’est à rendre fou », fait dire Gustave Flaubert à Bouvard observant le ciel à travers le télescope de la place Vendôme, dans Bouvard et Pécuchet.
Le ciel qui ressemble à une vaste toile d’araignées avec des galaxies tapies à la croisée des filaments recèle de mystères. Mystérieux et impressionnants trous noirs au centre des galaxies. Mystère des origines et du Big-Bang, de cette harmonie des lois de l’Univers et de cette beauté grandiose, sur fond de quête d’autres formes de vie. « Malgré toutes nos connaissances, nous ne savons pas de quoi est fait 95 % du contenu de l’Univers », reconnaît humblement l’astrophysicien Trinh Xuan Thuan. La Terre, qui se rapetisse dans un univers en expansion, semble si fragile et si vulnérable, et l’Homme, « poussières d’étoiles », paraît de plus en plus ancré dans le monde de l’infiniment petit. « Regardant les étoiles, je me pénètre de l’insignifiance des choses », écrivait Charles de Gaulle dans ses Mémoires.
Cadeaux fiscaux et dons en baisse…
Ce temps de Noël est celui des cadeaux ; il est aussi celui des dons. Et nombreuses sont les sollicitations des associations multiples et variées qui, du Téléthon aux Apprentis orphelins d’Auteuil, en passant par le Secours populaire ou le Secours catholique, font appel à la générosité publique. C’est plus que jamais vrai cette année. Et pour cause, les dons ont baissé en 2018 pour la première fois depuis des années. A l’origine de cette baisse, les réformes fiscales atteignant notamment les plus de 60 ans qui représentent 55 % des donations et 60 % des montants collectés. Si la baisse est cantonnée à 2 % pour les dons bénéficiant de déductions fiscales sur l’impôt sur le revenu, elle est beaucoup plus conséquente pour les dons liés au défunt Impôt sur la fortune (devenu Impôt sur la fortune immobilière), qui chutent de plus de 60 %, comme le montre un dossier du journal La Croix (12/12/2019). Et si, aujourd’hui, personne n’est capable de dire si l’argent économisé par ceux qui payaient l’ISF a servi au développement de l’appareil productif français, au moins sait-on qu’il n’est pas allé à la générosité. Confirmant ce constat que, parmi les plus aisés, bon nombre ne donnent que s’ils y trouvent un intérêt.
En même temps, la précarité et la pauvreté prospèrent comme le montrent les travaux de l’INSEE et des organisations caritatives. L’Etat, contraint à la rigueur budgétaire, s’est déchargé de l’aide aux plus démunis auprès des collectivités territoriales et d’associations qui ont de moins en moins de moyens. C’est d’autant plus vrai dans les campagnes qui disposent de beaucoup moins de services sociaux que les villes. Et si la précarité semble plus discrète en milieu rural, c’est parce que souvent ceux qui pourraient bénéficier d’aides sociales rechignent par dignité à faire appel aux services sociaux. Dans ce contexte, l’augmentation des demandes d’aide, en particulier dans les campagnes, constatée par les travailleurs sociaux et les bénévoles des associations de lutte contre la précarité, est un signal qui n’est pas très encourageant.
La France de Poupou…
Avec la disparition de Raymond Poulidor, c’est l’un des derniers témoins emblématiques de cette France paysanne qui disparaît. Poulidor a passé sa jeunesse dans la petite exploitation de la Creuse, travaillant aux champs jusqu’à la tombée de la nuit, avant l’entraînement. Pour lui, comme pour des générations de jeunes issus de cette France paysanne souvent pauvre, la compétition cycliste fut une forme de revanche sociale.
Quant à la rivalité entre Jacques Anquetil et Raymond Poulidor, notamment ce fameux coude à coude sur les pentes du Puy-de-Dôme durant le Tour de 1964, elle témoignait de deux visions radicalement différentes de la société française. Sur fond de débat sur la fin des paysans, – le sociologue Henri Mendras publia La fin des paysans ? en 1967 -, le normand Anquetil qui avait aussi des racines rurales, (son père produisait des fraises à Quincampoix), représentait la France moderniste, l’urbain, l’avenir, la technologie, le marché… Il était perfectionniste et épicurien, voyageait en avion et courait à l’économie, un chronomètre dans la tête. Sa carrière de cycliste finie, il deviendra gentleman-farmer. Le limousin Poulidor incarnait la sagesse et le courage, le terroir et le bon sens, la simplicité et la sécurité, le sens de l’économie « un sou, c’est un sou », en un temps où le rapport à l’argent était bien différent. La France de « Maître Jacques » se passionnait pour Le défi américain de Jean-Jacques Servan-Schreiber, la France de Poupou craignait cette froide modernité que décrivait le cinéaste Jacques Tati dans Playtime.
Durant ces « Trente glorieuses », l’éternel second prendra sa revanche dans le cœur des Français. Sans doute faut-il voir dans cette « poupoularité », expression inventée par Antoine Blondin, la revanche du second sur le premier de la classe, trop brillant pour devenir chaleureux, mais aussi cette opposition qui perdure et traverse le temps, bien au-delà du clivage entre modernes et anciens, en un temps où le notion de progrès n’a plus forcément la charge positive qu’elle pouvait avoir auparavant.
Tous responsables !
La semaine passée, Le Monde titrait en une « Enquête sur le désarroi du monde agricole », tandis que, dans Le 1, Edouard Bergeon, le réalisateur de Au nom de la terre dénonçait l’agribashing. Cet anglicisme qui signifie dénigrement systématique des agriculteurs, n’est pas très adapté à la situation, car les sondages montrent qu’une grande majorité des Français continuent d’accorder leur confiance à leurs agriculteurs. Faut-il y voir le reflet déformant des médias, qui, dans la course à l’audimat, ont tendance à mettre en exergue les positions les plus extrêmes ? Et ne parlons pas de la surenchère des réseaux sociaux dans la provocation et l’incitation à la haine ! Certes le bashing traverse l’ensemble de la société, des institutions aux religions, des politiques aux médias, mais il touche d’autant plus violemment ce monde agricole, qu’il vit une grave crise d’identité après avoir connu les mutations les plus considérables.
De cette situation, nous sommes tous responsables, des pouvoirs publics aux consommateurs qui veulent à la fois des prix bas et des produits de qualité. L’erreur est de pointer du doigt les agriculteurs, à qui l’on reproche d’avoir répondu à la demande de modernité de la société. Qui plus est le monde urbain, de plus en plus déconnecté des réalités campagnardes, semble croire qu’on peut changer de modèle d’un coup de baguette magique. Or il faut du temps et un accompagnement financier… Le contribuable est-il prêt à payer plus d’impôt pour une agriculture plus respectueuse de l’environnement ? Le consommateur est-il prêt à payer plus cher sa nourriture ? Les pouvoirs publics sont-ils prêts à proposer un nouveau pacte agricole, alimentaire et environnemental, de même ampleur que celui engagé par Pisani dans les années 60 ? Et la profession agricole est-elle prête à mieux communiquer avec la société, comme avaient su le faire les jeunes agriculteurs de la révolution silencieuse ? Dans ce contexte, pas sûr que le choix de la victimisation soit la meilleure façon de répondre à cette impérieuse nécessité de dialogue entre rats des villes et rats des champs.
C’était, il y a 30 ans !
Dans quelques jours l’Europe commémorera la chute du mur de Berlin. C’était le 9 novembre 1989, un jour presque ordinaire jusqu’à 19 heures, avant cette sidérante liesse populaire, avec ces files de trabans, ces retrouvailles de familles séparées, et Rostropovitch interprétant les suites de Bach à Check Point Charlie…En quelques heures, s’effondrent des pans de ce mur de 165 kilomètres de long, qui séparait la consumériste et multicolore Berlin-Ouest de Berlin-Est engoncée dans les nuances de gris et les restrictions. Quelques semaines plus tôt, malgré les écrits de Soljenitsyne, les discours de Sakharov et le théâtre de Vaclav Havel, la glasnost de Gorbatchev et Solidarnosc de Walesa…, personne n’imaginait un tel scénario si soudain.
Cet événement majeur de la fin du XXème siècle, (à la fois si proche et déjà si lointain !), met fin à la guerre froide, engage la réunification allemande, entraîne la fin du rideau de fer, la dislocation de l’URSS et l’émergence d’une nouvelle Europe avec l’instauration de l’euro et le recentrage de l’Allemagne, au cœur d’une Union élargie sur son flanc Est. A l’époque l’inquiétude des dirigeants européens, comme François Mitterrand ou Margaret Thatcher, est notable, semblant partager cette formule de François Mauriac : « J’aime tellement l’Allemagne, que je préfère qu’il y en ait deux ». Est définitivement remis en cause également ce « deal » implicite des débuts de la construction européenne entre une France puissance agricole et une Allemagne fédérale puissance industrielle. Les difficultés de la réunification surmontées, l’Allemagne va moderniser les grandes fermes d’Etat, supplantant désormais la France dans la hiérarchie des pays européens exportateurs de produits agricoles.
Trois décennies après, dans une Europe embourbée par l’interminable feuilleton du Brexit, les démocraties « illibérales » de Hongrie ou de Pologne, prêtes à reconstruire de nouveaux murs, et la montée en puissance de l’extrême-droite dans les Länder de l’Est n’ont plus rien à voir avec l’espoir de cette jeunesse en liesse, assoiffée de liberté, partie à l’assaut de ce « mur de la honte ».
Au nom de la terre
Le film d’Edouard Bergeon Au nom de la terre a surpassé au box-office Rambo, la semaine passée avec près de 500 000 entrées. Ce film poignant, car inspiré de la tragédie vécue par le réalisateur, raconte la descente aux enfers d’un agriculteur pris dans l’engrenage de l’endettement et l’épuisement au travail qui le mènent au suicide. Longtemps question taboue, – on s’était ému des suicides chez France Télécom ou Renault, moins des suicides de paysans -, ce thème est également traité dans le livre Tu m’as laissé en vie de Camille Beaurain et Antoine Jeanday, publié récemment au cherche midi éditeur, et le travail de la photographe Karoll Petit.
Pourtant le phénomène n’est pas récent. Depuis des décennies, les agriculteurs figurent parmi ceux qui se suicident le plus. De là à faire le lien entre le suicide et la crise agricole, c’est sans doute aller un peu vite en besogne, selon le sociologue Nicolas Deffontaines, auteur d’une thèse sur ce sujet. Il a interrogé des nombreuses familles qui ont vécu ce drame et ne croit pas en un lien mécanique entre le suicide et les difficultés économiques. Du moins le facteur économique n’est-il pas, à ses yeux, la seule cause !
Pour Nicolas Deffontaines, le problème est donc plus structurel que conjoncturel. Pour cela il se base sur une typologie, qu’il a configurée, des différentes formes de suicides rencontrées dans les campagnes : du suicide « égoïste » lié à l’isolement social au suicide « altruiste » dû aux difficultés de transmission pour les agriculteurs en fin de carrière, en passant par le suicide « anomique » à la suite d’un burnout et le suicide « fataliste » lié à la forte imbrication entre travail et famille. Certes depuis la modernisation de l’agriculture dans les années 1960, le métier d’agriculteur s’est imposé à l’état de paysan, mais, contrairement à d’autres professions, l’échec surpasse le cadre purement professionnel pour atteindre la famille et l’environnement. Ce que traduit avec beaucoup de réalisme et jusque dans le détail le film d’Edouard Bergeon !
L’ère de la complexité
Vu de l’extérieur, le monde des agronomes m’apparaissait comme tiraillé depuis des années dans un non-dialogue stérile entre pro et anti OGM, entre défenseurs d’une agriculture de compétition et promoteurs de trajectoires alternatives. L’accélération du changement climatique, la pression sur les ressources naturelles (eau, sol, biodiversité…) bouleversent la donne. Les récents Entretiens de Pradel, dixièmes du nom, organisés depuis deux décennies par l’Association française des agronomes, sur les terres d’Olivier de Serres, témoignent de ces changements brutaux. Pour bien des intervenants, historiens, sociologues, économistes, juristes, géographes et agronomes, il faut désormais penser l’agriculture dans toute sa complexité. Celle-ci se traduit dans les campagnes par l’éclatement des formes d’organisation du travail agricole – 12 % des exploitations céréalières sont aujourd’hui gérées par des tiers – , et des initiatives comme l’assolement en commun dans le cadre de CUMA intégrales ou de nouvelles synergies entre végétal et animal comme le pastoralisme dans les vignes.
Ce contexte bouleverse le sens du travail des agronomes, longtemps contenu dans cette définition restrictive d’une science « qui étudie les relations entre les plantes cultivées, le milieu et les techniques agricoles ». Il s’agit de revoir complètement les connaissances, de penser l’innovation en fonction des grands enjeux, de reconsidérer les échelles en passant de la parcelle au territoire tout en ayant un œil sur l’état de la planète, mais aussi de repenser la façon d’accompagner l’agriculteur concepteur. Le conseiller agronomique ne sera plus le technicien qui dit la bonne parole. Cette démarche plus empreinte d’humilité à l’égard des agriculteurs redonnera du sens à l’un des plus beaux métiers qui soit. A l’égard de la société, les agronomes devront aussi reconsidérer ce langage d’un entre soi académique, si présent dans les colloques, qui éloigne ceux qui n’ont pas les codes, et, parmi eux, ceux qui ont pour rôle de médiatiser ces enjeux pourtant si essentiels.
Renaissance rurale ?
La semaine passée Le Monde publiait une enquête titrée « La prospérité à la campagne » et une carte des territoires en bonne santé, mettant en exergue quelques espaces ruraux particulièrement dynamiques comme la Vendée, le Choletais, le Lot, la Maurienne… L’on retrouvait à peu près ces mêmes territoires dans le hors-série d’Alternatives économiques publié il y a quelques mois et titré : « Les campagnes sont de retour ». Des dossiers à contre-courant ans du contexte ambiant, où l’on a tendance à penser de façon binaire l’opposition entre métropoles et déserts ruraux. Certes les métropoles concentrent de plus en plus la croissance, l’emploi et la richesse, mais les campagnes n’ont pas dit leur dernier mot. L’exode urbain supplante désormais l’exode rural du fait de l’attrait du soleil et de la mer pour les retraités, de la quête d’une meilleure qualité de vie ou de mode de vie alternatif pour de plus jeunes, mais aussi des activités économiques qui ont su s’adapter. Ainsi le Choletais qui a surmonté la crise de textile, les Herbiers et son tissu de PME, la vallée de la Drôme et ses plantes aromatiques et médicinales, le bassin de Vitré avec moins de 5 % de demandeurs d’emploi, la Maurienne et le tourisme, les terroirs AOP fromagères ou viticoles…, et j’en passe. Chacun cultivant sa singularité et ses atouts. Car ce qui a réussi là ne réussira pas forcément ailleurs ! Il n’y a pas de modèle miracle, tant la France des campagnes est diverse, mais elle est dans l’air du temps : qualité de vie, terroir, écologie, innovations en tous genres… Il y a 30 ans, le géographe et sociologue Bernard Kayser annonçait dans La Renaissance rurale « la fin de la tendance séculaire à l’abandon des campagnes ». « Dans le grand bouleversement de la hiérarchie des valeurs, ajoutait-il, la culture paysanne autrefois méprisée, n’apparaît-elle pas comme un recours lorsque s’emballe dans sa fuite en avant la civilisation moderne ? C’est peut-être en définitive, le meilleur signe de reconstitution de la vitalité des campagnes. » Prémonitoire ?
Le péché originel de la PAC
Les récents déboires diplomatiques entre la France et le Brésil remettent à l’ordre du jour la récurrente question de la dépendance de l’Europe en protéines végétales. L’on se souvient de la réaction de Georges Pompidou, en 1973, en plein conseil des ministres, après l’embargo américain sur les exportations de soja : « Il est inacceptable qu’un peuple dépende d’un autre peuple pour son alimentation ». En fait cette question des protéines végétales est à la fois le péché originel et le nœud gordien de la PAC qui avait établi un même prix pour les céréales panifiables et fourragères. A l’époque, les Six avaient négocié avec les Etats-Unis au sein du GATT la protection du marché communautaire des céréales en échange de l’importation de produits de substitution aux céréales pour l’alimentation animale, loin de s’imaginer qu’ils leur ouvraient un boulevard. Car, marginales à l’époque, ces importations vont s’accroître considérablement avec le développement du modèle d’élevage intensif sur le Vieux Continent, autour du couple maïs-soja. Si bien que, très vite, les céréales européennes ne vont plus être compétitives, ouvrant la voie au soja, depuis des décennies, incontournable. L’Europe en importe 33 millions de tonnes chaque année. Les différents plans protéines pour reconquérir au moins partiellement ce marché n’ont pas toujours eu le succès escompté, même si la France est dans une moindre dépendance (45 %) que ses voisins.
Quant à la volonté d’Emmanuel Macron, de rétablir « une souveraineté protéinique européenne », l’histoire montre qu’elle est loin d’être acquise, du moins politiquement et diplomatiquement. Car, côté technique, les solutions existent. Notamment la luzerne, une légumineuse riche en protéines, qui évite donc l’importation de soja, limitant d’autant la déforestation de l’Amazonie. Qui plus est, elle enrichit le sol en captant l’azote, et, s’intègre pleinement dans l’air du temps (climatique), en se montrant économe en eau. Mais on ne l’évoque que trop rarement. La luzerne serait-elle moins noble à cultiver que d’autres plantes ?
Au-delà de Clochemerle !
Sans doute, ces faits divers « clochemerlesques » concernant les « nuisances sonores champêtres », qui fleurissent en période estivale dans la rubrique faits divers, quand la presse n’a plus grand-chose à se mettre sous la dent, indiquent-ils une montée de l’intolérance en France. Cloches des vaches des alpages ou cloches des églises des villages qui sont parfois considérées par des résidents saisonniers comme du tapage nocturne, contraignant certains maires à repousser d’une heure l’angélus matutinal ; ou ces plaintes contre le chant des cigales jugé trop strident… Et pourtant, il est bien plus agréable d’être réveillé par le chant du coq que par les sirènes de la police, le flot des voitures et autres multiples nuisances sonores de la ville. C’est souvent le coq, emblème national dès l’époque romaine (gallus signifiant d’ailleurs à la fois habitant de la Gaule et roi de la basse-cour) qui excède nos citadins en mal de quiétude champêtre. Le cas de Maurice, gallinacé de l’île d’Oléron, dont la presse s’est faite largement l’écho ces derniers mois, n’est pas isolé. Maurice qui a comparu devant le Tribunal de Rochefort sera fixé sur son sort le 4 septembre prochain…
Souvent ces « troubles anormaux du voisinage », comme disent les juristes, prennent des proportions inouïes. Ainsi cette affaire de coassement de grenouilles, qui a vu la Cour de Cassation confirmer la condamnation en appel du propriétaire d’une mare à la combler et à verser 3 000 € à ses voisins, avec de lourdes pénalités de retard (150 € par jour !) d’autant que l’affaire dure depuis cinq ans… Or cette mare abrite plusieurs espèces d’amphibiens protégées et la loi prévoit une peine de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 euros de dommages et intérêts en cas de destruction d’un site de reproduction d’espèces protégées. Si bien que les propriétaires ne savent plus à quelle justice se vouer ?
Pour autant ne tombons pas dans l’excès inverse, qui voit un député déposer une proposition de loi visant à protéger le patrimoine sensoriel de la nature !
A quand le chant du coq inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO ?
Il y a 400 ans, mourait Olivier de Serres
A propos de son nom patronymique, Michel Serres, dans une de ses dernières interviews à la revue Zadig, évoquait à la fois la montagne (la sierra espagnole) et la route de la soie. L’élevage de la soie ne s’intitule-t-il pas sériciculture ! Ces caractéristiques vont bien à son homonyme, la particule en plus, Olivier de Serres, l’homme des monts ardéchois mais surtout le pionnier de la sériciculture en France et le premier agronome français, dont on commémore cet été le 400ème anniversaire de sa mort.
Fils d’un drapier, Olivier de Serres va se passionner pour l’agriculture en achetant le domaine du Pradel (le bon pré en latin), d’une centaine d’hectares dans le Vivarais. Pour cet érudit protestant (comme ses contemporains Ambroise Paré et Bernard Palissy) qui a beaucoup lu, notamment les agronomes antiques, la terre sera la passion de sa vie, en ces temps troublés, d’épidémies, de disettes et surtout de récurrentes guerres de religion. D’ailleurs l’on soupçonne Olivier de Serres, à la réputation de pacifiste et de conciliateur, d’avoir participé au massacre, si massacre il y eut ?, d’une trentaine de prêtres à Villeneuve-de-Berg, bastion papiste dans une terre calviniste.
Le calme revenu, après ces « horribles confusions et désordres », Olivier de Serres s’adonne à nouveau à sa passion, remet en état le domaine et se lance dans l’écriture de son œuvre Le Théâtre d’agriculture et mesnage des champs, à la fois somme de plus d’un millier de pages rééditée à de multiples reprises, œuvre littéraire aux accents poétiques, en même temps que traité d’agriculture, soucieux d’expérimentation, qui fait la synthèse des connaissances de l’époque. Car l’homme est un pionnier qui introduit la culture du riz, du houblon et du maïs, qui réussit à acclimater des pommes de terre, un siècle et demi avant Parmentier, et qui va devenir un pionnier de la sériciculture. Henri IV, qui lui commandera 20 000 pieds de mûriers pour les Tuileries et les jardins royaux, se faisait, dit-on, lire chaque soir des passages du livre d’Olivier de Serres !
Le retour des coquelicots !
Je ne sais pas si vous partagez cette impression, mais je trouve qu’en cette saison le coquelicot revient en force sur les talus, aux abords des routes, voire dans les champs. Le coquelicot, symbole de la fleur sauvage, rappelle un temps que les moins de 50 ans ne connaissent pas. Un temps où le coquelicot, très présent partout, avait aussi une certaine aura médiatique. Les plus anciens d’entre nous se souviennent de cette émission de télé du journaliste François Henri de Virieu qui avait pour titre Adieu coquelicots.
Le documentaire, tourné en 1970 dans l’Aveyron, à Noyès, village de Raymond Lacombe, et dans l’Isère autour du GAEC Rebotton, ferme laitière de 500 vaches, l’une des premières à importer des vaches Holstein des Etats-Unis, analysait le passage d’une agriculture traditionnelle à une agriculture moderne, avant de laisser place au débat. Le décor est sobre, l’écran est noir et blanc, le studio est envahi par les fumées de cigarettes. Autour du présentateur, le doyen Georges Vedel, un juriste, qui vient de remettre un rapport sur l’avenir de l’agriculture, le sociologue Henri Mendras qui vient de publier La fin des paysans, un agriculteur en GAEC et un représentant de la CFDT salariés agricoles. A Bruxelles en duplex, Sicco Mansholt, le vice-président de la Commission européenne, et Jacques Duhamel, le ministre de l’Agriculture, et, à Lyon, trois anciens de la JAC qui auront des parcours syndicaux et politiques différents : Michel Debatisse, Raymond Lacombe et Bernard Lambert.
L’introduction de l’animateur évoquant le coût exorbitant de l’agriculture met le feu aux poudres. Michel Debatisse quitte brutalement l’émission. Déjà la télé se veut clivante ! Surtout le futur animateur de l’émission politique phare des années 1980 – 1990 L’heure de vérité est alors loin d’imaginer, cinquante ans plus tard, le retour des coquelicots. Signe de l’importance prise depuis par les questions environnementales, et notamment la biodiversité. C’était, il est vrai, un autre monde et un autre temps !
Intervention pour les 20 ans du semencier Saaten Union, Le 13 juin 2019
Introduction :
20 ans l’âge de raison, le bel âge, l’âge de tous les possibles.
20 ans, c’est important à l’échelle d’une vie d’homme,
20 ans, un rien, l’infiniment petit, à l’échelle de l’histoire de l’humanité.
Et pourtant, il s’en est passé des choses, durant ces vingt ans à tous les niveaux et en particulier au niveau de l’agriculture.
L’accélération du temps
En observant l’évolution de nos sociétés, on s’aperçoit que les quatre grandes angoisses qui traversent aujourd’hui la population française, mais plus largement la population européenne, voire une grande partie de la planète, à savoir :
La mondialisation,
Le terrorisme,
L’avènement de la société numérique, et
Les questions environnementales étaient quasiment méconnues, il y a 40 ans, et vont commencer à irriguer la société française, il y a seulement 20 ans, quand se créait votre société.
Force est de constater cette accélération du temps presque exponentielle qui fait qu’on a réalisé plus de progrès en agriculture lors des sept dernières décennies qu’au cours des huit millénaires qui ont précédé la Seconde guerre mondiale.
En effet, que de bouleversements au cours de ces dernières décennies ! L’année 1999 reflète cette transformation du monde, amorcée dix ans plus tôt avec la chute du mur de Berlin et les événements de Tian an men. 1999 voit l’entrée en vigueur de l’euro, la guerre du Kosovo, la démission de Boris Eltsine et l’arrivée de Poutine, le débat sur les OGM qui s’amplifie et, beaucoup de catastrophes naturelles et climatiques, déjà.
Le grand chambardement des campagnes françaises
Et c’est aussi le grand chambardement des campagnes françaises, cher à l’historien Fernand Braudel, qui perdure, voire s’accélère. Aucun autre secteur n’aura connu des bouleversements aussi importants, au cours des dernières décennies.
1/ Bouleversements démographiques, d’abord, le plus impressionnant : 30 % de population active agricole à la fin de la Seconde guerre mondiale, soit plus de 4 millions d’actifs, moins de 3 % aujourd’hui soit un peu plus de 400 000 actifs. Les chefs d’exploitation ne représentent en 2018 que 1,8 % de la population active. En quelques décennies, les agriculteurs encore majoritaires dans la population au début du XXème siècle sont devenus une minorité, presqu’une infime minorité. Aucune autre catégorie socioprofessionnelle n’a connu une si importante érosion démographique. Ce qui se traduit par une prise de conscience douloureuse, d’autant plus mal ressentie que, dans le même temps, le monde se désarticule et qu’émergent aux extrêmes un modèle d’agriculture de firme obéissant à des logiques financières transnationales, sous-traitant d’ailleurs souvent l’ensemble des travaux agricoles à des prestataires, et d’autres formes alternatives (circuits courts, AMAP, permaculture…) souvent menées par des acteurs qui ne sont pas issus du monde agricole.
2/ Bouleversements technologiques : une vache qui donnait 1 200 litres il y a 50 ans en produit aujourd’hui huit fois plus tandis que des années 1960 aux années 1990 le rendement en blé augmentait d’un quintal par an. Notons que depuis les années 1990 il a tendance à stagner.
3/ Bouleversements professionnels : on est passé de l’état paysan au métier d’agriculteur, de l’exploitation familiale à des structures juridiques nouvelles. Et plus récemment, notons cette forme d’éclatement du monde agricole qui se voulait unitaire, avait une vision assez harmonieuse, portée notamment par des mouvements de jeunes comme la JAC (Jeunesse agricole catholique), la génération Michel Debatisse, depuis la modernisation des années 1960, mais qui, aujourd’hui, semble éclater entre des visions très différentes sur l’avenir de la profession.
4/ Bouleversements dans le poids électoral et la représentation politique : émergence dans toute l’Europe des idées écologistes et libérales qui vont marginaliser le monde paysan, autrefois très puissant politiquement. Il y a trois décennies, le poids électoral du monde agricole était important et dépassait le nombre des actifs agricoles, agrégeant les retraités de l’agriculture, les professions en lien avec le monde agricole : techniciens, vétérinaires, salariés des organisations professionnelles, et les enfants issus de familles agricoles, qui bien que devenus citadins, gardaient quelques affinités avec le monde agricole. Cet électorat représentait une part non négligeable de l’électorat de certains partis politiques. Aujourd’hui tout cela a éclaté. Cela se traduit également par un bouleversement dans l’équilibre du monde rural, avec une marginalisation de la population agricole dans les villages. Il y a quelques décennies les agriculteurs représentaient près de la moitié du total des maires. Ce n’est désormais plus le cas. Et dans certains villages, les agriculteurs ne sont plus représentés au sein des conseils municipaux.
5/ Bouleversements sociétaux avec la fin des trente glorieuses, qui voient l’émergence dès la fin des années 1960 des mouvements écologistes, dans le sillage de la publication du livre Le printemps silencieux de Rachel Carson, une biologiste américaine, un best-seller témoignant des dégâts du DDT sur la faune est un des épisodes les plus importants. John Kennedy qui avait lu le livre avait décidé contre l’avis de son ministère de l’agriculture d’interdire le DDT. Puis ce fut mai 1968, et dans les années 1970, la publication du rapport du Club de Rome, et la première candidature écologiste à une élection présidentielle en France en 1974, celle d’un agronome, René Dumont, professeur d’agriculture comparée à l’Agro de Paris, membre du Commissariat au Plan de Jean Monnet à la Libération, où il sera l’instigateur d’une politique agricole moderniste et productiviste, notamment la révolution fourragère…
En même temps, il y aura la prise en compte dès les années 1970 de la question de la sécurité alimentaire, avec l’affaire des veaux aux hormones, puis quelques années plus tard, le tragique épisode de la vache folle, sur fond d’amiante, de Tchernobyl, d’affaire du sang contaminé et autres salmonelloses.
6/ Bouleversements des équilibres économiques et géopolitiques. Avec l’arrivée au pouvoir de Ronald Reagan aux Etats-Unis et de Margaret Thatcher en Grande Bretagne, les idées keynésiennes (rôle de l’Etat dans les équilibres économiques) qui avaient marqué les politiques économiques et sociales des pays occidentaux depuis la crise de 1929 et le New Deal de Roosevelt, sont remplacés par les thèses monétaristes (F. Hayek et Milton Friedman) qui prônent la fin de l’intervention de l’Etat, la libre concurrence, le marché… Déjà, dès la fin des années 1970, après les crises pétrolières (1973 – 1979) et la fin de l’énergie à bas prix, notons l’érosion ce que l’on a appelé l’Etat providence, les délocalisations et les débuts de la désindustrialisation, la baisse de la population ouvrière et, par la suite, une économie financière qui va s’imposer de plus en plus à l’économie réelle.
Une dérégulation qui touche toutes les politiques économiques et à laquelle la PAC n’échappe pas depuis la réforme de 1992 et de toutes celles qui vont suivre, jusqu’à la fin des quotas laitiers et récemment des quotas sucriers. Les négociations du GATT puis de l’OMC, l’élargissement de l’Europe, le « détricotage » de la PAC, vont ouvrir la porte à une concurrence exacerbée entre Etats-Membres et producteurs de ces Etats Membres. Loin des idéaux de paix, de solidarité, des Pères de l’Europe ! Lors de la négociation du Traité de Rome, instituant la Communauté européenne, le négociateur, Paul-Henry Spaak, un homme d’Etat belge, avait interdit aux ministres de l’Economie et des Finances des Six d’intervenir dans la négociation, pour éviter que chacun des pays ne soit tenté de négocier le bout de gras !
Au cours des 20 dernières années, le monde agricole a confirmé voire amplifié les tendances des périodes précédentes : agrandissement des exploitations (42 ha en moyenne en 2000, 64 ha aujourd’hui), montée en puissance de l’agriculture sociétaire, prééminence des productions végétales au détriment des productions animales qui avaient pris l’avantage durant les Trente Glorieuse, spécialisation accrue des exploitations et des régions, concurrence accrue entre les Etats-Membres de l’Union européenne, développement du bio (7,5 % des surfaces aujourd’hui) et des circuits courts, disparités des revenus entre exploitations, entre productions, entre régions qui ont tendance à s’aggraver, et des progrès en termes d’innovations qui tendent plus vers le qualitatif que le quantitatif…
Paradoxalement, alors que la population agricole ne cesse de baisser, l’agriculture se trouve plus que jamais au cœur des enjeux de société, voire des enjeux de civilisation :
1/ Enjeux géopolitiques, économiques et sociaux avec la mondialisation, les relations Nord/Sud, les marchés des matières premières, la question de l’emploi, l’avenir de l’Europe, la financiarisation de l’agriculture, qui se traduit par les dérives spéculatives qu’on a connues en 2008 et l’accaparement des terres par des grandes firmes ou des Etats, notamment dans le tiers monde ; Et puis, bien sûr la question sensible de nourrir dix ou onze milliards de terriens d’ici 2100. Se nourrir est un besoin vital et la question alimentaire est avec les enjeux environnementaux, la plus essentielle.
2/ Enjeux sanitaires avec la sécurité alimentaire ;
3/ Enjeux territoriaux avec les déserts ruraux et la métropolisation du territoire, et peu de transferts publics des régions riches vers les régions les plus pauvres. Et ce constat que plus on s’éloigne des métropoles, plus on est pauvre !
4/ Enjeux technologiques liés aux nouvelles technologies du vivant comme la transgénèse ou le clonage…
5/ Enjeux éthiques liés à ces nouvelles technologies, mais aussi avec la question du bien-être animal et la montée en puissance de modes de consommation (modes de vie) végétariens voire véganes…
6/ Enjeux culturels avec la question des paysages, des terroirs, de l’agriculture biologique et de la qualité gastronomique, la relation avec le monde sauvage : notamment avec la réintroduction du loup, de l’ours, du lynx… dans certaines régions de montagne, ce qui n’est pas sans poser quelques problèmes avec l’élevage pastoral.
7/ Enjeux environnementaux : de la question de l’eau à la dégradation des sols, du changement climatique à la protection de la biodiversité…
L’agriculture est au cœur de tous ces enjeux, ce qui en fait un laboratoire de modernité dans la société. Bref entre vaches folles et Dolly, la première brebis clonée, entre malbouffe et gastronomie, entre grande distribution et circuits courts, comme les AMAP, entre productions intensives et agriculture bio, entre mode de production familial et mode de production industriel, entre fonctions nourricières et diversifications, notamment dans la production d’énergie, la société s’interroge, et en particulier, le monde agricole.
Bien des interrogations, sur fond de crise d’identité qui se traduit par, à mon avis, trois éléments :
1/ Le refus de l’Europe : après avoir été pionniers dans la construction européenne, les agriculteurs forment la catégorie socioprofessionnelle qui a voté le plus contre la ratification des traités européens (Maastricht en 1992 et le Traité Constitutionnel en 2005);
2/ Le vote Front national qui ne cesse de croître au sein d’une population qui a été longtemps rétive aux idées d’extrême droite ;
3/ Et plus tragiquement, le taux de suicide des agriculteurs, supérieur à toutes les autres catégories socioprofessionnelles.
J’ajouterai à cela le fait que l’agriculture apparaisse à contre-courant des grandes tendances du nouveau monde et qui semble marquer la fin des sociétés post néolithiques, avec l’émergence d’une société de plus en plus digitale. Ceci dit : constatons que le monde agricole est très présent dans les réseaux sociaux. Il est l’un des mieux équipés en informatique, dès l’origine d’ailleurs, avec dès le début des années 1980, le développement de la télématique (le fameux Minitel).
C’est l’activité agricole qui apparaît à contre-courant :
- C’est en effet une activité qui réclame du temps long dans un monde, qui, comme on l’a vu, s’accélère de manière vertigineuse.
- C’est une activité sédentaire dans un monde qui se nomadise, en particulier aux deux extrêmes de la société : les très riches qui sont chez eux partout, et les très pauvres, les migrants ou les SDF, qui sont chez eux nulle part.
- C’est une activité ancrée dans les territoires, dans les terroirs, au sein d’un monde globalisé fonctionnant de plus en plus en réseau.
- C’est enfin une activité liée au monde du vivant dans une économie de plus en plus virtuelle, numérisée, digitalisée.
Crise d’identité
Au cours des vingt dernières années, certaines tendances ont amplifié ces pertes de repères que sont la disparition du lien entre famille et exploitation, les problèmes de transmission, la grande diversité des situations, et la marginalisation démographique, économique et sociale comme nous l’avons vu. J’ajouterai et je l’ai un peu évoqué tout à l’heure, cette évolution au sein des familles, où notamment autour de questions comme les questions environnementales liées à l’agriculture, le débat autour des phytosanitaires, il n’y a plus consensus. Et l’on peut s’en rendre compte au niveau des repas familiaux… Ce qui n’est pas facile à vivre. D’autant que, c’est une observation que j’ai pu faire, les agriculteurs ont la fâcheuse tendance de croire que si on leur adresse la moindre petite critique, l’on est contre eux… Ce qui ne facilite pas les échanges et le dialogue !
Pour l’anecdote, mais oh combien révélateur de cette perte de repères, j’ajoute ce paradoxe de l’agriculture urbaine. Alors qu’au cours des décennies on a fait disparaître l’agriculture maraîchère dans ou près des villes. (Le quartier du Marais produisait pendant des siècles les légumes de Paris, mais aussi les banlieues proches. Et puis les politiques urbaines ont renvoyé les maraîchers toujours plus loin, avant de les faire disparaître !
Alphonse Allais voulait mettre les villes à la campagne parce que l’air y était de meilleure qualité. Aujourd’hui l’agriculture urbaine se veut être un facteur de lien social dans les villes tandis qu’à la campagne le lien social a tendance à se déliter.
Reconquérir la biodiversité
Compte tenu de ce contexte nouveau, de ce nouveau paradigme, aux logiques souvent contradictoires, l’un des enjeux essentiels est : saurons-nous gérer la diversité ? : Diversité des plantes, diversité des espèces, diversité des races animales, diversité génétique, diversité des hommes, diversité des modes de production… Et, dans cette évolution, le monde des semences aura un rôle essentiel à jouer et devra gérer cette diversité pour répondre au mieux à des besoins différents. C’est une nouveauté, une révolution dans l’histoire de l’agriculture.
Depuis la révolution néolithique, il y a dix millénaires dans le Croissant fertile, puis dans le monde sumérien, le paysan n’a cessé de chercher à favoriser la plante cultivée et ainsi éviter la concurrence dans l’accès à la lumière, à l’eau, à l’alimentation. Ce phénomène s’est accéléré fortement depuis la révolution industrielle, érodant considérablement la biodiversité. Je crois que nous vivons aujourd’hui la fin des sociétés post-néolithiques pour un nouveau monde dont on déchiffre assez mal les contours. et qu’il nous faut apprendre à gérer la biodiversité. Ce qui n’est pas sans conséquence sur l’agronomie de demain.
L’agronomie de demain sera une agronomie moins liée à l’énergie et à la chimie, donc une science beaucoup plus complexe à appréhender, mais aussi plus passionnante, je crois. L’agronome redeviendra l’homme de sciences et non plus l’homme d’une seule technologie ; il sera écologue en même temps qu’agronome. Il devra comprendre et analyser les mécanismes écologiques du vivant, prendre en compte le temps long de l’évolution de la biologie. Il sera un homme de terrain, mais aussi un homme d’humilité ; il lui faudra redécouvrir la complexité, réapprendre à gérer la diversité et à ne plus seulement voir la nature comme la loi de la jungle. Je trouve que c’est un beau challenge pour les agronomes de demain. Dans Les dons précieux de la nature, le botaniste et pharmacologue, Jean Marie Pelt montrait les lois de solidarité, de mutualisme, les symbioses dans le monde du vivant. Récemment Stefano Marcuso, l’un des fondateurs de la neurobiologie végétale, dans son livre L’intelligence des plantes nous décrit des plantes qui développent une sensorialité très développée, avec une quinzaine de sens de plus que nous, des végétaux qui respirent, perçoivent et émettent des sons, qui communiquent entre elles, développement une intelligence de réseau, inventant bien avant l’homme une sorte d’internet vert. Je crois que l’on a encore beaucoup à apprendre des végétaux, comme mieux comprendre les mécanismes de la photosynthèse, ou encore cette capacité des légumineuses à fixer l’azote de l’air en le transformant en azote ammoniacal assimilable par les plantes, qui, généralisée à l’ensemble des plantes agricoles, permettrait d’augmenter la productivité en respectant la nature, et ainsi de résoudre les problèmes alimentaires et énergétiques de la planète. Stéfano Marcuso déplorait dans son livre que seuls cinq laboratoires au monde ne se consacrent à ses recherches !
En guise de conclusion,
ce petit clin d’œil au philosophe Michel Serres qui vient de décéder. A l’occasion de la dernière émission Apostrophes de Bernard Pivot, ce dernier avait demandé à chacun des 70 écrivains et intellectuels présents sur le plateau de choisir un mot, le mot qu’ils aimaient. Michel Serres avait choisi le mot ensemencement. Il avait alors fait remarquer : « Avec étonnement, j’ai vu que mes collègues écrivains avaient complètement oublié tous les mots qui les reliaient à la terre. » Ensemencement, j’aime bien aussi ce mot, qui témoigne d’un bel hommage au monde agricole et au monde de la semence. Et puis l’un des livres qui m’a incité à me lancer dans l’écriture des livres, c’est La Guerre des semences de Jacques Grall, journaliste au Monde et Bertrand Roger-Lévy, directeur de la communication à l’INRA, publié au milieu des années 1980, et le regard spectral qu’ils portaient sur ce secteur et vos métiers.
J’ai peu parlé de semences parce que vous êtes mille fois plus compétents que moi mais j’ai essayé de recenser toutes les problématiques autour de ce monde des semences si passionnant, mais nous allons en parler, plus abondamment, plus précisément, plus techniquement et scientifiquement, maintenant.
Je vous remercie de votre attention.
Michel Serres, le dernier philosophe paysan
Philosophe, historien des sciences, théoricien de la communication, enseignant dans beaucoup d’universités de par le monde et auteur d’une cinquantaine d’ouvrages, Michel Serres est décédé le 1er juin dernier. Cet intellectuel curieux de tout, qui considérait que pour être philosophe, il fallait s’appuyer sur un savoir encyclopédique, découvrir la totalité du monde et des hommes, des langues et des religions, s’intéressait à Leibniz et Jules Verne, aux mathématiques et aux anges, au développement durable et à la révolution numérique, ainsi qu’à Tintin (il était l’ami d’Hergé). Enfant de la guerre, il avait décidé après Hiroshima d’étudier la philosophie. Ayant vécu cette période de guerres, il refusait l’expression « c’était mieux avant ! » et considérait l’arrivée du numérique comme une révolution aussi importante que l’invention de l’écriture ou de l’imprimerie, permettant un accès immédiat à l’information et à la connaissance.
Dans une vie antérieure, ce fils de marinier de la Garonne, qui savait labourer avec un cheval, avait fait l’Ecole navale et était devenu capitaine au long cours, participant notamment à l’expédition de Suez. Homme de l’eau, il revendiquait ses origines paysannes (il avait gardé l’accent gascon) et voyait la fin de cette civilisation paysanne, en temps qu’elle modelait conduites et cultures, sciences, vie sociale et religions, comme le plus grand événement du XXème siècle. L’auteur du Contrat naturel, l’un des premiers ouvrages de philosophie de l’écologie, considérait également que « l’écologie est souvent le discours des gens de la ville pour dire, sans le faire, ce que font sans le dire, les paysans ». A l’occasion de la dernière émission Apostrophes, Bernard Pivot avait demandé à chacun des 70 écrivains et intellectuels présents sur le plateau de choisir le mot qu’ils aimaient. Michel Serres avait choisi le mot ensemencement. « Avec étonnement, j’ai vu que mes collègues écrivains avaient complètement oublié tous les mots qui les reliaient à la terre », disait ce membre de l’Académie française également membre de l’Académie des vins de Bordeaux.
Comment définir la pauvreté ?
Intervention dans le cadre de Rencontre Citoy’Aisne, le 27 avril 2019 à Soissons.
Dans nos sociétés devenues si complexes, l’on a tendance à simplifier les choses et à résumer une situation par un chiffre. C’est ce que l’on fait pour la pauvreté, en déterminant un seuil de revenu, à savoir 60 % du revenu médian, c’est-à-dire le revenu qui partage les deux moitiés de la société, une moitié de la population se situe au-dessus, l’autre moitié est au-dessous, cela donne comme seuil à peu moins de 1 000 € pour un célibataire. Cela concerne aujourd’hui 14 % de la population. Le Robert définit la pauvreté comme l’état d’une personne qui manque de moyens matériels, d’argent, d’insuffisance de ressources. Partout dans le monde on retient un critère économique, en termes de revenus, mais aussi en termes d’accès aux denrées de première nécessité, en termes aussi de patrimoine. Au niveau planétaire c’était le seuil de 1 dollar par habitant, il y a quelques années, seuil passé désormais à 2 dollars…
Au-delà des chiffres liés au revenu, il y a bien d’autres aspects. Le revenu est loin d’être le seul critère pour mesurer la pauvreté ; la définition de la pauvreté comporte d’autres dimensions, elle est multidimensionnelle. « Etre pauvre, ce n’est pas seulement être privé de ressources », a écrit l’économiste indien Amartya Sen, un des grands penseurs contemporains, qui a beaucoup travaillé sur les problèmes de pauvreté. Jeune, il avait connu la famine au Bengale. Pour Sen, le bien-être ne dépend pas seulement de ce qu’un individu possède, mais ce qu’il peut faire de l’horizon qui s’ouvre à lui et de sa liberté de choisir la voie qu’il veut suivre. » Il définissait la pauvreté comme un déficit de capabilités de base (être bien nourri et être logé, prendre part à la vie de la communauté, pouvoir se montrer en public sans honte).En d’autres termes la pauvreté, ce n’est pas seulement des personnes qui sont en situation de faiblesse économique. Des tas d’événements peuvent survenir dans la vie de tout un chacun et peuvent avoir des conséquences importantes dans l’équilibre de la vie, équilibre social, équilibre économique, équilibre culturel… Cela peut être un décès, la perte d’un emploi, un divorce et tout ce qui peut être de la souffrance psychologique, de la souffrance intérieure. Plus généralement toutes les formes de solitude.Avoir des soucis financiers, quand on dispose d’un réseau, d’un carnet d’adresses, que l’on peut se débrouiller pour faire des dossiers, connaître les types d’aides dont on peut bénéficier, ce n’est pas la même chose quand on se retrouve seul face à ses difficultés…
Pauvreté internationale. Esther Duflo, une économiste française qui vit aux Etats Unis et enseigne au MIT, elle a d’ailleurs conseillé le président Obama, sur la pauvreté, avait mis en évidence un critère pour définir la pauvreté, c’est l’accès à l’eau. Il y a d’un côté ceux (ou plutôt celles) pour qui l’eau est le souci permanent, la contrainte de tous les instants, parce qu’elle est d’un accès difficile et rare, qu’elle mobilise beaucoup d’énergie et de temps. C’est aujourd’hui encore le cas de millions de femmes en Asie et surtout en Afrique, des esclaves de l’eau, dont les journées sont rythmées par la corvée de l’eau, y consacrant plusieurs heures par jour. Pour leur rendre hommage à ces esclaves de l’eau, une jeune Gambienne avait décidé de courir le marathon de Paris, avec un bidon d’eau sur la tête. Dans certaines régions africaines, les femmes font en moyenne six kilomètres par jour pour aller chercher l’eau ; une corvée qui se fait au détriment de bien des activités plus émancipatrices comme pour les plus jeunes d’entre elles aller à l’école. Et puis il y a ceux, dont nous sommes, pour qui ouvrir le robinet est un acte machinal, d’une grande banalité parce que nous sommes dans des régions privilégiées dans l’accès à l’eau. L’eau est le reflet des inégalités planétaires. Une des questions clés est celle du peuplement de la planète : environ 21 % de l’humanité réside dans des zones arides, dans des steppes, où elle ne dispose que 2 % de la ressource en eau et bénéficie de 2,5 % des précipitations. C’est dans ces zones que la progression démographique est la plus forte. 3,5 milliards d’humains la moitié de la population mondiale ont accès à une eau qui n’est pas sûre, 1,8 milliard de personnes absorbent quotidiennement de l’eau impropre à la consommation. 2,6 milliards n’ont pas d’installations sanitaires adéquates. L’eau souillée est à l’origine de 80 % des maladies choléra, fièvres typhoïdes, hépatites… La qualité de l’eau est l’une des principales causes de mortalité dans le monde.
Et puis la notion de pauvreté est très relative dans le temps et dans l’espace. Pendant des millénaires, nos ancêtres ont vécu dans un monde de rareté, et la pauvreté était un état très majoritaire. Le regard sur la pauvreté est donc différent. Le sentiment d’injustice naît de la comparaison, d’autant plus sensible qu’elle est proche. Alexis de Tocqueville écrivait dans De la démocratie en Amérique en 1840 : »Quand l’inégalité est la loi commune d’une société, les plus fortes inégalités ne frappent point l’œil ; quand tout est à peu près de niveau, les moindres le blessent. C’est pour cela que le désir de l’égalité devient toujours plus insatiable à mesure que l’inégalité est grande. » Ce qui nous permet de comprendre qu’aujourd’hui, les Français jugent les inégalités plus inacceptables que les habitants de pays beaucoup plus inégalitaires.
Dans l’espace, on ne vit pas de la même manière la pauvreté dans un pays dit riche et dans un pays en développement. Et les pauvres de certains pays riches peuvent être considérés comme des nantis par rapport aux pauvres des favellas brésiliennes et indiennes.
Dans le temps, la pauvreté évolue. Dans les années 60 – 70 en France, les pauvres c’étaient avant tout les retraités du fait d’un minimum vieillesse très bas, et les handicapés ou les malades ; aujourd’hui, ce sont plutôt les jeunes, les familles monoparentales et les migrants.
Pauvreté ressentie. C’est une autre approche de la pauvreté. L’on demande aux gens s’ils se considèrent comme pauvres, ou s’ils considèrent avoir vécu au cours de leur vie une telle situation. On obtient des résultats particulièrement édifiants. Une enquête menée par IPSOS pour le Secours populaire en 2018, la moitié des personnes interrogées disaient rencontré à l’époque une situation de pauvreté ou en avoir connu dans la passé. Ces personnes n’étaient que 30 % en 2009.
Dans la société d’information dans laquelle on vit et dans des sociétés où les inégalités sont moralement injustifiables, l’on se sent toujours le pauvre d’un autre. Les jeunes qui regardent les salaires mirobolants des fonctionnaires, l’employé d’une firme qui voit son patron gagner en une journée ce qu’il a gagné durant toute sa vie professionnelle, cela suscite des tensions.
Il y a aujourd’hui une pauvreté ressentie, dans un monde en pleine mouvance, sans perspectives (quatre des grands enjeux aujourd’hui étaient à peine connu il y a trois décennies : la mondialisation, le numérique, le réchauffement climatique et plus généralement les problèmes environnementaux, le terrorisme, étaient quasiment méconnus. Ce qui rajoute de l’instabilité. D’où cette pauvreté ressentie très forte. Un sondage effectué par la secours populaire récemment montrait que la moitié des personnes interrogées considéraient avoir vécu une période de pauvreté.
Pauvreté et misère
La pauvreté peut être choisie, pas la misère. Je crois que l’on est tous un peu des pauvres, on a tous nos fragilités. La misère, c’est ne compter pour personne Mais c’est la misère qui nous interpelle. « La misère n’est pas une fatalité, elle est l’œuvre des hommes et seuls les hommes peuvent la détruire ».
Bronislaw Geremek, un historien polonais, et homme politique proche de Lech Walesa et de Solidarnösc avait fait une partie de ses études en France et avait travaillé notamment sur la pauvreté au Moyen Age en France. La Potence et la Pitié. Il avait classé les pauvres en trois catégories :
Les pauvres que l’on admire : les religieux, les moines parce qu’ils ont choisi la pauvreté comme absolu de vie.
Les pauvres acceptables : ceux qui sont dans l’impossibilité de travailler car victimes de maladies ou de handicaps et que l’on se doit d’aider par charité chrétienne pour se racheter de ses fautes.
Les pauvres indignes et honteux qui pourraient travailler mais ne travaillent pas comme les vagabonds, très souvent victimes au cours des siècles de mesures répressives et parfois condamnés à mort.
« Le monde semble peuplé à toutes les époques par des adeptes de la pauvreté volontaire qui louent l’abnégation et pas les apologistes du travail, de l’épargne et de la réussite matérielle, par ceux qui voient dans la miséricorde la vertu suprême. Ce qui change, ce sont uniquement les rapports de force entre ces différentes attitudes. »
Je voudrais terminer cette partie définition, en la rendant encore un peu plus floue. L’abbé Pierre résumait souvent son action par cette phrase : Servir premier le plus souffrant. Il utilisait le singulier et le pluriel. Définition suffisamment large et floue, pour montrer la difficulté. Car le plus souffrant n’est pas forcément le plus démuni. Pour l’abbé Pierre c’était accueillir celui qui souffre, qu’il soit riche ou pauvre. Cela nous donne une grande liberté dans la manière d’accueillir les pauvres. Et nous sommes tous des pauvres, nous avons tous nos fragilités.
Quelques mots enfin sur l’évolution de la pauvreté et de notre regard sur la pauvreté.
Pendant des siècles l’assistance aux plus pauvres a été le fait des communautés villageoises (Moyen-Age), des organisations charitables comme Saint Vincent de Paul et de l’Eglise ou des Eglises. Avec cette idée mise en exergue par François d’Assise l’option privilégiée de l’Eglise pour les pauvres, dont se réclame très fortement le pape François qui a déclaré Les pauvres ne sont pas un problème, ils sont une ressource.
Il faudra attendre les Républicains de la Troisième République à la fin du XIXème siècle pour voir les premières mesures mises en œuvre, on appelle cela les mesures d’assistance aux nécessiteux, le solidarisme tel que l’avait inspiré un député républicain Léon Bourgeois qui place la solidarité comme le fondement du lien social et pour qui le bien-être de tous dépend de la solidarité qui nous lie aux autres.
Autre étape à la Libération, avec l’émergence de l’Etat Providence, ce compromis qui garantit une plus grande sécurité d’existence face aux aléas de la vie et au risque de pauvreté. L’aspiration à l’égalité sociale, anticipée déjà lors du Front populaire, le Conseil national de la Résistance. La protection sociale avec la création de la Sécurité sociale, avec au cœur le travail salarié. Le droit à la protection sociale est fondé sur l’activité professionnelle. A l’époque, l’on pense que par ces dispositifs l’on va éradiquer la pauvreté dans les pays développés. Dans les années 60, le grand défi, c’est la faim dans le monde, un terrien sur trois souffre de malnutrition. Le chômage est résiduel.
Mais dans les années 70, l’on se rend compte que la pauvreté n’a pas été éradiquée, qu’il demeure dans les sociétés riches des poches importantes de pauvreté. Les transferts financiers n’ont pas remis en cause les inégalités structurelles. Le constat est fait par des économistes et des sociologues américains, notamment John K Galbraith, qui constate que 20 % des Américains sont pauvres. « Pourquoi les gens sont pauvres ? Tant chez les individus isolés que dans des groupes importants de ruraux et de citadins, je ne trouvais pas d’explication convaincante de la persistance de la pauvreté dans une situation de bien-être général en progression, je compris pourquoi que plus tard. Selon la tradition économique établie ou néolibérale classique à laquelle je continuais d’être assujetti, la pauvreté, ou quelque chose d’approchant, restait la condition normale de la plupart des gens. »
En France, si les inégalités ont tendance à se réduite, certains dysfonctionnements persistent. Des pans de la société sont remis en cause, on le voit à travers les révoltes paysannes et les grèves des mineurs des années 60.
En 1974, un haut fonctionnaire René Lenoir publie un livre Les exclus, c’est un best-seller, il est vendu à 100 000 exemplaires. Il montre l’inadaptation d’une grande partie de la population française (20 %) des handicapés et des retraités du fait d’un minimum vieillesse très bas.
Après le second choc pétrolier, la donne change. On entre dans la crise, c’est la fin des Trente Glorieuses. Le chômage explose, et la précarité. Changements politiques aussi avec les élections de Mme Thatcher et de M Reagan, avec une nouvelle inspiration économique. Les Keynésiens ceux qui plaidaient pour l’intervention de l’Etat dans l’économie, pour faire vite, depuis le new deal de Roosevelt après la crise de 1929, sont remplacés par les Monétaristes, des économistes très libéraux qui plaident pour la fin de l’état providence, la baisse des interventions de l’Etat, le libre-échange… arrivent au pouvoir. C’est le point de départ d’un désengagement de l’Etat dans les politiques sociales, même si cela mettra plus de temps en France.
Le retour de l’abbé Pierre, l’émergence de nouvelles associations comme les restos du cœur, les banques alimentaires, le Samu social, et puis toute une réflexion autour de cette paupérisation de la société. Il va y avoir un moment important, c’est le vote en 1987 au Conseil économique et social du rapport Wrezinski Grande Pauvreté et précarité économique et sociale. Ce rapport marque une rupture importante dans l’appréhension du problème de l’exclusion. Il tourne la page de l’assistanat, introduit les plus pauvres comme acteurs et partenaires indispensables de la réflexion et établit le lien entre destruction de la misère et respect des droits fondamentaux de l’homme. La pauvreté est considérée comme une atteinte à la dignité de la personne.
« C’est un texte totalement novateur en ceci qu’il fait apparaître la misère comme étant d’abord une violation des droits de l’homme. », écrit Paul Bouchet, ancien président d’ATD Quart Monde
Cela va donner naissance à diverses mesures dont le RMI votée à la quasi-unanimité, la loi sur l’exclusion, la loi Besson sur le logement des défavorisés et la CMU. ATD et Fondation Abbé Pierre.
Et puis à partir du milieu des années 2000, le débat va se crisper. On dénonce l’assistanat. Les sans dents pour un président de la République, e cancer de l’assistanat pour un homme politique, le pognon fou pour l’actuel Président. Et puis ces conflits entre plus ou moins pauvres, entre travailleurs pauvres et immigrés, qui fait les choux gras du Rassemblement National. Le tout sur fond d’aggravation des inégalités, de déclassement d’une grande partie des classes moyennes, de montée de l’individualisme, de fragmentation de nos sociétés, comme le constate Jérôme Fourquet dans L’Archipel français.
La vie de l’abbé Pierre – à l’occasion de l’inauguration de la statue de l’abbé Pierre à Lescar le 8/06/2019
Cette statue de l’abbé Pierre symbolise un phare. Et l’abbé Pierre aura été un phare durant toute sa vie. Il le demeure. Un phare prophétique. Un prophète non au sens religieux du terme, mais dans sa version laïque de visionnaire, dans sa définition sociologique telle que l’exprimait Pierre Bourdieu, en 1993, lors d’une émission de la Marche du Siècle : « Le prophète est un personnage extraordinaire qui surgit dans une situation extraordinaire, lorsqu’en temps de crise, de disette, de pénurie, lorsque les hommes ordinaires, en particulier la prêtrise, ne savent plus quoi dire, le prophète alors parle et dit des choses qui étaient refoulées… L’abbé Pierre est quelqu’un qui prend la parole avec véhémence, avec indignation… ainsi les soirs d’élections, dans l’immense silence bavard, se détache une parole qui dit quelque chose. Il comprend à l’avance des malheurs, et par le simple fait de dévoiler le caché, il anticipe nécessairement ».
Et Dieu sait si l’abbé Pierre a su anticiper.
Au lendemain de la guerre, il pressent l’inéluctable mondialisation et devient président du Mouvement fédéraliste mondial.
Avant la signature du traité de Rome, bien qu’Européen convaincu, il craint que l’Europe alors en gestation ne s’éloigne trop des peuples, qui la composent.
A la fin des années 50, il met le doigt sur la faiblesse des puissants (les Etats-Unis notamment et l’Occident plus généralement) et la puissance des faibles anticipant les événements du 11 septembre 2011, les attentats terroristes.
Au début des années 1960, dans un éditorial de Faim et Soif, , il prédit la crise environnementale et évoque le réchauffement climatique, alors qu’à la même époque, les climatologues évoquaient le début d’une période de refroidissement qui devait s’étendre sur plusieurs millénaires.
Pendant les trente Glorieuses, il prévoit l’émergence des nouveaux pauvres et les phénomènes d’exclusion et d’aggravation des inégalités des décennies suivantes.
En créant les communautés Emmaüs, il apporte un nouveau regard sur la manière d’apporter des solutions à l’exclusion en développant la dimension communautaire (le nous dans la conception personnaliste d’Emmanuel Mounier), la notion d’hospitalité absolue (chère à un autre philosophe Jacques Derrida), la réhabilitation de l’homme par le travail, le respect de la singularité de chacun, le brassage social au début d’Emmaüs, la prise en compte de l’homme dans sa globalité, le refus de l’assistanat et des subventions publiques…
Il résumait Emmaüs ainsi : « C’est une fabrique d’explosifs à base de récupération d’hommes broyés », ajoutant : « Regardez ce que les bons à rien, les plus pauvres types, les plus méprisés, regardez ce que avec des fonds de poubelles, nous avons été capables de faire ». Et l’on ne peut qu’admirer de ce carrefour l’imposant village Emmaüs, ses combats, son projet…
A ces fulgurantes intuitions, l’abbé Pierre mêle l’action. Il a été l’un des premiers, si ce n’est le premier, à vouloir combattre la misère, et à en dénoncer les causes ; en d’autres termes : promouvoir au-delà de la charité chrétienne, la justice, la solidarité et le partage…
Au fil des années et des événements, l’abbé Pierre a été un personnage multiple, parfois homme de paradoxes voire de contradictions :
- Il a été un enfant bricoleur, appelé « Castor méditatif » chez les Scouts et un adolescent plutôt perturbé qui exprime dans ses carnets sa souffrance et ses tourments ;
- Il a été un moine capucin confronté à la pauvreté matérielle et intellectuelle la plus totale ; Son ami d’enfance, François Garbit lui écrit alors qu’il est au monastère de Crest : « Tu me fais peur. Tant d’austérité m’effraie. Non l’austérité physique, mais l’austérité intellectuelle et spirituelle… Comment vivre continuellement sur de si hauts sommets ?»
- Il a été un résistant qui confectionnait de faux papiers pour faire passer les Juifs en Suisse ; Il passera notamment le frère du général de Gaulle, atteint de la maladie de Parkinson, puis sera résistant dans les maquis du Vercors et de la Chartreuse, avant de mettre en place un réseau de résistance vers l’Espagne. Pour cela l’abbé Pierre, son nom de résistant, avait pris comme pseudonyme le nom d’un comique de l’époque, Georges Houdin, et se faisait passer pour un généalogiste, chargé d’étudier les origines de Darquier de Pellepoix, le commissaire aux affaires juives de Vichy…
- Il a été un prêtre aux propos souvent iconoclastes et anticléricaux qui disait sa messe tous les jours à 18 heures, quel que soit l’endroit où il se trouvait, et notamment lorsqu’il était dans un avion ;
- Il a été un député qui a fait de sa maison de Neuilly Plaisance, une auberge de Jeunesse pour accueillir des jeunes européens désorientés après avoir appris l’existence des camps de concentration et des explosions nucléaires d’Hiroshima et de Nagasaki ; Il avait donné à cette maison le nom d’Emmaüs en référence à la désillusion des disciples du Christ, après sa crucifixion ;
- Il a été ce remarquable communicateur, homme du Verbe, homme de radio et de télévision. Son appel sur les ondes de Radio Luxembourg (RTL aujourd’hui) le 1er février 1954, était un modèle du genre et devrait être étudié dans les écoles de sciences de la communication, de journalisme ou à Sciences Po.
- Il a été un Européen convaincu, citoyen du monde et rebelle qui n’hésite pas à franchir les barrières de la légalité, s’il considère que son combat est juste ;
- Il a été un chroniqueur avisé des maux de ce monde, dont on oublie souvent qu’il a créé une revue de grande qualité Faims et Soifs, la voix des hommes sans voix, tremplin dans les années 50 et 60 pour des journalistes qui vont devenir de grandes signatures de la presse comme Jean Lacouture, Jean-Marc Théolleyre qui sera le chroniqueur judiciaire du Monde pendant des décennies, Denis Périer Daville qui sera directeur du Figaro, ou encore François Chalais qui écrira dans Faims et Soifs ses premières critiques cinéma et Piem qui se lancera dans la caricature de presse…
- Il a été un homme politique réformiste, mal à l’aise dans le manichéisme mais qui a su intégrer valeurs morales et spirituelles dans l’engagement politique comme avait pu le faire avant lui un saint Vincent de Paul ou un Robert Schuman, un Gandhi ou un Martin Luther King ;
- Il a été celui qui a convaincu le général de Gaulle d’adopter le statut d’objecteur de conscience ;
- Il a été un homme de dialogue aussi à l’aise avec les chiffonniers qu’avec les grands de ce monde. Il a été l’ami d’Albert Schweitzer et de Dom Helder Camara, de Robert Buron et de Jacques Delors, d’Albert Jacquard et de Théodore Monod ; il a admiré Robert Schuman et Pierre Mendès France, moins Charles de Gaulle ; il a travaillé avec Lord Beveridge, le fondateur de la sécurité sociale en Grande Bretagne, et Josué de Castro, un médecin brésilien, premier président de la FAO ; il a rencontré Nehru et Albert Einstein ; Charlie Chaplin lui a remis la moitié de la somme qu’il avait reçue du prix des partisans de la paix ; Il était proche de Yasser Arafat et de Shimon Pérès ;
- Il a été un créateur boulimique, un lanceur d’idées qui a créé en France les boutiques alimentaires et Artisans du monde ; Et même l’on peut dire qu’ATD Quart Monde est né au sein de la cité de Neuilly. L’abbé Pierre avait fait appel à l’évêque de Soissons pour lui trouver un prêtre qui puisse venir l’aider. Ce prêtre, c’était le père Joseph Wrezinski. Mais ces deux fortes personnalités auront du mal à s’entendre et le père Joseph créera ATD Quart Monde. De même lorsque Coluche, qui avait été aidé pendant ses années de galère par l’association Emmaüs de Paris, lancera les Restos du Cœur, il tentera de s’associer avec l’abbé Pierre, mais les proches de l’abbé ne permettront pas la rencontre. A la fin de la première année des Restos du Cœur, Coluche, juste avant son décès accidentel, apportera le reliquat à l’abbé Pierre, qui présidera les obsèques religieuses de l’humoriste, quelques jours plus tard…
- Il a été un solitaire passionné de montagne et de désert qui prisait aussi les assemblées et les plateaux de télévision ;
- Il a été en même temps ce globe-trotter qui avait effectué de nombreuses fois le tour du monde, ce mystique qui aimait contempler les étoiles, et cet artiste qui écrivait des poèmes, peignait, sculptait, et faisait de la photographie :
Et j’en passe dans cette vie si riche et si dense, diversifiée à l’extrême qui semble voguer au gré des rencontres, des événements et des hasards. « La vie n’est pas un rêve, aimait-il à répéter, ni un plan d’homme ; elle est plus un consentement qu’un choix… La seule liberté de l’homme, c’est de tenir la voile tendue, ou de la laisser choir ».
Et pourtant cette vie n’était-elle pas programmée dès l’adolescence ? A 15 ans, le jeune Henry Grouès s’interroge dans ses carnets intimes sur son destin : vie contemplative à la François d’Assise, ou engagement à la Napoléon. Oh quel orgueil ! ajoute-t-il ! En d’autres termes : le monastère ou l’action publique, la grotte ou le peuple ? Peut-être les deux car se succèdent au fil des années, retraites mystiques et engagements publics, vie contemplative et activisme politique remuant. Et quand il choisit l’un ou l’autre, l’abbé Pierre ne fait pas dans la demi-mesure, c’est passionnément et jusqu’à l’extrême, quitte à vivre ces moments douloureusement, qu’il s’agisse de ces six années de profonde solitude passées chez les Capucins ou de ce fameux Hiver 54, éprouvant tant physiquement que mentalement, jusqu’à la maladie, jusqu’à la dépression.
Tel est le destin de ce jeune garçon qui, depuis l’âge de huit ans, voulait mourir, mais vécut passionnément jusqu’à 95 ans ; tel est le destin de ce jeune garçon qui répondait à une dame lui demandant ce qu’il voulait faire plus tard : je serai marin, missionnaire ou brigand. En fait il aura été les trois : marin en tant qu’aumônier de la marine à la Libération, missionnaire à travers toutes les communautés Emmaüs de par le monde, brigand pendant la Résistance.
Jusqu’à la fin de sa vie, il aura gardé ce contact étroit avec la jeunesse. Son dernier écrit était une préface d’un livre qui s’adressait aux jeunes. Je me souviens qu’une des premières fois que je l’avais rencontré pour le livre Les combats d’Emmaüs, il avait affiché sur la porte de sa chambre ce papier manuscrit : « Ici se trouve un gosse de 84 ans et demi, en grandissant il devient paresseux. Ne lui en demandez pas trop… Merci ». Preuve qu’il avait aussi de l’humour.
Aujourd’hui, face aux événements qu’il s’agisse des migrants, du réchauffement climatique, des inégalités grandissantes ou de la montée des populismes, je me dis souvent que sa voix nous manque, tant il savait exprimer mieux que personne le refoulé, tant il savait s’adresser au cœur des gens. Sa voix, la voix des hommes sans voix, nous manque, comme nous manquent ses impatiences et ses insolences, ses colères et ses entêtements, son franc-parler et son indiscipline, son côté parfois cabotin et gaulois, sa capacité à imposer aux politiques un calendrier, sa jouissance à parfois défendre des brigands et à déstabiliser les puissants, et sa profonde humanité…
Couleurs d’Europe
Dès avant la création du Marché Commun, en 1955, le Conseil de l’Europe annonçait la couleur avec son drapeau cerclé de douze étoiles d’or, pour exprimer les idéaux d’unité, de solidarité, d’harmonie entre les peuples européens, sur fond bleu azur, depuis longtemps la couleur préférée des Européens. Le bleu du ciel et de la mer, le bleu de paix (Casques bleus), le symbole de rêve, de plénitude, de perfection. Couleur emblématique de la monarchie (le sang bleu), des Romantiques (l’amour fleur bleue), le bleu est associé au culte marial dans le catholicisme. Pour l’anecdote, à défaut de la reconnaissance des racines chrétiennes de l’Europe, l’on saura plus tard qu’Arsène Heitz, fonctionnaire au Conseil de l’Europe et concepteur du drapeau, s’était inspiré d’une médaille des Petites Sœurs des Pauvres ! En 1986, le drapeau bleu étoilé deviendra l’emblème des Communautés européennes.
Et pourtant l’histoire de la Communauté européenne est d’abord marquée par la couleur verte, celle des champs printaniers, des prés et des forêts, avec un Marché Commun qui se construit autour de la Politique agricole commune, alors seule politique intégrée, avec le tarif douanier commun. La PAC représente 80 % du budget communautaire. Il en sera ainsi jusqu’au milieu des années 1980, date des premières remises en cause avec des organisations de marché minées par les excédents et les montants compensatoires monétaires. Puis la mondialisation s’impose, en même temps que les théories libérales qui ne siéent guère avec les contraintes de l’économie agricole et qu’émergent les préoccupations environnementales. Si bien que le vert « champêtre » des paysans européens est de plus en plus concurrencé par le vert « nature » des écologistes. Le dernier scrutin a « verdi » un peu plus le Parlement européen, avec le succès des listes écologistes, mais aussi parce que d’autres sensibilités ont affiché haut et fort leur souci de l’environnement. Reste à faire en sorte que ces nuances de vert champêtre et vert nature se comprennent et se respectent !
Une Europe vieillissante
Lorsqu’en 2016 il était venu à Strasbourg s’adresser aux parlementaires européens, le pape François avait évoqué, cette « Europe grand-mère, non plus féconde et vivante ». L’Europe qui devrait avoir la soixantaine frétillante ne séduit plus vraiment. On nous annonce une abstention record. Pourtant, née sur les décombres de deux guerres mondiales, elle avait suscité l’espérance de beaucoup en un monde de paix, plus solidaire et fraternel. Aujourd’hui la flamme semble flétrie.
Il faut dire qu’en six décennies, cette grand-mère a multiplié les occasions de prendre des rides. D’abord l’intégration des Britanniques dont les gouvernants successifs n’ont cessé de freiner les ardeurs des autres ; les crises pétrolières des années 1970, l’inflation et le chômage qui s’ensuivirent, et cette tentation récurrente des gouvernants de mettre sur le dos de Bruxelles la rigueur budgétaire ; dans les années 1980, les élections de R Reagan et de M Thatcher et la mise en place de politiques libérales vont miner les fondements keynésiens de la construction européenne, – la PAC, en particulier -, que la mondialisation accélérée des années 1990 achèvera. En 1989, la chute du Mur de Berlin modifiera les équilibres subtils, avec un renforcement de la puissance de l’Allemagne, que les élargissements vers les pays de l’Est consolideront. Le marché unique puis l’Euro ne suffiront pas à enrayer cette évolution, pas plus que le scepticisme grandissant des Européens. D’ailleurs en passant, en 1992, de Communauté à Union européenne, l’Europe semblait oublier la part de fraternité qui présidait à l’élaboration du Traité de Rome. Plus tard la crise financière de 2008 montrera les limites de la solidarité, que l’arrivée de migrants ne fera qu’accentuer, dans une Europe plus tentée par la construction de murs que de ponts, sous la pression de puissants mouvements populistes ou souverainistes. Et puis, pour couronner le tout : le Brexit, avec ce paradoxe que les Britanniques vont élire des parlementaires européens !
Que d’incohérences et pourtant, face aux enjeux géopolitiques et environnementaux vitaux, on a plus que jamais besoin d’Europe…
De la difficulté de dialoguer
Notre société médiatico-politique est ainsi faite. Quoi que dise, quoi que décide le chef de l’Etat (quel qu’il soit d’ailleurs), l’on retrouve à chaque fois le même scénario. La conférence de presse de jeudi dernier n’échappe pas à la règle, avec des macronistes enthousiastes, des opposants de droite et de gauche campant sur leur posture, des gilets jaunes toujours aussi rebelles, sur fond d’une France de plus en plus fragmentée et, qui a vu s’étioler ses références culturelles communes, comme l’a montré récemment le politologue Jérôme Fourquet dans son livre L’Archipel français. Comme si, pour ceux qui sont au pouvoir ou qui veulent y accéder, l’objectif premier étant de conforter son noyau politique, atteindre les 25 % de suffrages exprimés pour s’imposer ensuite. On est loin du désir de Valéry Giscard d’Estaing à la fin des années 1970 de rassembler deux Français sur trois, même si, à l’époque, il n’a guère convaincu.
Le Grand Débat n’a donc pas permis d’établir un vrai dialogue au sens philosophique du terme, à savoir produire un diagnostic intégrant les arguments des uns et des autres en vue d’élaborer une conclusion où chacun puisse se retrouver. Avec pour objectif final de fixer un cap partagé par le plus grand nombre. Cet épisode me rappelle un livre iconoclaste publié en 1995, et ô combien d’actualité !, par le sociologue Michel Crozier : La crise de l’intelligence : essai sur l’impuissance des élites à se réformer. L’auteur de La Société bloquée en appelait à une révolution intellectuelle, dénonçant les grands corps et les grandes écoles à la formation contre-productive, car préparant plus à la réussite personnelle qu’aux responsabilités. Il évoquait la suppression de l’ENA, mais n’y croyait guère, et considérait qu’une réforme bien conduite s’appuyant sur l’écoute des acteurs permettait de transformer les mentalités et le système. C’était au siècle passé, une éternité !
Hommage à Notre-Dame
« Tous les yeux s’étaient levés vers le haut de l’église. Ce qu’ils voyaient était extraordinaire. Sur le sommet de la galerie la plus élevée, plus haut que la rosace centrale, il y avait une grande flamme qui montait entre les deux clochers avec des tourbillons d’étincelles, une grande flamme désordonnée et furieuse dont le vent emportait par moments un lambeau dans la fumée… » Prémonitoire, cet extrait de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, publié en 1831. L’auteur des Misérables ne pouvait imaginer l’immense émotion des spectateurs du monde entier, croyants et incroyants, Français et Etrangers, face à cette cathédrale, témoin d’éternité et de fragilité, qui partait en flamme. Tous émus, unis comme par un deuil, tant Notre-Dame, haut-lieu de célébration monarchique sous l’Ancien Régime avant de promouvoir sous la Révolution le culte de la raison, incarnait l’histoire religieuse et l’Histoire, tout court : du sacre de Napoléon aux obsèques officiels de Charles de Gaulle, Georges Pompidou et François Mitterrand, sans oublier le Te Deum de la Victoire de 1918 et celui de la Libération de Paris, en 1944.
Mais cette cathédrale comme les 87 autres de l’Hexagone ne reflète pas seulement l’histoire de l’urbanité. Car comme le notait, dans Le Temps des cathédrales, l’historien Georges Duby, qui voyait dans les sculptures des bœufs placées au sommet des tours d’un autre joyau du gothique, la cathédrale de Laon, comme un hommage rendu au travail rustique : « L’art urbain, l’art des cathédrales a puisé dans les campagnes proches le principal aliment de sa croissance et ce furent les efforts des innombrables pionniers… qui, dans les succès d’une immense conquête agricole, le portèrent à son accomplissement ». En premier lieu, cette charpente de Notre-Dame constituée de 1 300 chênes vieux de plus de 900 ans.
Mais pour un chef d’œuvre meurtri suscitant tant de compassion et de générosité, combien d’églises en péril (parfois de petits joyaux) oubliées dans nos villages !
Des céréales et des hommes
Le regard porté par les anthropologues sur le néolithique a beaucoup changé au cours des dernières années. La dernière contribution en date est celle de James Scott, un politologue américain de 83 ans, ancien professeur d’anthropologie à Yale, par ailleurs propriétaire d’une ferme où il élève poules, moutons, vaches et abeilles, qui propose, dans son livre Homo Domesticus – une histoire profonde des premiers Etats, une relecture de cette période, rompant avec ce qu’il appelle « le récit civilisationnel standard » d’une révolution néolithique, – marquée par l’invention de l’agriculture, la sédentarité, les premières villes, la spécialisation des tâches, l’écriture, puis la constitution des premiers Etats et l’émergence de la civilisation -, et considérée comme facteur de progrès. « Le passage de la chasse et de la cueillette à l’agriculture a apporté au moins autant d’inconvénients que d’avantages », écrit James Scott. Sans tomber dans l’image du bon sauvage, il constate que les chasseurs cueilleurs maîtrisaient des techniques agricoles complexes, travaillaient beaucoup moins (3 à 5 heures par jour), mangeaient plus diversifié et étaient moins victimes de famines et d’épidémies.
L’apport original de cet ouvrage est de montrer comment les céréales vont s’imposer de manière hégémonique dans le paysage agricole, du fait notamment de la progression démographique, et jouer un rôle essentiel dans la création des premiers Etats (vers 3200 avant J.C. en Mésopotamie) assurant protection en échange d’un contrôle des richesses par le biais de l’impôt. Le blé, produit mesurable, visible et se conservant aisément (contrairement à la pomme de terre et aux légumineuses), est en effet une base fiscale idéale pour prélever l’impôt. Et c’est bien là le problème, pour James Scott, auteur d’un Petit Eloge de l’anarchisme, qui voit dans ces Etats avant tout une source de servitude et d’insécurité. Au point que, tout au long de la lecture de ce livre passionnant et à l’érudition impressionnante, l’on se demande qui, de l’homme ou du blé, a domestiqué l’autre.
Homo Domesticus – une histoire profonde des premiers Etats – La Découverte – 279 pages – 23 € – janvier 2019.
Le Grand Débat…
Je n’en fais pas un titre de gloire mais depuis que j’en ai le droit (et le devoir ?), j’ai participé à tous les scrutins. Alors, me dis-je, dans cet élan citoyen, pourquoi ne pas apporter ma pierre au Grand Débat National. Après tout, c’est une expérience nouvelle qui ne se représentera peut-être pas de sitôt, surtout si la montagne accouche d’une souris ! L’on m’a dit que cela prenait dix minutes. Je vous passe les déboires du net (par ma faute !) qui me prennent plus de cinq minutes, avant d’attaquer les quatre grands chapitres : transition écologique, fiscalité et dépenses publiques, démocratie et citoyenneté, organisation de l’Etat et des services publics. L’exercice est frustrant, ne laisse guère de place, entre le oui et le non, à la nuance et à la subtilité. Sans parler des questions qui vous mettent mal à l’aise comme celle-ci : « Dans quel domaine faut-il faire des économies ? » Le questionnaire décline les différents secteurs : l’éducation et la recherche (pas question, c’est notre futur !), la défense (on est dans un monde tout de même dangereux !), la sécurité (pour les mêmes raisons que la défense), le social (tant d’inégalités !), l’environnement (vu l’état de la planète !), le logement (il suffit de lire le rapport de la Fondation Abbé Pierre)… Il ne cite pas la justice, la culture, l’agriculture ou la santé (là aussi pas touche !). Reste la case autre, mais là je sèche, avant de répondre : fonctionnement de l’Etat ! Peut-être un peu facile ! Si gouverner c’est choisir, je serai sans doute un piètre politique. A la fin, j’espère ajouter mes petites doléances personnelles, exprimer dans un espace de liberté, mon cri du cœur ou mon coup de colère, mais l’exercice est réservé aux cahiers de doléances dans les mairies ou aux réunions locales. Mais voilà, dans mon désert, pas de réunions locales dans un rayon de vingt kilomètres, ni cahier de doléances dans mon village, le maire justifiant son refus par le mépris (passé !) du chef de l’Etat à l’égard des maires…
En quête d’immortalité ?
En 1976, l’intellectuel Emmanuel Todd, surpris par la hausse du taux de mortalité infantile en URSS, – évolution unique dans un pays industrialisé-, avait prédit dans un livre La Chute finale, la décomposition de l’empire soviétique, quinze ans avant l’éclatement de l’URSS. Il est des indicateurs statistiques qui en disent long sur les évolutions voire les ruptures de nos sociétés. La semaine dernière, l’INSEE publiait son bilan démographique de la France, avec ce constat d’un plafonnement depuis quatre ans de l’espérance de vie des Français, alors que, durant tout le XXème siècle, l’espérance de vie pour les hommes est passée de 45 à 74 ans et pour les femmes de 49 à 82 ans, soit trois mois d’espérance de vie gagnés chaque année. Pour remonter plus loin dans le temps, l’espérance de vie d’un paysan au Moyen-Age ne dépassait pas les 30 ans. Malgré ce plafonnement qui concerne la plupart des pays développés, la France demeure plutôt bien placée (79,4 ans pour les hommes et 85,3 ans pour les femmes), mais elle fait moins bien dans l’espérance de vie en bonne santé.
Alors, ce plafonnement, une rupture ou la reconnaissance que l’on approche de nos limites biologiques ? Sans doute des progrès médicaux, comme vaincre le cancer, permettraient de franchir un nouveau palier, avec quelques années de vie supplémentaires. Loin toutefois des espoirs des mouvements transhumanistes, (- marginaux hier, mais désormais soutenus par de très grandes entreprises) qui, en voulant accroître les capacités de l’homme par les technologies, espèrent prolonger considérablement la durée de vie, voire rêvent d’immortalité. Signe que nos sociétés techniciennes, qui ont désacralisé la mort, acceptent de moins en moins la finitude humaine. « L’éternité, c’est long… Surtout vers la fin », écrivait Franz Kafka, tandis qu’Oscar Wilde conseillait : « Il ne faut pas chercher à rajouter des années à sa vie, mais plutôt essayer de rajouter de la vie aux années ».
Laboureur, cultivateur, agriculteur, céréalier ou éleveur : ce que l’évolution des mots nous dit de l’évolution de la société française
Le Salon de l’agriculture ouvre ses portes ce samedi 23 février à Paris. L’occasion pour Atlantico de revenir sur les évolutions du métier, qui se sont traduites par des évolutions sémantiques.
Avec Denis Lefèvre
Atlantico : Au début du XXème siècle, on ne parlait pas d’agriculteur sur son état civil, mais de cultivateur. Quelles différences soulève-t-on quand on constate le passage de la dénomination de cultivateur à celle d’agriculteur ?
Denis Lefèvre : Au cours de la deuxième moitié du XVIIIème siècle, le terme de cultivateur a pris la place de laboureur, dans le sens de celui qui exploite la terre. Avec la révolution silencieuse qui a vraiment débuté dans les années 1960, le terme d’agriculteur a remplacé celui de cultivateur. Aujourd’hui, d’ailleurs, dans la profession agricole, l’emploi du mot cultivateur correspond à un matériel réalisant un labourage superficiel. Toutefois depuis quelques décennies, du fait de la spécialisation accrue des exploitations, c’est souvent la production dominante qui détermine la dénomination de l’agriculteur : on parle du céréalier ou du producteur de betteraves, de l’éleveur laitier ou du producteur de viande bovine… A noter aussi, que pendant très longtemps le terme de paysan souvent considéré comme déshonorant voire insultant par la monde agricole, a retrouvé une connotation moins négative depuis les années 1990, car il définit bien à la fois le rôle de l’agriculteur dans la vie d’un pays et la construction de paysages, au-delà de la seule production agricole, et les enjeux contemporains à travers ce triptyque : Pays, Paysans, Paysages.
Le métier de producteur agricole en lui-même a connu de très importantes transformations ce dernier siècle. Outre l’introduction de technologies de pointe, qu’est-ce qui a radicalement changé pendant ces dernières années ?
Les transformations ont été considérables depuis la fin de la seconde guerre mondiale. En à peine trois générations, l’agriculture a connu une transformation plus considérable qu’entre la naissance de l’agriculture il y a dix millénaires dans le Croissant fertile, et la seconde guerre mondiale. Des bouleversements à différents niveaux. Démographiques d’abord, on est passé de plus de 4 millions d’actifs en 1945 à à peine plus de 400 000 aujourd’hui. Bouleversement sociologique : on est passé d’un monde encore majoritairement rural à un monde urbanisé. Bouleversements technologiques : une vache donnait 1 200 litres de lait par lactation au début des années 1950 et produit aujourd’hui plus de 10 000 litres, tandis que des années 1960 aux années 1990, le rendement en céréales augmentait d’un quintal par an. Bouleversement professionnel : on est passé de l’état paysan au métier d’agriculteur, de l’exploitation familiale vivant en quasi autarcie à des structures juridiques nouvelles et très diversifiées.
Au cours de ces dernières années ces évolutions se sont encore accentuées. Et le monde agricole qui, malgré de fortes disparités, connaissait une certaine homogénéité jusqu’à il y a deux ou trois décennies est un secteur de plus en plus éclaté et désarticulé, avec comme extrême une agriculture de firmes qui obéit à des logiques financières transnationales, sous-traitant parfois l’ensemble des travaux agricoles, et d’autres formes d’agricultures alternatives souvent menées par des acteurs non issus du monde agricole.
Cela peut-il expliquer la crise que connaît aujourd’hui une grande partie du monde agricole français ?
Sans aucun doute. Aujourd’hui les chefs d’exploitation représentent 1,8 % de la population active française. Une évolution unique, pour un secteur qui a été longtemps majoritaire dans la société française. D’où cette crise d’identité, cette crise culturelle au-delà de la crise sociale, qui se traduit à travers trois indicateurs :
Le refus de l’Europe : après avoir été les pionniers de la construction européenne, les agriculteurs ont été la catégorie socioprofessionnelle qui a voté le plus contre la ratification des traités européens (Maastricht et le traité constitutionnel) ;
Le vote Front national qui ne cesse de croître au sein d’une population longtemps rétive aux idées extrémistes ;
Et enfin plus tragiquement, avec un taux de suicide supérieur aux autres catégories socioprofessionnelles.
Disparition du lien entre famille et exploitation, problèmes de transmission, grande diversité des situations, marginalisation à la fois démographique, économique, sociale, culturelle, contribuent à cette perte de repères. O combien révélateur, le développement du thème de l’agriculture urbaine témoigne de cette perte de repère. Il y a un siècle, Alphonse Allais voulait mettre les villes à la campagne parce que l’air y était de meilleure qualité. Aujourd’hui l’agriculture urbaine se veut être un facteur de lien social dans les villes, tandis qu’à la campagne le lien social a tendance à se déliter.
Qui plus est dans un contexte de plus en plus complexe, aux logiques souvent contradictoires, l’agriculture apparaît à contre-courant du monde d’aujourd’hui : à savoir une activité qui demande du temps long dans un monde qui s’accélère de manière vertigineuse ; une activité sédentaire dans une monde qui se nomadise ; une activité ancrée dans les territoires au sein d’un monde globalisé fonctionnant en réseau, une activité très en lien avec le vivant dans un monde de plus en plus digitalisé.
Et pourtant, dans le même temps, l’agriculture se situe au cœur des grands enjeux de la société : enjeux environnementaux (changement climatique, biodiversité, eau, dégradation des sols), enjeux éthiques avec les nouvelles technologies du vivant, enjeux de santé publique, de territoires et de géopolitique, mais aussi de qualité de vie à travers la gastronomie et les paysages.
Le dernier lieu où l’on cause…
Entendue cette semaine à la radio, cette information à propos de travaux réalisés par des chercheurs américains pour tenter de découvrir les recettes en vue de « fabriquer » un best-seller. Pour cela ils utilisèrent un millier d’ordinateurs pour analyser et comparer les grands succès de librairie, niant ainsi la part d’irrationnel dans l’histoire d’un livre ! Que sera notre humanité, lorsqu’il n’y aura plus que des best-sellers conçus par algorithmes ? Déjà que la tendance est à la concentration des ventes autour de quelques dizaines d’ouvrages, sur les 80 000 parutions annuelles !
Cette diversité éditoriale, je l’ai retrouvée samedi dernier dans la petite librairie de Château-Thierry qui m’avait invité pour une séance de dédicaces. Chaque librairie est unique, – celle-ci, par le contexte local, honore le fabuliste Jean de La Fontaine et les ouvrages sur le Champagne et la Grande Guerre -, mais toutes les librairies de France et d’ailleurs ont en commun d’être de riches lieux d’échanges.
Ce jour-là, un ancien brigadier de gendarmerie, une professeure d’allemand à la retraite, des dames qui trouvent dans les livres le meilleur remède contre la solitude, des agriculteurs et des édiles de la ville… échangent sur la disparition des services publics dans les campagnes, les difficultés du commerce de proximité, ou des rapports tumultueux entre agriculteurs et chasseurs, lorsqu’entre dans la librairie une jeune adolescente, accompagnée par son père. Elle a effectué dans cette librairie un stage d’une semaine, et apporte pour remercier de l’accueil une boîte de chocolats à la libraire qui s’empresse de les partager avec les clients.
Dans ce monde, obnubilé par le digital, qu’une collégienne choisisse d’effectuer un stage dans le monde des livres me réconforte quant à l’avenir de l’humanité et me fait oublier cette information sur la fabrication de best-sellers. « Une bibliothèque, c’est le carrefour de tous les rêves de l’humanité », écrivait Julien Green. On peut le dire aussi d’une librairie.
La campagne, pour se reconstruire
Alors que vient de se terminer le Festival de la bande dessinée d’Angoulême, permettez ce coup de cœur pour l’album Les Grands Espaces de Catherine Meurisse. L’auteure, ancienne caricaturiste à Charlie Hebdo, avait échappé à la tragédie en arrivant en retard. Depuis, elle a mis de côté le dessin de presse pour les albums. Son dernier, Les Grands Espaces, raconte de manière drôle et poétique, et avec profondeur et sensibilité, son enfance dans la campagne des Deux-Sèvres, là où a germé sa vocation de dessinatrice. A sept ans, elle sauve les vieilles pierres, crée avec sa sœur un musée des objets trouvés dans la terre, comme Pierre Loti, s’adonne au jardinage, rêve de grands arbres qui donnent ce sentiment d’éternité, imagine un nouveau Versailles, fait d’un nain de jardin son confident. « Le mot le plus employé à la maison était sans doute bouture », écrit-elle. On y observe aussi les grandes transformations des campagnes : la fin des haies, le remembrement, puis le retour de quelques haies mais avec des espèces moins bien adaptées.
Dans cet album, se mêlent nature et culture, littérature et botanique, avec le rosier qui vient de chez Montaigne ou le figuier qui vient de chez Rabelais, le platane appelé Swann, en référence à Marcel (Proust) qui, dans A la recherche du temps perdu, écrit : « Le seul véritable voyage, ce n’est pas d’aller vers de nouveaux paysages, mais… de voir avec d’autres yeux ». Et notamment le regard des peintres sur la nature (les arbres de Corot, les buissons de Fragonard, les haies de Watteau…) que l’auteure découvre lors d’une visite au Louvre et qui sera à l’origine de sa vocation de dessinatrice. Après la tragédie de Charlie Hebdo, elle a eu besoin de ce retour aux sources, consciente que la nature (comme l’art) peut aider à vivre et que la campagne peut contribuer à se reconstruire. « La campagne sera votre chance », avait d’ailleurs dit la mère de Catherine Meurisse à ses deux filles.
Emmaüs, pionnier de l’économie circulaire
Le mouvement Emmaüs a dès l’origine lutté contre le gaspillage, à contre-courant des trente glorieuses, mais anticipant les comportements aujourd’hui de bon nombre de nos contemporains, de plus en plus nombreux, vers plus de sobriété.
En créant, il y a 70 ans le mouvement Emmaüs, l’abbé Pierre et ses premiers compagnons se sont montrés prophétiques sur bien des points, liant notamment lutte contre l’exclusion et lutte contre le gaspillage, en proposant de refaire une santé dans un cadre communautaire à des personnes que la société a exclues et en leur faisant retaper des objets dont cette même société ne veut plus. A l’époque, l’urbanisation génère de nouvelles habitudes avec la consommation de masse. L’on découvre les déchets, les plastiques et la poubelle. Dans ce contexte Emmaüs va jouer un rôle de pionnier dans les techniques de la récupération et du recyclage inventant le tri sélectif dès les années 1960, anticipant avec le bric-à-brac l’explosion des vide-greniers et des brocantes, puis des boutiques vintage et du e-commerce version le bon coin, et concevant l’économie circulaire, bien avant que les grandes entreprises ne s’y intéressent.
Tous ces éléments demeurent dans l’ADN du mouvement Emmaüs en France comme dans le monde. C’est notamment le cas au village Emmaüs Lescar Pau, la plus grande communauté Emmaüs de France, qui, sous la houlette de son fondateur et actuel responsable, Germain Sarhy, n’a pas cessé d’innover au cours des dernières décennies. La création en 2008 d’une recyclerie-déchetterie liée à la Communauté d’agglomération de Pau a permis le développement d’autres activités. Aujourd’hui, avec plus de 100 000 passages par an, (le samedi, ce sont entre 400 et 600 voitures), Emmaüs Lescar Pau recycle bon an mal an plus de 80 % des 85 000 tonnes de déchets apportés. Ce qui, du point de vue environnemental, permet d’éviter le rejet de 6 030 tonnes de CO2 dans l’atmosphère et donc de limiter d’autant les effets du changement climatique. Des objets en tous genres, des meubles de tous styles, des vêtements de toutes tailles seront réparés, restaurés dans les 27 ateliers que compte le village. Quant aux déchets verts, gravats et autres encombrants, ils seront recyclés dans le cadre de partenariat avec différentes entreprises régionales. L’objectif étant à terme de recycler 100 % de déchets.
Au cœur de l’économie locale et régionale, Emmaüs Lescar Pau compte rien que pour le recyclage plus de 160 partenaires revendiquant une stratégie gagnant/gagnant, comme le reconnaissait le maire de Lescar, Christian Laine : « Nous avons deux déchetteries sur la ville ; l’une, gérée par un syndicat, qui nous coûte de l’argent. L’autre, gérée par Emmaüs, qui ne nous coûte rien. »
Au-delà de la gestion des déchets, le village Emmaüs Lescar Pau a aussi innové dans d’autres secteurs comme l’éco-construction, avec l’édification de maisons en bois pour les compagnons ou encore, dans le souci de lutter contre le réchauffement climatique, de protéger la biodiversité et de défendre l’agriculture durable, avec la création d’une ferme alternative qui s’étend sur une trentaine d’hectares de terres et de prés, et permet une forte autonomie alimentaire (de 50 % pour les fruits et les légumes à 80 % pour la viande). Près de 200 repas sont pris chaque midi au réfectoire, sans compter le restaurant, et l’épicerie qui valorise les spécialités locales. Depuis peu, un atelier de transformation et de conserves et une boulangerie sont venus renforcer cette stratégie d’autonomie alimentaire.
Le village Emmaüs de Lescar-Pau qui a prospéré sur la folie consumériste tout en promouvant une forme de sobriété heureuse, chère à Pierre Rabhi, est devenu au fil des années un lieu de ressourcement créatif, qui accueille plus d’un millier de chineurs quotidiennement. C’est aussi un lieu futuriste d’échanges et de diversité, de rencontres et de convivialité, qui permet tout à la fois de déposer des déchets à la déchetterie-recyclerie, fouiner au bric-à-brac, se promener dans la ferme alternative, visiter les ateliers et, éventuellement, s’initier aux premiers rudiments de certains métiers, déjeuner au restaurant ou pique-niquer au milieu des animaux de la ferme, découvrir l’architecture originale du village avec comme perspective la magnifique chaîne des Pyrénées, s’offrir une petite crêpe, si l’on a un creux à l’estomac, ou boire une bière au bar, se distraire en écoutant un concert ou se cultiver lors d’une conférence débat sur les abeilles, la biodiversité, l’altermondialisme, la Palestine ou le changement climatique…
SOS médecins de campagne
Actuellement la chaîne parlementaire diffuse un émouvant documentaire : « Derniers jours d’un médecin de campagne ». Le réalisateur, Olivier Ducray, a filmé pendant onze mois un médecin généraliste de 69 ans, Patrick Laine, installé depuis 35 ans dans un bourg de 800 habitants en Haute-Saône. Médecin de famille, passionné par son métier, très investi et dévoué, mais usé, il considère que le savoir-faire, la technique et l’expérience sont importants, mais place avant tout les qualités humaines comme la capacité d’écoute ou l’empathie comme primordiales. « On soigne un être humain, dit-il, les spécialistes soignent un organe ». Depuis plusieurs années, Patrick Laine se cherche un successeur. Début 2016, il a publié sur le Bon Coin une annonce où il propose de céder gracieusement son matériel et sa patientèle. Cette initiative a suscité l’intérêt des médias, mais ne lui a pas permis de trouver un successeur. En fait il lui en faudrait deux !
Le monde rural n’attire guère les médecins. Un tiers des communes sont considérées comme des déserts médicaux et le film permet de découvrir la détresse des patients les plus fragiles. Les généralistes sont de moins en moins nombreux et, dans les dix ans à venir, plus d’un quart d’entre eux partira à la retraite. Le numérus clausus qui ne sert à rien du fait de la libre circulation des médecins en Europe, avec une sélection basée sur les maths et la physique, qui fait que 85 % des étudiants échouent en première année, n’arrangent pas la situation. Quant aux mesures prises pour inciter les généralistes à s’installer dans les déserts médicaux, elles n’ont guère eu d’effet. Alors on évoque comme l’une des solutions la télémédecine, consultation à distance utilisant les techniques de l’information et de la communication, mais tellement à l’opposé de cette médecine si humanisée pratiquée par Patrick Laine, qui déclare dans ce film : « A la poignée de main et au regard, dans 70 % des cas, j’ai le diagnostic. »
2019, année de la modération ?
En décembre 2017, l’assemblée générale de l’ONU adoptait, malgré l’opposition des Etats-Unis et d’Israël, une résolution déclarant 2019 année internationale de la modération. L’objectif des initiateurs étant de faire mieux entendre les voix des modérés par la promotion du dialogue, de la tolérance, de la compréhension et de la coopération plutôt que celles des extrémistes violents. En ces temps, où semblent prévaloir un peu partout sur la planète des positions qui ne font guère dans la nuance, cette résolution apparaît presque comme une provocation. Pour autant, l’année 2019 sera-t-elle plus modérée que 2018 ? Nul ne le sait, même si l’on peut penser qu’au niveau climatique, les bouleversements entamés depuis quelques décennies ne vont pas cesser d’un coup de baguette magique ou qu’en matière de géopolitique le ciel diplomatique n’a guère de chance de se montrer plus clément. Dans son homélie de Noël, le pape François prônait lui aussi une forme de retenue devant cette « insatiable voracité des hommes », qui fait que « quelques-uns se livrent à des banquets tandis que beaucoup d’autres n’ont pas de pain pour vivre ».
Car cette résolution onusienne s’adresse aussi à chacun d’entre nous. Sur les réseaux sociaux, des milliers de modérateurs passent leur temps à nettoyer le web des textos les plus outranciers et haineux écrits par nos contemporains. Et lorsque les autorités décident d’une baisse de la vitesse automobile sur les routes secondaires, cela suscite une levée de boucliers. Plus que jamais, nous avons besoin de circonspection, de sagesse et de pondération, dans ce monde plein d’incertitudes. En cette année 2019 qui commémorera la mort, il y a 400 ans, de l’agronome Olivier de Serres, prenons exemple sur cet honnête homme de la Renaissance, protestant en ces temps de guerres de religion, érudit modernisateur de l’agriculture et homme de tempérance. « La modération est la santé de l’âme », écrivait La Rochefoucauld dans ses Maximes.
Et même leurs clochers se taisent…
Tel est le titre d’un livre publié en 1991 et écrit par Louis Costel, prêtre normand et écrivain régionaliste décédé en 2002, qui s’inquiétait de ce temps qui lui semblait proche, où « les clochers apparaîtraient comme de simples bornes commémoratives ». Dans la paroisse où je vis, dans le sud de l’Aisne, la population d’environ 4 000 habitants est répartie sur 17 villages dont deux bourgs plus importants, où alternaient les messes dominicales. Depuis quelques mois, le diocèse a décidé qu’il n’y aurait plus qu’un seul lieu pour la messe dominicale, à la manière dont l’administration décide de fermer certains services publics. Comme d’autres régions rurales, cette zone est devenue un désert spirituel. D’ailleurs, il y a quelques années, un évêque avait eu ce propos sans nuances : « Ce ne sont pas des terres à rechristianiser mais à christianiser ». Ce contexte ne facilite pas le travail de prêtres venus du Bénin.
Plus généralement, il semble qu’au sein des autorités ecclésiastiques on mette l’accent sur l’évangélisation des villes. A la tête de diocèses, bon nombre d’évêques, souvent issus du monde urbain, méconnaissent parfois les spécificités du monde rural. Ils ont par ailleurs reçu une formation plus orientée sur la spiritualité que sur l’action pastorale. A cela s’ajoute une administration par trop cléricale qui déstabilise à la fois ceux (ou plutôt celles, car il s’agit surtout de femmes) qui sont engagés dans les services ecclésiaux, et ceux se situant en périphérie de l’Eglise et qui ne s’y retrouvent pas vraiment. Pourtant l’Eglise aura de plus en plus besoin de laïcs pour pallier au manque de prêtres ! Si bien que, dans certains diocèses, on peut constater cette forme de repli de l’Eglise sur elle-même, à contre-courant de la parole du pape François qui prône la construction de ponts plutôt que de murs…
Dans la tradition des jacqueries ?
Au début de l’année, quelques experts s’interrogeaient quant aux risques d’un nouveau mai 1968, 50 ans après les fameux événements. Le printemps passé, sans heurts sociaux particuliers à l’exception des cheminots, personne n’a vu venir la crise présente. Crise qui, de jour en jour, voit le spectre des doléances s’élargir considérablement. D’une taxation sur le carburant, on est ainsi passé à une crise de la représentation politique, voire une fronde insurrectionnelle, comme seul le peuple français sait l’exprimer de manière récurrente et parfois violente. Rien à voir toutefois avec mai 1968, crise des trente glorieuses !
Et si cette fronde des gilets jaunes ne se situait pas plutôt dans la tradition des jacqueries, mouvements de révoltes souvent désorganisés, à l’initiative de paysans parfois parmi les plus aisés (les classes moyennes d’aujourd’hui) pour lutter contre l’ordre féodal et ses impôts. Car si le carburant a remplacé les céréales comme incarnation de nos sociétés, quasiment toutes les jacqueries ont eu pour origine une révolte fiscale. De la Grande Jacquerie de 1538, qui enflamma à partir du Beauvaisis une partie du nord de la France, aux Chemises vertes de Dorgères entre les deux guerres, en passant par les Rustauds d’Alsace, les Francs-Museaux du Languedoc, les Pitauds du Poitou, et, déjà, les Bonnets rouges bretons, les Croquants du Quercy, les Va-nu-pieds normands ou les Lustucru du Boulonnais…, tous ces mouvements s’inscrivent dans une longue tradition de mobilisation contre l’impôt et, au-delà, contre la ville et ses élites ; aujourd’hui, avec les gilets jaunes, contre les métropoles, tant la fracturation territoriale est toujours facteur d’inégalités grandissantes, et cette noblesse d’Etat qui ne décrypte la société qu’à partir de ratios financiers.
Notons encore que le point commun de toutes ces jacqueries, ce fut l’échec face au pouvoir en place et souvent au parti de l’ordre ; ce sur quoi semble tabler l’actuel gouvernement. A tort peut-être ? Les prochains jours le diront…
Tragédie passée, souffrances présentes…
Ce 11 novembre 2018, devant l’imposant monument des Fantômes du sculpteur Paul Landowski, qui domine la plaine du Tardenois, une brise glaciale, malgré la clémence de la température, s’est mise à souffler au moment même où débutait la cérémonie, comme pour rappeler la solennité du lieu et du moment, et les nombreuses victimes. Ainsi de 530 000 habitants en 1914, la population du département de l’Aisne passera en 1920 à 352 000 du fait des pertes civiles et militaires et de la grippe espagnole, et ne retrouvera sa population de 1914 qu’en 1975. Pourtant au cours de l’itinérance mémorielle du chef de l’Etat sur ces lignes de front, le présent semblait avoir pris le pas sur le passé : le prix du carburant sur la mémoire.
Plus justement, le présent rattrapait le passé, comme pour nous interpeller dans un même élan : n’oublions pas nos Poilus de la Grande Guerre, mais, en même temps, ne nous oubliez pas nous, sentinelles de la mémoire en plein décrochage social, attachées à nos territoires en déshérence ! Les stigmates de ces terres meurtries et la mélancolie des nombreux lieux de mémoire rappellent au quotidien la tragédie passée pour mieux souligner les souffrances présentes des populations.
Villages détruits hier, villages dépeuplés aujourd’hui, de la Meuse à l’Avesnois en passant par la Thiérache, les Ardennes ou la forêt d’Argonne, un même destin tragique affecte ces territoires arpentés la semaine passée par le président de la République ; territoires industrieux et riches avant la Première Guerre mondiale, puis oubliés par Paris. Pour exemple, l’ancienne prestigieuse route Charlemagne qui relie Paris à Aix-la-Chapelle (la Nationale 2) est toujours en deux voies sur la plus grande partie de son parcours. Ce sentiment d’abandon n’explique toutefois pas et n’excuse pas la surprenante décision des édiles de l’Aisne de fermer pour cause de travaux, deux mois avant ce 11 novembre du Centenaire, la Caverne du Dragon, haut lieu du Chemin des Dames !
L’alimentation du futur
Le SIAL (Salon International de l’alimentation) qui s’est tenu la semaine dernière à Villepinte est une impressionnante vitrine de l’alimentation mondiale. Sur une surface de 27 hectares (l’équivalent d’une centaine de supermarchés), les 160 000 visiteurs ont pu découvrir 400 000 produits proposés par 7 200 exposants venus de 105 pays et bien des innovations qui préfigurent ce que pourrait notre alimentation demain. Des jus de fruits pétillants au café vendu en canette, des biscuits en forme de petites cuillères aux fruits lyophilisés sans sucre en bâtonnets, des chewing-gums biodégradables aux moules à croquer, figurent parmi une sélection de 800 nouveautés qui concernent surtout le végétal (l’influence de la mode vegan, sans doute !)
Car ce salon veut surfer sur les grandes tendances actuelles : le vrai, le goût et le sens avec des demandes très appuyées concernant la transparence, le bien-être animal ou le manger sain. Pour l’occasion, trois enquêtes menées dans une dizaine de pays (Europe, Etats-Unis, Russie, Moyen Orient, Chine…) attestent de ces évolutions avec, pour la France, une amplification des résultats. Ainsi 63 % des Français souhaitent manger sain, 91 % veulent plus de transparence sur les produits alimentaires, et 78 % se disent prêts à payer plus cher pour valoriser le travail des agriculteurs. L’enquête souligne également l’intérêt de huit Français sur dix pour les produits locaux.
Et pourtant une rapide visite du salon donne une toute autre impression : celle d’une extraordinaire vitrine de la mondialisation alimentaire illustrant une formidable palette de goûts, d’aliments, de couleurs, venus des cinq continents, avec des produits alimentaires très transformés, un packaging sophistiqué qui, certes, se veut biodégradable, un marketing (de circonstance ?) très élaboré… Pas vraiment ce dont témoignent les enquêtes. Reconnaissons toutefois que les comportements des consommateurs ne sont pas toujours en adéquation avec leurs aspirations !
Un monde agricole désarticulé
Il y a 40 ans, Jacques Poly, alors directeur scientifique à l’INRA, remettait son rapport « Pour une agriculture plus économe et plus autonome », annonciateur des débats qui allaient suivre autour des liens entre agriculture, environnement et recherche. A l’époque, il y avait plus d’un million d’agriculteurs et Jacques Poly plaidait pour le maintien d’une « population agricole active à un niveau raisonnable ». Quatre décennies plus tard, on recense 437 000 exploitations et les exploitants ne représentent plus que 1,8 % de la population active française, comme le soulignait Bertrand Hervieu, le président de l’Académie d’agriculture lors de la séance de rentrée de la compagnie. Ce chiffre est le résultat d’une longue tendance à la baisse qui voit deux exploitations disparaître lorsqu’il ne s’en créé qu’une. En quelques décennies, les agriculteurs encore majoritaires dans la population au début du XXème siècle sont devenus une minorité. Une situation unique ! D’où cette prise de conscience douloureuse pour les intéressés, d’autant plus mal ressentie aujourd’hui, comme le précise Bertrand Hervieu, que « moins il y a d’exploitants et d’exploitations, plus le monde agricole se désarticule ». Car si l’agriculture familiale, souvent en difficulté et à contre-courant des rythmes de la société, demeure majoritaire, l’agriculture sociétaire concerne désormais plus du tiers des exploitations et les deux-tiers de la superficie. Par ailleurs émergent à la fois un modèle d’agriculture de firme qui obéit à des logiques financières transnationales, sous-traitant souvent l’ensemble des travaux agricoles, et d’autres formes d’agricultures alternatives souvent menées par des acteurs non issus du monde agricole. La situation au niveau mondial est tout aussi éclatée ; ce qui ne facilite guère la définition de politiques agricoles. Il faudra apprendre à gérer cette diversité et bien au-delà des frontières de l’Europe…
Etonnants végétaux!
On ressort encore plus émerveillé par les choses de la nature, après la lecture de L’Intelligence des plantes, de Stefano Mancuso, fondateur de la neurobiologie végétale. Pourtant depuis Aristote, qui plaçait le végétal au plus bas niveau de la pyramide des vivants, car il le jugeait sans âme, l’homme a toujours méprisé les plantes. Seul le génial Darwin avait constaté qu’elles manifestent « un haut degré d’évolution étonnamment avancé » et considérait que si les végétaux n’avaient pas su s’adapter, ils ne représenteraient pas aujourd’hui 99,5 % de la biomasse. Et il fallait aux plantes, qui sont immobiles, faire preuve de beaucoup plus d’intelligence que les animaux (qui eux peuvent se déplacer) pour s’adapter. Qui plus est les plantes n’ont ni cerveau, ni poumons, ni foie, ni estomac mais elles parviennent à assurer toutes les fonctions que ces organes remplissent chez les animaux. Stefano Mancuso nous décrit des plantes qui développent une sensorialité très développée, avec une quinzaine de sens de plus que nous. Des plantes qui respirent, perçoivent et émettent des sons, communiquent entre elles, développent une intelligence de réseau, inventant bien avant l’homme une forme d’internet vert. On a donc encore beaucoup à apprendre d’elles, comme mieux comprendre les mécanismes de la photosynthèse, ou encore cette capacité des légumineuses à fixer l’azote de l’air en le transformant en azote ammoniacal assimilable par les plantes, qui, généralisée à l’ensemble des plantes agricoles, permettrait d’augmenter la productivité en respectant la nature, et ainsi de résoudre les problèmes alimentaires et énergétiques de la planète. Un enjeu essentiel pour l’auteur, qui déplore que seuls cinq laboratoires au monde s’y consacrent. Il nous faut aussi respecter ce monde végétal, nous demande Stefano Mancuso : « leur destruction indiscriminée est moralement indéfendable ». Car sans végétaux, pas d’humains sur Terre !
L’intelligence des plantes de Stefano Mancuso et Alessandra Viola – Albin Michel – 240 pages – 18 €.
Le blues des maires
Il est loin le temps où l’on était quasiment maire à vie. Indéracinables, certains faisaient cinq, six mandats, voire plus. Ce n’est désormais plus vraiment le cas. Au cours de cette dernière mandature, l’on constate deux fois plus de défections en cours de mandat, que lors de la précédente. Et dans deux ans, c’est peut-être la moitié des maires actuels qui ne repartira pas pour un nouveau mandat, contre environ un tiers habituellement. Car les maires ont le blues. Ils se sentent délaissés, abandonnés, regardés de haut par un pouvoir jupitérien qui semble les négliger. C’est particulièrement vrai dans les petites communes où le maire est souvent l’homme à tout faire, se coltinant parfois des tâches ingrates. Je me souviens de mon père, maire d’une petite commune, balayant le riz sur les marches de la mairie après un mariage. Un véritable sacerdoce !, sans doute moins bien accepté aujourd’hui. Et puis le contexte a changé. Les dotations de l’Etat diminuent, alors que les charges augmentent. La tâche devient de plus en plus lourde et les réglementations de plus en plus complexes. Si dans les villes, le maire dispose d’un staff important, le premier magistrat d’une petite commune est souvent seul avec un secrétaire de mairie souvent à temps partiel. Par ailleurs les maires ont de plus en plus de responsabilités et de moins en moins de pouvoirs, depuis que la loi NOTRe a transféré certaines compétences aux communautés de communes ou d’agglomération. S’ils demeurent, du fait de leur proximité avec la population, les élus les plus appréciés, selon le baromètre du Cevipof (Centre d’études sur la vie politique française) publié en janvier dernier, ils voient leur côte de confiance passée de 64 % à 55 % en un an. Malgré tout, entre un maire et ses concitoyens, c’est souvent une histoire de passion. D’ailleurs François Hollande avait, un jour, fort justement fait remarquer que l’anagramme du mot « maire » était « aimer ».
Le ministère de l’impossible
Robert Poujade, premier ministre de l’environnement au début des années 1970 avait relaté son expérience dans un livre titré Le ministère de l’impossible. Tout est dit dans ce titre. Depuis plus de 25 ministres et secrétaires d’Etat, des politiques plus ou moins expérimentés, des militants plus ou moins sincères et des techniciens plus ou moins pointus, lui ont succédé avec plus ou moins de bonheur. Plutôt moins, car beaucoup ont témoigné de leurs difficultés. Sous Mitterrand, Huguette Bouchardeau reconnaissait que son avis ne pesait pas lourd, confronté aux discours d’un industriel, d’un agriculteur ou d’un économiste. Sous Chirac, Corinne Lepage avait titré son livre : On ne peut rien faire, Madame la ministre !. Sous Sarkozy, Nathalie Kosciusko-Morizet avait dû gérer les remises en cause de son président après le Grenelle de l’environnement. Sous Hollande, face à un budget en baisse et des arbitrages perdus, Delphine Batho avait jeté l’éponge. Nicolas Hulot, qui avait à différentes reprises refusé le poste, savait toute la difficulté de la tâche. Il écrivait en 2005 dans Graines de possibles : « Tant qu’on ne lui donne pas une lisibilité politique et écologique réelle à même de se diffuser dans un gouvernement cohérent, un ministre de l’Environnement est condamné à prendre des coups et à mécontenter les écologistes comme les capitalistes. » Son titre de ministre d’Etat n’aura guère changé la donne, car la question environnementale, malgré l’urgence climatique, se situe sur le long terme, et elle est subversive, alors que l’action politique doit fournir des résultats rapides et gérer des compromis. Là est le dilemme. En 1971, on disait que le critère de réussite du ministère de l’Environnement serait sa vocation à disparaître quand tout aurait été résolu. Ce n’est malheureusement pas le cas. Loin s’en faut ! Alors, à défaut d’un ministère de l’impossible, ne faudrait-il pas mieux privilégier dans chacun des ministères, dans chacune des administrations, les enjeux du long terme, au premier rang desquels la question environnementale. Là serait la véritable révolution !
D’un tour de la France à l’autre…
En 1877 était publié le Tour de la France par deux enfants d’Augustine Fouilliée, manuel scolaire avec ses cartes Vidal-Lablache, ses héros français et sa morale républicaine : devoir et patrie, mais aussi travail et épargne. Le livre fut un best-seller : plus de 7 millions d’exemplaires vendus en moins de 30 ans ! C’est sur les traces des frères Volden que Pierre et Philibert (1), deux jeunes adultes, nés en 1991, ont emprunté sensiblement le même parcours, non plus à pied ou en carriole, mais en vieille 204 de 40 ans d’âge, à vélo ou en covoiturage via BlaBlaCar. La France de 1877 était une France agricole et artisanale, on y évoque brièvement Le Creusot et ses fonderies et la manufacture de Saint Etienne. La France de Pierre Adrian et Philibert Humm, tous deux journalistes, est post-industrielle. On y croise des viticulteurs bios et des électeurs qui vont voter sans conviction, des centre villes qui perdent leurs commerces et des entrées de villes hideuses, la Bourgogne nostalgique d’Henri Vincenot et le Marseille de Plus belle la vie, les descendants des résistants de l’Ile de Sein et les ancêtres zadistes de Plogoff, un ancien gardien de phare et des nouveaux métiers qui ne se racontent pas…
En 1877, Julien Volden s’exclamait dans une envolée cocardière: « N’aimez-vous pas la France ? Oh moi, de tout mon cœur j’aime la France ». Nos deux journalistes disent partager ce sentiment mais, plus nuancé, d’un amour imparfait, inégale, inachevé. « Nous avons traversé une France découpée en deux mondes : celui des jeunes, celui des vieux », notent les deux compères, avant d’ajouter : « La France n’allait pas fort, c’est vrai. Mais elle n’allait pas trop mal non plus. Pour son âge, je la trouvais même plutôt bien conservée. » Comme pour nous rassurer que leur voyage n’était pas un dernier inventaire avant liquidation !
- Le Tour de la France par deux enfants d’aujourd’hui – Pierre Adrian et Philibert Humm –Equateurs Littérature – 20 €
L’air du temps
Après l’épisode victorieux de la Coupe du Monde, sans doute les responsables des chaînes d’information s’inquiétaient-ils de ce qu’ils allaient bien pouvoir se mettre sous la dent… Et puis survient, comme inespérée, cette affaire Benalla. Tous les ingrédients sont réunis pour nous tenir en haleine quelques semaines encore (voire plus) avec ce feuilleton à rebondissements qui mêle dysfonctionnements au plus haut niveau de l’Etat (l’Elysée) et psychologie des hommes à travers le rapport au pouvoir. Cela fait penser à cet épisode du Rainbow Warrior, qui nous avait mobilisés au creux de l’été 1985, ébranlant le sommet de l’Etat. Sauf que cette dernière affaire était bien plus grave, avec mort d’homme et répercussions diplomatiques fâcheuses, – le coulage du bateau de Greenpeace s’étant déroulé à Auckland en Nouvelle-Zélande -. Autre différence, même si c’est déjà Le Monde qui avait sorti l’affaire, le contexte médiatique est aujourd’hui bien différent, avec l’omniprésence des chaînes d’information continue. Et puis les différentes oppositions politiques trouvent dans cette affaire inespérée un bon moyen de reprendre pied.
Sans doute s’agit-il d’une affaire d’Etat par les dysfonctionnements qu’il met en évidence, mais, en même temps, c’est l’histoire d’un type qui a dérapé, qui a pris la grosse tête, dans une société de l’esbroufe qui fait prospérer ce genre de comportement. L’adresse de l’Elysée sur une carte de visite nous en met plein la vue et s’impose même au sein des plus hautes élites administratives comme le plus précieux sauf-conduit. Le mode de gouvernance jupitérien n’en est-il pas un dérivé ? D’ailleurs les deux précédents présidents de la République, qui avaient (volontairement ou involontairement) décrispé (ou décrédibilisé ?) la fonction présidentielle, Nicolas Sarkozy jouant le « bad boy » et François Hollande « le président normal », ont échoué. Au moment où la Constitution de la Cinquième République va fêter ses 60 ans, ce rapport crispé voir obséquieux au pouvoir perdure. Au fond, nous aimons cela et chérissons cette forme de monarchie républicaine !
La fronde des automobilistes
Désormais la limitation à 80 km/h s’applique sur les routes secondaires. Depuis l’élection d’Emmanuel Macron, c’est la décision gouvernementale la plus contestée : 70 % des Français y sont fermement opposés. Il est vrai qu’à chaque nouvelle mesure de ce type, du passage de 100 à 90 km/h en 1974 à la multiplication des radars fixes et mobiles, en passant par l’obligation du port de la ceinture de sécurité et la baisse du seuil d’alcoolémie, la fronde est récurrente, avant que ces mesures ne soient finalement acceptées.
Cette fronde s’explique par le fait que la voiture reste ancrée dans nos vies. Au-delà de sa fonction mobilité, et malgré les bouchons, la pollution, les coûts, le stress, elle demeure symbole de liberté, d’autonomie, d’émancipation, signe de réussite sociale et d’affirmation de soi mais aussi volonté de puissance à travers le plaisir de la vitesse, cause d’un tiers des accidents.
Ces dernières semaines, la presse a mis en exergue la grogne des campagnes contre une décision des élites urbaines qui méconnaissent les contraintes des ruraux. La cause de la ruralité mérite meilleur argument. Certes à la campagne, la voiture est incontournable, mais les ruraux paient un lourd tribut car les routes, parfois jalonnées de croix et de silhouettes noires, y sont plus dangereuses. Entre 2012 et 2016, 56 % de la mortalité routière s’est produite sur des routes à double sens, sans séparateur central et hors agglomération. Mais voilà, dans l’inconscient collectif, un mort sur la route, c’est un drame, 3 600, c’est une statistique…
Quant à l’argument évoqué par certains lobbyistes à propos du « temps de vie sociale en moins », il frise le grotesque : une minute et demie de perdue sur un trajet de 40 kilomètres ! Paradoxalement, en une époque où nous disposons de beaucoup plus de temps libre que les générations qui nous ont précédées, nous avons l’impression d’en avoir moins. La voiture impose aussi un autre rapport au temps !
Atmosphères électriques !
Cela n’en finit pas : ce climat électrique avec ses pluies torrentielles et ses inondations ravageuses, ces orages d’une rare violence et cette grêle qui détruit cultures, vignes et habitations. Certes il n’est pas anormal d’avoir des orages en mai ou juin, mais, aussi loin que l’on remonte dans le temps, c’est plutôt rare. Dans les dictionnaires météorologiques de nos campagnes, on ne trouve que peu de dictons concernant les orages en cette période. Le premier date du 24 juin : « Orages avant la Saint Jean ne sont pas dangereux, après ils sont violents ». Ce que dément vigoureusement la situation actuelle ! La violence des orages inquiète : 182 796 impacts de foudre rien qu’en mai, soit deux fois plus que le précédent record de mai 2009. Et cela se poursuit avec la même intensité en juin. De l’air frais en altitude, des masses d’air chaud dans les basses couches venues d’Afrique du Nord, le tout associé à un fort taux d’humidité, expliquent le phénomène qui voit, paradoxalement, Oslo et Stockholm battre des records de chaleur, tandis qu’à Ostende, le temps se montre plus clément qu’à Biarritz !
L’atmosphère était tout aussi électrique le week-end dernier à Charlevoix dans la Belle Province du Canada, pour le G7, qui réunissait les sept pays les plus riches de la planète. Ce jour-là, la tornade s’appelle Trump. Le président américain, aussi imprévisible et insaisissable que le dérèglement climatique, dans sa posture de seul contre tous, semble sceller en vue d’éventuels bénéfices électoraux futurs une rupture entre les Etats-Unis et leurs traditionnels alliés, au plus grand bénéfice de la Chine. L’ordre économique et commercial du monde est en train de changer avec cette fin du multilatéralisme dont les Etats-Unis furent le principal architecte. Tout comme semble s’imposer ce désordre climatique dont le président américain dénie, au mépris des évidences, toute responsabilité humaine. Alors dans ce monde qui s’annonce si imprévisible, de grosses tempêtes sont à prévoir, qu’elles soient climatiques, géopolitiques ou diplomatiques !
Désir d’herbe
Juin est le mois des longs jours, de la rose mais aussi de la fenaison. Dans les temps anciens, cette activité éprouvante mobilisait toute la maisonnée. Même mécanisée, elle est sujette aux aléas climatiques. Un orage imprévu et c’est parfois la perte d’une récolte. Mais au-delà de la production fourragère, l’herbe est aussi source d’émotions depuis l’Antiquité. L’historien des sensibilités, Alain Corbin, dans son livre La Fraîcheur de l’herbe (1) nous convie à un voyage littéraire sur ce thème : de Rousseau, qui voit dans un brin d’herbe la preuve sensible de la présence de Dieu, à Victor Hugo, qui évoque cette « housse de velours vert », en passant par Rimbaud qui la qualifie de « clavecin des prés » et Giono qui exalte « la ronde de l’éternel retour de la vie, de la faux et de regain ».
« L’herbe est porteuse d’origine, elle semble garder la saveur des premiers temps du monde », écrit Alain Corbin. L’herbe invite au repos et à la contemplation, à la rêverie et à la somnolence, à la sensualité et au flirt. Un temps que les moins de 50 ans connaissent moins bien car le rapport à l’herbe a changé, lorsque les prairies naturelles n’ont pu suffire aux besoins de l’élevage et qu’apparurent les prairies artificielles.
Aujourd’hui, où la hiérarchie entre herbes folles, sages ou mauvaises s’estompe aux yeux des citadins, le brin d’herbe s’invite sur les toits d’immeubles et les trottoirs que l’on a cessé de désherber, tandis que le gazon uniforme de brins disciplinés dans les parcs publics et les terrains de golf fait penser à une bétonisation champêtre. Ce qui témoigne à la fois de cette artificialisation de la nature, mais aussi de cette nostalgie des sentiments liés à l’herbe qui résiste à travers ces émotions familières que sont la roulade de l’enfant dans le pré, l’odeur enivrante du foin, la sensualité et l’ondulation des hautes herbes, le bruissement des brins et des insectes, le diapré des fleurs sauvages…
- La Fraîcheur de l’herbe, histoire d’une gamme d’émotions de l’Antiquité à nos jours – Fayard « Histoire » – 244 pages – mars 2018 – 19 €.
Scandale à la Commission
La Commission européenne n’en est pas à son premier scandale : de la gestion de l’épisode de la vache folle au parachutage de l’ancien président José Manuel Barroso comme lobbyiste au sein de la banque Goldman Sachs, en passant par des malversations, qui avaient obligé en 1999 la Commission présidée par Jacques Santer (un Luxembourgeois) à démissionner collectivement. Le nouveau scandale met en cause l’actuel Président, luxembourgeois lui aussi, Jean-Claude Juncker, qui a imposé son directeur de cabinet, l’allemand Martin Selmayr, comme Secrétaire général de la Commission, au mépris des procédures et de la tradition qui veut qu’un Secrétaire général ait l’expérience de la direction d’un service. Une forme de népotisme que les porte-paroles de la Commission ont bien du mal à justifier ! Numéro deux de l’institution, le Secrétaire général est à la tête d’une administration de 30 000 fonctionnaires. Rouage essentiel des institutions européennes, car à la fois force de propositions et chargée de la mise en place des politiques européennes, la Commission est aussi la gardienne des traités et, à ce titre, joue un rôle de gendarme auprès des gouvernements de l’Union, si ces derniers ne respectent pas les règles communautaires. Cette nomination a suscité la fronde des parlementaires européens, tous partis confondus. Mais les élus ne sont pas allés jusqu’à censurer la Commission, afin d’éviter à l’Europe une crise de plus.
A terme, les dégâts risquent d’être considérables. Dès lors, comment faire la leçon aux gouvernements hongrois et polonais si peu soucieux de démocratie ? Cet épisode pourrait faire les choux gras des souverainistes lors du prochain scrutin européen. On semble oublier un peu vite que l’Europe s’est construite sur les ruines de la guerre à partir d’un système de valeurs, héritier des traditions grecques, judéo-chrétiennes et du Siècle des Lumières, et qui, aujourd’hui, pourrait apparaître comme antidote aux « égarements » de l’administration Trump ! A condition toutefois de respecter soi-même ces valeurs…
Mieux vaut en rire !
En 2015, un automobiliste se fait prendre par un radar sur la nationale 7. Rien de bien original, cela arrive à beaucoup d’entre nous ! Mais là où l’affaire se corse, c’est que notre homme, furieux par sa mésaventure, brandit un doigt d’honneur, que le radar photographie. La suite, c’est une convocation au tribunal pour outrage à personne chargée d’une mission de service public. Pour cela il risque deux à quatre mois de prison ferme. D’autant que le conducteur, qui a déjà été condamné pour d’autres faits répréhensibles, se défend bien maladroitement. Plutôt que d’assumer son geste, il prétexte que ce malheureux doigt d’honneur s’adressait à sa compagne. Pas très fair-play !, le bonhomme. Malgré tout notre conducteur obtient la relaxe. Le bon sens semblant alors l’emporter !
Naviguant sur Internet pour voir s’il existait d’autres cas similaires, je découvre alors un article du Courrier Picard de 2012, qui évoque un radar placé sur l’autoroute du Nord, affichant sur un écran un inélégant « Fuck you !, chauffard » à tous les conducteurs flashés. L’histoire ne dit pas si ces derniers ont porté plainte. Paradoxalement, c’est finalement la machine qui a porté plainte contre le conducteur et non les conducteurs contre cette insulte. Entre le doigt d’honneur et ce Fuck you, les rôles semblent inversés entre l’homme et la machine.
Prenons conscience que, derrière chaque machine, dans nos sociétés désormais si contrôlées, peut se cacher un homme en mission de service public. Il nous arrive tous d’avoir des propos parfois inconvenants, voire des gestes malheureux, lorsque la tondeuse à gazon fait des siennes ou quand notre voiture nous laisse en rade en rase campagne, – après tout cela ne fait de mal à personne !-, mais prenons garde avec ce futur qu’on nous annonce heureusement robotisé, qu’une caméra ne se cache derrière la tondeuse ou la voiture, justifiant ainsi le dépôt d’une plainte ! Ainsi va le monde ! Orwell, réveille-toi, ils sont devenus fous !
Le mai 1968 des agriculteurs
Après avoir traité dans un précédent billet de l’impact de mai 1968 sur la condition des salariés agricoles, voyons comment le monde agricole a vécu ces événements. Mai 1968 se situe en plein cœur des grandes mutations, conséquence des lois d’orientation Debré Pisani de 1960-1962. Depuis 15 ans, deux millions d’actifs ont quitté l’agriculture. Des difficultés surgissent : crise laitière, intégration des firmes dans le porc et l’aviculture, crise de l’artichaut… En Loire-Atlantique, la FDSEA s’est rapprochée depuis le début des années 1960 des syndicats ouvriers, notamment via les mouvements d’action catholique. Si bien que le 24 mai 1968, 2 000 paysans investissent le centre-ville de Nantes et mêlent leur colère à celle des ouvriers et des étudiants, rebaptisant la Place Royale en Place du Peuple. Une exception, car, majoritairement les agriculteurs sont plutôt gaullistes ; ce qui n’était pas le cas dans les débuts de la Vème République. Cette contestation en Bretagne, sous la houlette notamment de Bernard Lambert, ancien de la JAC, qui fut député MRP avant de se rapprocher du PSU, et auteur d’un livre Les paysans dans la lutte des classes, va avoir des effets dans l’organisation syndicale, notamment au sein du CNJA, où deux tendances s’affrontent. En octobre 1968, lors de son congrès national, Bernard Thareau, représentant l’aile gauche, manque de 2 voix (sur 57 votants) la présidence du CNJA. Jusque dans les années 1970, les rapports de force seront équilibrés notamment à la FRSEAO ou au CNJA entre les tendances de droite et de gauche. En 1970, Bernard Lambert est exclu à la tête de la Fédération de l’Ouest. Entre-temps Michel Debatisse devenu président de la FNSEA décide de l’exclusion des leaders de l’aile gauche, contre l’avis de Raymond Lacombe et des représentants des céréaliers de l’époque qui souhaitent maintenir un certain pluralisme. Cette exclusion entraînera la création de nouvelles organisations comme les Paysans Travailleurs, ancêtres de l’actuelle Confédération paysanne.
Le mai 1968 des ouvriers agricoles
Quand on imagine Mai 1968, – et les récentes émissions de télévision nous confortent dans cette vision -, on revoit les étudiants sur les barricades du Quartier Latin, les grandes manifestations de cheminots, de métallurgistes ou d’ouvriers de Renault… Parmi ces manifestants, il y avait sans doute quelques salariés de l’agriculture, mais très peu. Et pourtant, comme le note Philippe Vasseur un journaliste proche de la CFDT dans le livre Mai 68, victoire des salariés agricoles : « S’il y a eu une catégorie sociale qui a le plus bénéficié de ce grand mouvement populaire, c’est sûrement les salariés agricoles ».
Il est vrai qu’à l’époque les salaires sont bas. Il existe un Smag (Salaire minimum agricole garanti) mais dont le montant est inférieur au Smig (qui va devenir le Smic). Pour les représentants des syndicats ouvriers l’un des enjeux de la négociation sociale qui s’ouvre au ministère de l’Agriculture, est la suppression du Smag et la reconnaissance pour les salariés de l’agriculture des mêmes droits que les salariés des autres secteurs. L’ouverture d’esprit du négociateur de la FNSEA, Maurice Duclaux, « patron visionnaire », aux yeux de certains syndicalistes, l’habileté du ministre, Edgar Faure, qui sut mettre une ambiance cordiale, tutoyant tout le monde, alors qu’à quelques centaines de mètres de là le climat était insurrectionnel, et la gravité du contexte ont permis la signature d’un accord le 6 juin 1968. Accord, qui, outre la fin des discriminations, prévoyait une augmentation des salaires de 17 %, le paiement des jours de grève, des cotisations sociales calculées sur le salaire réel et non au forfait, la réduction de la durée du travail… Gérard de Caffarelli et Michel Debatisse, respectivement président et secrétaire général de la FNSEA, durent aller s’expliquer dans les départements, non sans remous, parfois. D’ailleurs les accords de Varenne ont été l’une des raisons de la dissidence de la FDSEA de l’Indre-et-Loire et de la création en 1969 de la FFA (Fédération Française de l’Agriculture), mouvement situé très à droite de la FNSEA.
Le cataclysme italien
L’accord de gouvernement entre sociaux-démocrates et conservateurs allemands n’aura été qu’un court répit dans un ciel européen ombragé, car, quelques heures plus tard, c’est un vrai cataclysme qui venait d’Italie avec l’élection d’un Parlement désormais dominé par des partis anti européens, comme la Ligue et le Mouvement Cinq Etoiles. Sans doute s’agit-il d’un événement encore plus considérable que le Brexit, car il concerne l’un des six pays fondateurs de l’Europe et l’un des peuples longtemps considéré parmi les plus europhiles ! Certes la péninsule ne va pas quitter l’Union européenne, mais elle peut entraver son action. Et la plupart des autres Etats européens voient eux aussi les mouvements populistes prendre de l’ampleur. Si la France semble aujourd’hui l’exception, c’est essentiellement dû à sa Constitution et à ses scrutins majoritaires à deux tours. La situation peut être bien différente l’an prochain avec un scrutin à la proportionnelle pour les élections européennes.
Comme lors des dernières élections en Allemagne, la question des migrants s’est imposée comme le thème dominant durant cette campagne italienne. Depuis très longtemps terre d’émigration la péninsule était devenue terre d’immigration dans les années 1990 avec l’arrivée massive de réfugiés venant d’Albanie, puis de l’ex-Yougoslavie. Longtemps acquise au principe du droit d’accueil, l’opinion publique a basculé ces derniers mois. Depuis la fermeture de la route des Balkans et l’accord entre l’Union européenne et Ankara, l’Italie est désormais pour la plupart des migrants la seule porte d’accès à l’Europe. Elle a le sentiment d’être seule pour affronter la crise, devant l’indifférence de ses partenaires et le manque de courage et de vision de l’Europe. Or seule l’Europe en renouant avec ses traditions humanistes (ce qui n’est guère facile en ces temps !) peut être à même d’apporter une réponse collective à ce défi qui va perdurer, tout en ne négligeant les autres raisons qui amènent des pans importants de la population à voter pour des partis souverainistes.
Et surgit Martin Fourcade…
Nos vieilles démocraties semblent bien mal en point. Pêle-mêle dans l’actualité de ces dernières semaines, retenons l’israélien Netanyahu empêtré dans des affaires de corruption, les troubles délirants de Trump tels que les décrit son biographe, le retour possible en Italie des acolytes de Berlusconi (lui-même inéligible), sans oublier dans l’Hexagone ce secrétaire d’Etat qui affirme qu’il n’y a que 50 SDF dormant dans les rues de Paris, les déboires familiaux des Le Pen, et les soucis de Mélenchon dans ses comptes de campagne… Et puis, bien sûr ce dérapage (contrôlé ou non ?) du président des Républicains, hallucinants propos mêlant bêtises féroces et mensonges poisseux, et allant jusqu’à qualifier de dictature notre démocratie, qui n’est certes pas parfaite, mais tout de même ! On peut avoir le plus imposant cursus universitaire de l’élite française (normalien, agrégation d’histoire, énarque) et s’afficher comme un cynique mu par la seule appétence du pouvoir… Et que dire de la vacuité des propos, qui n’a d’égale que le mépris affiché à la République, de sa garde rapprochée venue s’expliquer sur les plateaux de télévision… Ce n’est pas ainsi que l’on va faire baisser le taux d’abstention lors des prochains scrutins. Cela rappelle la férocité des années de la fin de la Troisième République. L’on pensait avoir progressé depuis. Reconnaissons qu’un Pierre Mendès France ou un Philippe Séguin, un Michel Debré ou un Jean-Pierre Chevènement, cela avait une tout autre tenue. « On peut se rapprocher chaque jour davantage de la perfection démocratique, mais on ne l’atteindra jamais », écrivait Marc Sangnier en 1935. On espérait toujours faire mieux. Constatons aujourd’hui la régression.
Heureusement il nous reste pour nous consoler l’élégance d’un Roger Federer, redevenu à 36 ans le numéro un mondial du tennis, et puis les performances en or de Martin Fourcade et des biathlètes français pour nous faire rêver, même parfois dans la difficulté. Exemples de sportivité dont devraient s’inspirer certains de nos hommes politiques !
Tombe la neige…
A chaque épisode neigeux, exceptionnel ou pas, c’est toujours le même scénario : routes bloquées, embouteillages monstres, automobilistes furieux confinés dans des gymnases… Les mêmes d’ailleurs qui se lamentent de l’impréparation des pouvoirs publics se morfondent quand il manque de neige dans les stations de sports d’hiver. Qu’il neige en février, cela n’a rien d’anormal, même dans un pays au climat tempéré ! Que la neige, symbole de pureté, de quiétude et d’innocence, soit devenue un enfer, soit synonyme de captivité et d’enfermement, en dit long sur l’état de nos sociétés. Il n’y a plus guère que le regard joyeux des enfants pour s’émerveiller du spectacle des éclats de cristal, des paysages ouatés et des sons feutrés.
En fait la neige témoigne de l’incapacité des hommes et de la fragilité de nos sociétés devant des événements naturels, comme dans le film Le jour d’après où dans New-York, pris dans la neige et la glace, quelques survivants tentent de survivre dans la bibliothèque de la ville. On s’amuse à se faire peur dans nos sociétés urbaines et artificialisées, aux bureaux surchauffés l’hiver (ce n’est pas le cas à La France Agricole !) et climatisés l’été, alors que dans nos sociétés rurales, qui disposent de beaucoup moins de moyens que la ville, on accepte plus facilement les contraintes des saisons. Et pourtant, longtemps dans les campagnes, l’on a redouté l’épreuve de l’hiver, cette « dictature du milieu physique », pour reprendre l’expression de Fernand Braudel, car elle imposait ses rythmes et faisait beaucoup de morts. Mais en même temps, il y avait cette croyance que le froid et la neige purifient la terre et fertilisent les sols.
Dimanche, la neige a fondu, sans laisser de traces. Ephémère mystère qui nous a permis de regarder le monde différemment, masquant nos impuretés, nos détritus et la gadoue. La neige a disparu comme notre part d’innocence perdue.
Agriculteurs et médias
Participant récemment à une assemblée générale d’un syndicat agricole sur le thème « médias et agriculture », j’ai pu constater le gap qui sépare le regard des agriculteurs sur la presse et le regard de la presse généraliste sur l’agriculture. C’était juste après l’émission Cash Investigation qui avait mis en cause les problèmes sanitaires et le manque de transparence de Lactalis et les dérives « capitalistes » d’un groupe coopératif Sodiaal. Certains de mes interlocuteurs trouvaient inacceptables ce type d’émission, alors que le second exemple allait dans le sens des éleveurs. Loin de moi, l’idée de défendre le traitement de l’agriculture dans la presse généraliste, je suis le premier à en dénoncer les dérives mais force est de constater que souvent, dans les cénacles agricoles, la moindre critique apparaît comme un crime de lèse-majesté et vous classe comme un adversaire. Ce n’est pas nouveau. En 1969, François-Henri de Virieu avait été hué lors d’un congrès de la FNSEA, au lendemain d’une émission de télévision, mettant en cause le coût de l’agriculture pour la collectivité !
Beaucoup dans le monde agricole pensent que le journaliste doit être leur porte-parole mais le considère souvent comme quelqu’un qui va les piéger. Or la plupart des journalistes, à défaut d’être objectifs, sont plutôt honnêtes. D’où cette incompréhension ! Récemment au bout de deux heures d’entretien avec un éleveur et une bonne quinzaine de pages de notes, ce dernier pensait que j’allais tout reproduire in extenso. En fait je n’avais guère que deux feuillets pour faire la synthèse de notre entretien. Chaque profession a ses contraintes. Et il est vrai qu’on ne se retrouve que rarement dans un article qui vous est consacré. Et pour rassurer mes amis agriculteurs, je puis leur dire que je ne me retrouvais pas vraiment mon propos dans l’article de L’Agriculteur de l’Aisne consacré à mon intervention, mais je le savais par avance, et c’est tout à fait normal ! C’est le regard de l’autre qui importe. Et c’est ce qui fait la différence entre information et communication…
Souvenirs, souvenirs…
Janvier est le mois des soldes et des augmentations de tarifs, des vœux et des bonnes résolutions qui, souvent, ne durent pas. C’est aussi le début d’une année où, à défaut de déchiffrer le futur, l’on ressent le besoin d’explorer notre mémoire collective, en jalonnant ces douze mois de commémorations en tous genres. Outre la fin de la Première guerre mondiale, qui va clôturer quatre intenses années de rétrospectives, 2018 fêtera les premières représentations de L’Avare de Molière et la publication des Fables de La Fontaine, il y a 350 ans, ainsi que la mort de Debussy, il y a un siècle. On commémorera également la naissance de Chateaubriand, né il y a 250 ans, ainsi que celles d’Edmond Rostand et de Paul Claudel, tous deux nés il y a 150 ans, l’année où était fondée la prestigieuse Ecole Pratique des Hautes Etudes. Plus près de nous, au moment des Jeux Olympiques d’Hiver de Séoul, on aura une pensée pour ceux de Grenoble, en 1968. De même que, lors de la prochaine Coupe du Monde de football, les supporters français espéreront le même dénouement qu’en 1998. Côté histoire politique, entre les soixante ans de la Constitution gaullienne de 1958 et les cinquante ans de Mai 1968, lequel de ces deux événements demeure le plus marquant en 2018 ? 1968, c’est aussi la première greffe du cœur en Europe, mais aussi la sortie en salles de Baisers Volés de François Truffaut et la publication de Belle du Seigneur d’Albert Cohen. Dix ans plus tard, disparaîtront deux stars de la chanson, Claude François et Jacques Brel…
Dans ces rétrospectives très franco-françaises sans doute aura-t-on une pensée pour ces icônes internationales que sont Nelson Mandela né en 1918, Gandhi mort en 1948, et Martin Luther King mort en 1968, ainsi qu’un regard sur le Printemps de Prague en 1968, comme un présage, 21 ans avant la chute du mur de Berlin, dont on fêtera l’an prochain le trentième anniversaire. Comme les événements se succèdent à un rythme accéléré… ! Les années passant, il est vrai, la perception du temps s’emballe… inéluctablement !
2017, année de la femme ?
Peut-être, dans quelques années, ne retiendra-t-on de l’année 2017 que cette onde de choc, née de l’affaire Weinstein, qui déclencha une cascade de révélations et de dénonciations sur les violences sexuelles faites aux femmes notamment dans le monde du spectacle, des médias ou de la politique… Dans de nombreux pays, les femmes sortaient de leur silence, révélant l’ampleur des inégalités entre hommes et femmes.
Au même moment, sortait sur les écrans le film Les Gardiennes de Xavier Beauvois, le réalisateur heureux Des hommes et des dieux. L’action se déroule durant la Première guerre mondiale à la ferme du Paridier dans le Limousin. Les hommes sont au front ; les femmes font marcher les fermes. Vaillantes face à la dureté de la tâche, elles luttent contre les pénuries, notamment de main d’œuvre. Hortense, la doyenne du Paridier, jouée par Nathalie Baye, décide d’engager une jeune fille de l’assistance publique pour les seconder, elle et sa fille. Tout se passe harmonieusement bien au gré des saisons et des tâches sans relâche, des permissions des hommes et de l’annonce d’une tragique nouvelle venue du front, des échanges de lettres et des visites de soldats américains en garnison dans le coin. La cruauté de la guerre n’a pas éteint le désir. L’émancipation féminine se traduit également par une certaine modernité dans l’exploitation avec l’achat d’une moissonneuse-lieuse puis d’un tracteur. Mais l’ordre féminin sera vite perturbé par le souci de préserver la cellule familiale et le patrimoine au prix d’une cruelle injustice faite à la servante qui n’a pourtant pas démérité. L’ordre social (masculin ?) reprenait inexorablement le dessus. Dans la réalité, dès la fin de la guerre, le patriarcat reprendra ses droits.
Nul ne sait si, un siècle plus tard, l’onde de choc de l’affaire Weinstein sera vite oubliée parmi l’abondance de nouvelles ou s’il va s’opérer une révolution dans les relations entre hommes et femmes. Seul l’avenir le dira !
Bel exemple d’intégration !
Je m’apprêtais à traiter dans ce billet de la grogne des maires ruraux, quand, le week-end dernier, j’ai eu l’occasion de voir un remarquable documentaire : Un paese di Calabria (un village de Calabre). Ce film de Shu Aiello et Catherine Catela raconte l’histoire de Riace, qui, comme beaucoup de villages du sud de l’Italie, a subi un exode rural massif. Un jour, c’était il y a plus de vingt ans, échoue sur la plage un bateau transportant 200 Kurdes fuyant la Turquie. Spontanément la population de Riace, le village le plus proche de la plage accroché à la montagne, avec ses paysages sublimes d’orangeraies, a accueilli cette nouvelle population. A l’époque, c’est Forza Italia (le parti de Silvio Berlusconi) qui administre le village, mais un conseiller d’opposition, Domenico Lucano, réussit à convaincre le conseil municipal de positiver l’accueil. Aux élections suivantes, il est élu maire et l’est depuis plus de 16 ans, signe qu’une grande partie de la population partage son choix, loin d’être évident au départ !
Après les Kurdes, ce furent des Soudanais, puis de nombreuses autres nationalités. Tous ne vont pas rester, mais le village désormais revit. Les maisons abandonnées au lierre ont été réhabilitées, le commerce est relancé et l’avenir de l’école n’est plus compromis. Riace compte aujourd’hui 2 100 habitants contre 900, vingt ans plus tôt, et près de 22 nationalités qui semblent vivre plutôt harmonieusement. Dans cette culture méditerranéenne de religiosité populaire, l’église est devenue un lieu de rencontres ouvert à tous. Le curé est formidable, tout comme l’institutrice à la retraite qui donne des cours d’alphabétisation. Un tourisme solidaire s’est installé. Et quelques villages voisins s’inspirent de l’exemple de Riace, malgré les difficultés, mais loin des clichés qui alimentent dans bien d’autres contrées ce climat délétère autour des migrants. Entre l’exil passé des Calabrais, notamment vers la France, et l’arrivée de ces nouvelles populations, l’on découvre aussi que nous sommes en fait tous des migrants !
Cinémas paysans
Le cinéma paysan se porte plutôt bien avec récemment la sortie du film d’Hubert Charuel, Petit Paysan, qui a connu un certain succès en salles, et, la semaine passée, celle du documentaire de Christophe Agou, Sans Adieu, sur les derniers paysans du Forez, lui aussi bien accueilli par la critique.
Certes le cinéma rural n’a pas eu le même lustre en France qu’outre-Atlantique. John Ford, le réalisateur des Raisins de la Colère et de nombreux westerns, aimait à dire : « Je suis paysan et je fais des films de paysans ». Mais dans les décennies passées, certains films comme La Horse avec Jean Gabin ou Les Granges brûlées avec Simone Signoret, et des adaptations comme Regain par Marcel Pagnol, Le Cheval d’orgueil par Claude Chabrol ou Jean de Florette par Claude Berri, ont connu un grand succès en salles. Mais ce sont les exceptions qui confirment la règle, car beaucoup d’autres films donnaient une image caricaturale jusqu’à la niaiserie du monde paysan.
Par contre la France cultive un réel savoir-faire dans le documentaire sociologique, en grande partie grâce au Service Cinéma du ministère de l’Agriculture. Créé en 1947 par Armand Chartier, un passionné d’éducation populaire et de cinéma, – pour réaliser des films techniques qui progressivement vont s’orienter vers une approche plus sociologique -, il produira plus de 500 films et fera travailler de grands réalisateurs comme Robert Enrico, Jacques Demy, Jacques Doillon, Marcel Bluwal, René Clément, Denys de la Patellière et bien sûr Georges Rouquier, le réalisateur de Farrebique et de Biquefarre, considérés comme des films cultes aux Etats-Unis. Dans leur sillage, on retrouve Bernard Dartigues avec La Part des choses, Raymond Depardon avec Profils paysans et, aujourd’hui, le photographe Christophe Agou, le réalisateur de Sans Adieu, (décédé après le montage de ce film), qui propose un regard tendre et âpre sur ces derniers paysans du Forez confrontés à la solitude et à la vieillesse et représentants d’un monde qui disparaît dans l’indifférence générale.
A bas le néolithique !
Il y a une certaine mode intellectuelle à dénoncer aujourd’hui la révolution néolithique, qui transforma les sociétés de chasseurs cueilleurs en une civilisation agricole et favorisa la sédentarité, le boom démographique, les premières cités et les premiers royaumes. Sans doute, a-t-elle également contribué au développement des inégalités, des guerres, des pandémies, de l’esclavage, mais aussi permis celui de l’écriture, de la philosophie, des arts… Révélateur de cet état d’esprit, le succès mondial de Sapiens – Une brève histoire de l’humanité, un best-seller traduit en une trentaine de langues, dans lequel l’auteur, un historien israélien, bouddhiste et végétalien, Yuval Noah Harari, décrit les moteurs du développement humain depuis la Préhistoire jusqu’à cette domination sans partage des Homo Sapiens sur la planète.
Il consacre un long chapitre à la révolution agricole qu’il considère comme « la plus grande escroquerie de l’histoire ». Il explique que les chasseurs-cueilleurs vivaient mieux, avaient une alimentation plus équilibrée et une vie pleine de sens. Il considère que ce sont les plantes qui domestiquèrent l’Homo Sapiens, plutôt que l’inverse. Bill Gates et Mark Zuckerberg, patrons de Microsoft et de Facebook, ont dit tout le bien qu’il pensait de ce livre. Est-ce un hasard ?
Car, paradoxalement, ces réflexions, qui nous rendraient presque nostalgiques du bon vieux temps des chasseurs-cueilleurs, arrivent au moment où l’on semble entrer dans une nouvelle ère (où, peut-être les formes d’agriculture que nous connaissons aujourd’hui vont disparaître ?), quittant définitivement cette société post-néolithique. C’est d’ailleurs le thème du dernier livre de cet auteur, Homo Deus, une brève histoire de l’avenir sur fond de quête d’immortalité et de transhumanisme, d’intelligence artificielle et de manipulations génétiques. « L’Histoire, écrit Harari dans Sapiens, commença quand les humains ont inventé les dieux. Elle s’achèvera quand ils deviendront des dieux ».
De l’esclavache…
Emouvant témoignage sans fioritures et tout empreint de dignité, que ce livre écrit à quatre mains, Le jour où on a vendu nos vaches (1). Les auteurs, un couple d’éleveurs laitiers du Bessin, qui n’ont pas 40 ans, décrivent les angoisses du quotidien. Ludivine s’est toujours rêvée en citadine. Pas question d’épouser un agriculteur ! Le destin en a décidera autrement. Christophe est attaché à son métier. Il travaille comme un fou pour ne rien gagner. Elle doit travailler à l’extérieur. Et puis un jour, alors qu’ils font les courses pour Noël, la carte est refusée. Ils découvrent qu’ils sont interdits bancaires. On vit alors avec eux au jour le jour, la crise laitière, les manifestations contre Lactalis et Leclerc, – dont Christophe fut un des meneurs -, la spirale de l’endettement, les saisies sur salaires, les estomacs noués et les nuits d’insomnie, la sensation d’être inutile et la honte qui en découle, la crainte de la dépression ou du pire et les difficultés du couple, la cantine des enfants qu’on n’arrive pas à payer, les ragots et les médisances des voisins qui ne pensent qu’à l’appel de la terre… Et puis un jour de février 2016, c’est la vente du troupeau, une rupture douloureuse, mais en même temps un soulagement. La semaine suivante, Ludivine fait ses courses. Juste avant de passer en caisse, elle se rend compte qu’il manque le pack de lait. C’est la première fois qu’elle doit acheter du lait. Elle pleure comme une madeleine. Le directeur du supermarché qui l’a vue est gêné. Digne, elle a ravale ses sanglots, sèche ses larmes puis tourne les talons. Au moment où je termine le livre, j’apprends que le film Le petit paysan (2), d’Hubert Charuel, fils d’éleveurs, est primé au Festival d’Angoulême. L’histoire, un éleveur laitier trentenaire qui se bat pour sauver son troupeau atteint d’une épidémie… C’est à se demander si les jurés de ce festival n’ont pas plus conscience de ces drames des campagnes que nos décideurs !
- Ludivine et Christophe Le Monnier avec Bérangère Lepetit“ Le jour où l’on a vendu nos vaches » – Flammarion 19 €. (2) Le petit paysan sort en salle le 30 août.
Eloge de la sobriété
Une communauté Emmaüs est souvent un microcosme de la société. Elle témoigne des excès consuméristes et du gaspillage, mais permet de rencontrer des personnes aux parcours aussi divers qu’étonnants. La semaine passée, je croise André, 79 ans, client d’Emmaüs Lescar-Pau, qui vient chaque jour acheter pour 20 ou 50 € d’objets en tous genres. Cet amateur de voitures anciennes collectionne les objets insolites et veut en faire un musée. Une véritable addiction ! Son antre est un imposant Capharnaüm où sont empilées des dizaines de milliers d’objets et ses quelques créations artistiques, à vous donner le vertige. Le même jour, je rencontre Florence. Allure bon chic bon genre, famille bourgeoise, diplômée de Sciences Po Paris, cette mère de famille, divorcée, a travaillé dans la finance avant de devenir psychothérapeute. Elle est engagée dans le mouvement alternatif Bizi (vivre ! en langue basque) et coache des entreprises sociales et solidaires. Récemment elle a passé trois semaines au sein de la communauté Emmaüs. Son bonheur est désormais dans la simplicité, le dénuement, la rencontre…
Beaucoup, comme Florence, se veulent, pour la vie ou le temps des vacances, en rupture avec cette société du trop de tout : trop d’accumulations et de préoccupations, trop de bouffe et d’argent, trop de complexité et de superficialité. Ils prônent un idéal de sobriété sur les traces de ces apôtres du dépouillement : d’Epicure, qui, considérait que : « Parmi les désirs, tous ceux dont la non-satisfaction n’amènent pas la douleur ne sont point nécessaires », à Pierre Rabhi, en passant par Henry-David Thoreau, cet adepte de la contemplation de la nature, qui avait choisi de vivre dans les bois dans une cabane de 13 m2, expérience racontée dans son magnifique livre Walden ou la vie dans les bois.
Mais le cheminement n’est pas facile car derrière la simplicité, qui n’est pas synonyme de facilité, se cache une démarche complexe. Picasso ne disait-il pas qu’il avait passé toute sa vie à apprendre à dessiner comme un enfant !
Eloge de l’abeille
Et si l’abeille, à travers le débat sur les néonicotinoïdes, avait été à l’origine du premier clash gouvernemental de l’ère macronienne ! Les abeilles, les ruches et leur organisation taylorienne, avec grande reine, faux bourdons et ouvrières, nous fascinent depuis l’Antiquité. Pour Virgile, les abeilles renferment une parcelle de « la Divine Intelligence », que confirmeront les travaux de l’éthologiste Karl Von Frisch nous montrant qu’elles sont capables d’apprendre et d’indiquer par la danse les sources de nourriture à leurs congénères. Malgré un tout petit cerveau (un millimètre cube contenant 900 000 neurones, contre 100 milliards pour l’homme), elles sont capables d’élaborer des concepts abstraits et de faire preuve d’aptitudes cognitives remarquables. Domestiquées mais insoumises, elles symbolisent dans la mythologie, l’éloquence, la poésie, l’intelligence. La ruche fut un modèle politique, pour Platon, et l’industriel Godin, disciple de Charles Fourier, avait conçu son familistère comme une ruche, symbole d’un nouvel ordre social. Quant au philosophe hollandais Mandeville, il soutenait dans sa fable des abeilles, écrite en 1714, que le vice, entendu comme recherche de l’intérêt privé, était la condition de la prospérité. Credo repris depuis par des générations d’économistes libéraux. Seule insecte capable de fabriquer sa nourriture dont l’homme exploite la production, la mouche du miel, comme l’appelait le botaniste Linné, est aussi un pollinisateur qui collabore pour près d’un tiers à l’alimentation de l’humanité, soit, selon l’INRA, une contribution annuelle de 153 milliards de dollars à notre PIB mondial. Alors leur déclin (20 à 30 % de surmortalité) dû à la fois au dérèglement climatique, aux parasites, à l’érosion des espaces naturels et aux pesticides, ne doit pas laisser indifférent la ruche humaine. L’un de mes amis, apiculteur passionné et bon connaisseur des sociétés humaines (car longtemps cadre infirmier dans un hôpital psychiatrique) me confiait : « Ce que j’aime chez l’abeille, c’est qu’elle est un animal rationnel et pragmatique, ce qui n’est pas le cas de l’homme ! ».
De scrutin en scrutin
J’habite la France périphérique, celle des territoires pauvres et dépeuplés. Bien que située à une heure de la capitale, ma région paraît si lointaine culturellement et sociologiquement de Paris. Si, dans la capitale, l’on a voté à 90 % en faveur d’Emmanuel Macron, l’Aisne est le département qui a le plus voté (53 %) pour la candidate du Front National. Le score de cette dernière atteint 70 % dans mon village, dont on disait, il y a trois décennies, qu’il votait à peu près comme la France. Et ce n’est pas l’exception. Quand je croise trois personnes, je me dis que, statistiquement, au moins deux ont voté Marine Le Pen. Que s’est-il donc passé ? La crainte de l’immigré ? Il y en a si peu !, à l’exception de notre curé béninois, mais plutôt bien vu par la population. Il faut rechercher les causes de ce vote dans le déracinement social d’une région plutôt prospère au début des trente glorieuses. Depuis l’emploi agricole a chuté considérablement et les industries ont en grande partie disparu. Déjà, dans les années 1980, cette paupérisation était en marche. A l’époque, Le Point qui publiait régulièrement le classement des départements en fonction du bien-être de la population, mêlant temps d’ensoleillement, pourcentage de bacheliers et nombre de lits d’hôpitaux par milliers d’habitants parmi de nombreux autres critères, plaçait les départements picards en queue de peloton. Les lacunes dans la formation étaient déjà pointées du doigt. Je me souviens avoir entendu bien des jeunes dire : ah quoi bon continuer l’école pour travailler à la ferme ou à l’usine ! Propos largement acquiescés par les adultes. Depuis la situation ne s’est guère améliorée. Les gens les mieux formés sont partis et ceux qui sont en galère se retrouvent autour de l’abribus, où il n’y a quasiment plus de bus qui passent. Difficile de répondre aux arguments de ces gens déclassés, sans espoir ! C’est pourtant la tâche, ô combien complexe, qu’aura à mener le nouveau Président de la République et son gouvernement.
Dans l’intimité des arbres
De Virgile à Giono, en passant par Rousseau, Goethe, Hugo, Chateaubriand et bien d’autres, poètes et écrivains ont su mettre des mots pour dire la majesté et l’élégance des arbres, et exprimer ces rêveries, sensations et émotions, que tout promeneur, amoureux des forêts et des arbres, éprouve. Dans un style différent et avec le regard du scientifique, Peter Wohlleben, forestier allemand, qui dirige une forêt écologique, nous émerveille tout autant dans son livre La vie secrète des arbres, best-seller outre-Rhin. Après la lecture de ce livre, on ne regarde plus les arbres de la même manière. Cette plongée dans un univers fascinant nous fait découvrir des arbres ingénieux et inventifs, capables de communiquer en émettant des odeurs ou de transmettre des informations par leurs imposants tissus racinaires, comme l’imminence d’une attaque d’insectes. Des arbres obéissant à un code de bonne conduite, respectant les plus faibles, partageant l’eau, la nourriture avec leurs congénères, malgré la vive concurrence dans l’accès à la lumière ou à l’eau. « Les arbres compensent mutuellement leurs faiblesses et leurs forces », écrit Peter Wohlleben.
Ce livre est aussi un éloge du temps long et de la biodiversité (une centaine d’espèces différentes sont associées aux racines du chêne), dont pourrait s’inspirer l’agriculture du futur. Il appelle à considérer la forêt autrement que comme un lieu de production de bois et donc à mieux la respecter. « Nous devons veiller à ne pas puiser dans l’écosystème forestier au-delà du nécessaire et nous devons traiter les arbres comme nous traitons les animaux en leur évitant des souffrances inutiles », écrit l’auteur qui ajoute : « Les forêts ressemblent à des communautés humaines ». Et, par bien des aspects, nous avons beaucoup à apprendre des arbres. Bernard de Clairvaux ne disait-il pas : « Tu trouveras bien plus dans les forêts que dans les livres. Les arbres et les pierres t’enseigneront ce qu’aucun maître ne te dira. »
La vie secrète des plantes – Peter Wohlleben – Les arênes – 260 pages – 20,90 €.
Le meilleur des mondes !
Dans la perspective des sept heures à passer dans le train qui me ramène de Pau à mon village des Hauts de France, je me suis procuré le hors-série du Monde et de La Vie sur L’histoire de l’homme, une aventure de 7 millions d’années, et après ?, ainsi que le livre de Marc Dugain et Christophe Labbé L’homme nu qui nous met en garde contre la dictature invisible du numérique. Ces deux publications nous interrogent sur les menaces d’un futur digital, mêlant ces géants du numérique et l’appareil de renseignement américain. Ces gourous de l’Internet prennent nos gènes pour un programme informatique, veulent reformater l’Humanité et l’Homme (avec comme perspective le transhumanisme et l’immortalité !), pensent que « le cerveau humain est un ordinateur obsolète qui a besoin d’un processeur plus rapide et d’une mémoire plus étendue », considèrent la vie privée comme une anomalie, préparent des hommes sans mémoire, programmés et sous surveillance (pour notre bien et notre sécurité !) et constatent que si les Etats-Unis était la nation dominante d’hier, Google sera la puissance dominante de demain… A ce sujet, le gouvernement danois a récemment annoncé son intention de nommer un ambassadeur auprès des GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon). Ces quatre entreprises dépassent largement le PIB du royaume scandinave. Une première que cette reconnaissance du statut d’Etat à des entreprises sans territoires qui défient les Etats et échappent bien souvent à l’impôt via les paradis fiscaux ! Dans le train, je pense alors à ce séjour au village alternatif d’Emmaüs Lescar Pau et à sa ferme qui vise l’autosuffisance alimentaire de la communauté composée d’environ 150 membres. Ce village fait cohabiter plutôt harmonieusement des personnes rejetées par la société et d’autres qui, par engagement, rejettent cette même société. Je me dis alors que je préfère cette société, malgré ses imperfections, à cette civilisation du big data nous menant tout droit sans qu’on en ait conscience à un machiavélique meilleur des mondes ! Déjà en 1576, Etienne de La Boétie nous interpellait sur ces dangers dans son Discours sur la servitude volontaire.
La ferme des robots
Chaque année, la couverture du salon de l’agriculture par les médias nous montre deux facettes du monde agricole, avec ce contraste saisissant, entre d’un côté la réalité sociale, le mal-être paysan et de l’autre une agriculture de hautes technologies qui fait parfois rêver. Robotique et intelligence artificielle, capteurs et puces, habilement vendus par les services marketing des constructeurs suscitent l’enthousiasme, à la fois envoûtant et parfois béat, car l’on peut s’interroger sur les bénéfices escomptés d’investissements souvent très lourds dans un secteur où les marges sont si faibles. Et puis qu’en est-il de l’autonomie de l’agriculteur dans ses choix agronomiques, obéissant à des algorithmes et des logiciels qui imposent modèles et produits. Exit le sixième sens de l’éleveur et le tour de plaine du cultivateur, désormais les yeux rivés sur leurs écrans digitaux et en alerte presque 24 heures sur 24.
Et si les robots non seulement remplaçaient les hommes mais prenaient le pouvoir à la manière dont George Orwell faisait prendre le pouvoir par des animaux dans son livre La ferme des animaux. Dans cet ouvrage publié en 1945, qui se voulait une satire de la révolution bolchevique, un vieux cochon, Sage l’Ancien, incite les animaux de la ferme à la révolte contre leurs maîtres, ces animaux à deux pattes que sont les humains. Ils se révoltent, chassent les hommes de la ferme, prennent le pouvoir dans l’espoir d’une vie meilleure. Mais très vite, leurs idéaux sont dévoyés. Les cochons tombent dans le culte de la personnalité, instaurent une dictature, mettent leurs congénères en état de soumission, exécutent les traîtres… Les nouveaux maîtres ne sont pas mieux que les anciens…
S’il était encore des nôtres, George Orwell, l’inventeur de Big Brother, – dont, soit dit en passant son best-seller 1984, publié en 1948, est, depuis l’élection de Donald Trump, en tête des ventes aux Etats-Unis -, remplacerait sans doute les animaux par des robots, comme pour nous ramener devant cet emballement technologique à cette question essentielle : et l’homme dans tout cela !
Autour de l’idée de revenu universel
Le concept de revenu universel, permettant de protéger contre les aléas de la vie en offrant aux personnes défavorisées la protection d’un revenu de base, a marqué les débats de la primaire socialiste. Cette idée qui traverse les clivages idéologiques, n’est pas nouvelle : de Thomas More, qui imaginait à l’époque de la Renaissance, dans L’Utopie, une île où chacun disposerait des moyens de subsistance sans dépendre de son travail, à l’économiste libéral Milton Friedman qui défendait l’idée d’un revenu de base en jouant sur l’impôt, en passant par Martin Luther King et Bertrand Russel… Dans les temps plus anciens cette idée fut souvent liée à la répartition de la terre et de ses fruits. Sous l’Empire romain, le service de l’annonce permettait aux seuls citoyens romains de recevoir gratuitement le blé et le vin nécessaires pour leur subsistance. En 1797, Thomas Paine, un intellectuel britannique qui considérait que la terre, bien indivis donné aux hommes, avait été « accaparée » par les grands propriétaires, proposait que ces derniers versent une redevance à tous ceux qui ne bénéficiaient pas de cet héritage naturel. Quant à Napoléon III, il proposait dans un livre publié en 1844 L’extinction du paupérisme, que l’Etat rachète les terres en friche pour les allouer aux pauvres.
Dans des situations difficiles que connaissent aujourd’hui bon nombre d’agriculteurs, – un tiers des producteurs laitiers toucheraient moins de 350 € par mois -, l’idée d’un revenu de base permettrait d’envisager l’avenir de façon moins traumatisante. De même pour les commerçants en milieu rural qui jouent parfois un rôle de service public. Reste à régler l’épineuse question du financement ! Dans un monde où les inégalités ne cessent de grandir, – en France, selon Oxfam, les 21 personnes les plus riches possèderaient autant que les 40 % les plus pauvres de la population -, le débat mérite d’être engagé.
Le verre à moitié plein !
Alep et Mossoul, le 14 juillet à Nice et le marché de Noël de Berlin, la Turquie d’Erdogan et ses dérives, l’Amérique de Trump et la Russie de Poutine qui inquiètent, l’Europe en panne, engourdie et frileuse, repliée sur elle-même… Le temps du Nouvel An est l’occasion de tirer des bilans. Et 2016 nous laisse cette impression d’un monde d’une violence extrême beaucoup plus radicale qu’auparavant. Et pourtant !
Invité de la matinale de France Inter avant Noël, l’astrophysicien Hubert Reeves rappelait que sous l’Empire romain, la probabilité de mourir de façon violente était cinquante fois plus élevée qu’aujourd’hui. Le philosophe Michel Serres dans son dernier livre Darwin, Bonaparte et la Samaritaine, une philosophie de l’histoire dit à peu près la même chose. Pour Michel Serres, nous sommes sortis de ce temps de guerre perpétuelle. Le philosophe estime qu’entre le deuxième millénaire avant Jésus-Christ et Hiroshima, les temps de paix ont été rares : 9 %, alors que depuis, en un demi-siècle, nous avons gagné vingt ans d’espérance de vie. Michel Serres comme Hubert Reeves, tous deux nés avant la Seconde guerre mondiale, ont vécu le temps ancien, où le rapport à la mort, le rapport à la violence a changé. Aujourd’hui nous vivons dans l’instant présent, sans regard sur le tragique de l’Histoire. Songeons que la journée la plus terrible durant la Première guerre mondiale a vu mourir 28 000 de nos poilus !
Chaque mort est une tragédie et chaque mort violente l’est encore plus, mais osons le regard sur le passé comme nous y invitent Michel Serres et Hubert Reeves. Dans la masse des mauvaises nouvelles qui nous assaillent chaque jour, c’est une petite dose d’espérance. « J’ai une âme sculptée par la vie et par la paix », répète volontiers Michel Serres. C’est ce que je souhaite à chacun pour 2017.
La revanche des territoires
Dans ce contexte de mondialisation, où le global l’emporte sur le local et où les réseaux ont pris l’ascendant sur les liens de proximité, différents scrutins, à contre-courant de ces évolutions, montrent l’importance des fractures territoriales. Ce fut notamment le cas du Brexit, avec Londres et sa City, très favorables au maintien du Royaume-Uni dans l’Union européenne face aux villes désindustrialisées et aux zones rurales très Brexit. Lors de la présidentielle américaine, Donald Trump a construit sa victoire dans les Etats ruraux et désindustrialisés alors qu’Hillary Clinton dominait son adversaire dans les métropoles des côtes Ouest et Est. Ce constat, on le retrouve, dans une moindre mesure, dans la primaire de la droite et du centre où le succès de François Fillon, archétype de la France provinciale, (même s’il est député de Paris !), apparaît comme l’antidote de l’esprit « bobo » des grandes métropoles. Jamais donc les fractures territoriales n’ont été aussi fortes qu’aujourd’hui, même si le phénomène n’est pas nouveau.
Depuis le Moyen-Age, les villes ont pris l’ascendant sur les campagnes. Depuis les Lumières, la science a privilégié les lois universelles aux adaptations locales. Depuis la fin des trente glorieuses, la politique d’aménagement du territoire a été négligée. Aujourd’hui, les grandes métropoles sont les seules à tirer leur épingle du jeu, alors que les inégalités se creusent avec le reste du territoire. Inégalités renforcées par la crise des finances publiques qui a mis à mal les mécanismes de compensation en faveur des territoires les plus fragiles.
Les fractures sociales qui avaient dominé les joutes électorales passées deviennent donc de plus en plus des fractures territoriales. L’enjeu d’harmoniser mieux nos territoires devient essentiel, même si les choix effectués par les électeurs n’apportent pas vraiment de réponses, si ce n’est celui d’un libéralisme un peu plus débridé, qui, au contraire, risque d’accentuer encore ces fractures territoriales et sociales.
Nous sommes tous wallons !
Que la Wallonie, comparée ces derniers jours à un village gaulois, ait été en pointe dans la contestation de certaines règles du CETA (1) n’a rien de surprenant. Les Wallons sont aussi gaulois que nous ! La Gaule Belgique qui s’étendait des Ardennes à la Mer du Nord avec comme capitale Reims a combattu aussi ardemment les légions romaines que les autres Gaules.
« Ce n’est pas parce qu’on est seul qu’on a forcément tort », déclarait, en bon gaulois, le président du parlement wallon, Paul Magnette, politologue réputé, et tout sauf un altermondialiste. Méprisé par les grands pontes de l’Europe, le parlement wallon avait depuis un an mis en garde la Commission sur certains points du traité qui posaient problème, comme le tribunal arbitral, juridiction privée, qui permet à une entreprise de réclamer aux Etats européens des compensations financières en cas d’enfreintes aux règles du CETA, ou les menaces contre certaines activités (la viande bovine) ou certaines normes sociales et environnementales. Le plus grave dans cette affaire est que les Wallons aient été les seuls. Pendant ce temps notre premier ministre, comme beaucoup d’hommes politiques, défendait béatement le côté gagnant/gagnant de l’accord, alors que l’on sait que, dans ce type de traité, il y a certes des gagnants mais aussi des perdants. Même si l’accord est globalement gagnant pour l’Europe, ceux qui en profiteront seront bien moins nombreux que ceux qui risquent d’en subir les inconvénients. Car la mondialisation n’est pas heureuse pour tout le monde. Selon certains experts, si un tiers de la population française profite pleinement du libre-échange, les deux autres tiers sont plus ou moins « largués » ou victimes dans cette course à la mondialisation. Et ces accords commerciaux négociés dans l’opacité la plus totale ne font qu’exacerber les craintes exprimées par des opinions publiques, malheureusement tentées par le repli sur soi, le nationalisme et le vote extrémiste.
1 : CETA : accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Canada dimanche dernier
L’entrecôte 2.0
Impensable il y a encore quelques années, la vente de viande en ligne connaît une progression constante même si elle représente une part marginale du commerce de viandes. Toujours est-il que la semaine dernière, le journal Le Parisien titrait sur le boom de la viande en ligne, citant l’exemple de la plate-forme Okadran, qui aurait comptabilisé 15 000 € de commandes depuis sa création, il y a trois semaines. Son fondateur la définit comme « l’Airbnb de la viande »… Dans ce système, c’est le producteur qui fixe le prix, la plateforme s’adjugeant 10 à 16 % de commission. Derrière ce relatif engouement, faut-il voir l’attrait pour les circuits courts dans une filière d’une grande complexité et d’une grande opacité sur les marges des différents (et souvent nombreux) intermédiaires, avec comme seule certitude, le fait que beaucoup de producteurs ont bien du mal à dégager un revenu digne.
Avec la vente directe à la ferme, les AMAP ont été pionnières avec le triple souci de mieux rémunérer les agriculteurs, de rassurer les consommateurs et de réduire l’impact écologique. Fonctionnant sur le bénévolat, elles créent une relation directe entre le producteur et les consommateurs qui sont aussi des citoyens engagés. Ce qui n’est pas toujours le cas de ces plateformes, plus mercantiles, même si elles se réclament de l’économie sociale et solidaire. Ainsi, dans le collimateur des AMAP, La Ruche qui dit oui qui compte parmi ses actionnaires Xavier Niel, le patron de Free, et l’un des cofondateurs du site de rencontres Meetic, vend sur Internet des produits du terroir que l’acheteur en ligne récupère auprès de 650 ruches tenues généralement par des autoentrepreneurs. Les défenseurs des AMAP parlent d’ « ubérisation » de l’agriculture. Querelles de bobos ! lit-on dans la presse. Quant à moi, je préfère aller acheter la viande chez mon boucher, surtout s’il se fournit auprès de producteurs locaux…
Une école ferme…
L’historien du sensible, Alain Corbin, a montré, dans son livre Les Cloches de la terre, toute l’importance des cloches dans notre paysage sonore. De tout temps, la vie des villages a été rythmée par des sons. Ainsi dans mon village, le train de 7 h 20 nous prévient qu’il est temps de partir au boulot et les cris des écoliers pendant la récréation annoncent le milieu de la matinée. Ou du moins annonçaient… Car la ligne de chemin de fer vient de fermer, ainsi que l’école. S’il faut reconnaître que les voyageurs du train se comptaient sur les doigts d’une main, l’école de Breny qui faisait partie d’un regroupement pédagogique avec deux communes voisines accueillait l’an passé dix-sept élèves. Le regroupement scolaire, qui désormais n’aura plus qu’une seule école, en attendant sans doute sa fermeture dès l’an prochain, existait depuis les années 1970. A l’époque, il fallait regrouper pour mettre fin aux classes uniques (regroupant des élèves de plusieurs cours). Des études montrèrent par la suite que les résultats pédagogiques n’étaient pas plus mauvais (voire meilleurs) que dans les classes à un seul cours.
La fermeture d’une école est toujours un traumatisme pour tout le monde. La vie d’une école est par tradition l’affaire de tous, en établissant des liens de coopération entre les instituteurs, les parents, les élèves, la mairie, les associations… D’autant plus dans des communes où la vie associative est quasi-inexistante. L’école est alors le dernier lieu du lien social pour des habitants qui, souvent, travaillent à l’extérieur. Mais qui s’en soucie dans une urbanité galopante où le monde rural devient si marginal, notamment parmi les élites, qu’au moment du tragique assassinat du Père Jacques Hamel à Saint-Etienne-du-Rouvray, certains médias audiovisuels utilisèrent la qualificatif de village pour évoquer une ville qui compte tout de même 28 000 habitants !, soit autant que notre chef-lieu de département, Laon !
La démocratie aux champs !
De Marx à Balzac, bien des intellectuels, et encore aujourd’hui, considèrent les paysans comme des arriérés, des réactionnaires, rétifs aux Droits de l’Homme. Dans son livre La démocratie aux champs (1) Joëlle Zask, philosophe, va à contre-courant de ces clichés. « Cet essai, écrit-elle, a pour ambition de montrer que ce qui est progressivement devenu notre idéal de liberté démocratique ne vient en priorité ni de l’usine ni des Lumières ni du commerce, de la ville ou du cosmopolitisme, mais de la ferme ». L’auteure s’appuie sur de nombreux exemples : du Jardin d’Eden aux AMAP, en passant par la naissance de la démocratie américaine. Ainsi Thomas Jefferson, troisième président des Etats-Unis, considérait que la base sociale de la démocratie était formée par les paysans indépendants et la ferme comme une « petite république ».
Dès le Moyen-Age, les paysans ont su s’organiser pour s’entraider et, à la fin du XIXème siècle, ils ont adhéré aux valeurs du mutualisme et de la coopération. Ils ont tenté (souvent sans succès) de s’opposer à l’arbitraire des gouvernements : de la lutte contre les enclosures au Royaume Uni aux combats des paysans sans terre au Brésil, en passant par ces ouvriers kolkhoziens qui, sous Staline, produisaient sur leurs modestes lopins de terre (3 % des surfaces) le tiers de la production agricole de l’Union soviétique.
Pour Joëlle Zask, cultiver la terre c’est établir un équilibre : l’assister mais ne pas la forcer, c’est dialoguer avec la nature, être attentif, calculer, anticiper, coopérer, partager…, bref apprendre la démocratie. L’auteure considère le jardinage comme une forme d’éducation par l’expérience favorisant les pratiques de la citoyenneté et cite de nombreux exemples : des jardins ouvriers aux jardins partagés, des jardins de réinsertion sociale aux jardins thérapeutiques en passant par le développement de l’agriculture urbaine. Voltaire ne nous conseillait-il pas de « cultiver notre jardin ! »
(1) La démocratie aux champs – Joëlle Zask – Les empêcheurs de penser en rond/ La Découverte – 18,50 € – 2016
Brexit, suite…
Au lendemain de la victoire des partisans du Brexit, leurs leaders, particulièrement discrets ces derniers jours, ne semblent guère faire preuve d’ardeur pour s’engager dans la voie de la rupture avec le Vieux Continent. Après une campagne plutôt nauséabonde, faite d’arguments fallacieux, de chiffrages mensongers (de part et d’autre), de mise en avant du thème de l’immigration, les partisans du Brexit ne semblaient pas croire en leur victoire, tant leur impréparation saute aujourd’hui aux yeux. Ils ont joué avec le feu, remettant en cause, dès le lendemain du vote, certaines promesses électorales, notamment le transfert de la contribution britannique à l’Europe vers les budgets sociaux, et n’anticipant pas les conséquences quant à une éventuelle dislocation du Royaume-Uni où se mêlent oppositions non seulement territoriales mais aussi générationnelles sans parler des fractures politiques au sein même des partis… Tout cela pour des postures politiciennes et des intérêts électoraux à court terme ! La note pourrait être salée pour les Britanniques.
Dès le départ, David Cameron, avait joué avec le feu en proposant ce référendum pour gagner les élections générales. Sans doute, avait-il évité un revers électoral, mais c’était pour mieux « sauter » deux ans plus tard ! La tactique de son probable successeur, Boris Johnson, consistant à se démarquer de lui, pour prendre sa place, n’est pas plus glorieuse. Tout cela ne grandit guère l’idée de Démocratie, le moins mauvais des systèmes, selon leur illustre prédécesseur, Churchill, à côté de qui ces dirigeants actuels font pâle figure. Mais nous n’avons guère de leçons à donner aux Britanniques quand on voit les leaders écologistes français remettre en cause la consultation sur l’aéroport de Notre Dame des Landes. Ce qui ne traduit guère un sens exacerbé du respect des règles de la démocratie !
Edgard Pisani, le visionnaire
Parmi les fortes personnalités qui, de Jean-Baptiste Doumeng à René Dumont, de Sicco Mansholt à Michel Debatisse, ont marqué l’histoire de l’agriculture de la seconde moitié du XXème siècle, Edgard Pisani était le dernier survivant. Avec son décès, une page se tourne.
Visionnaire hors pair, grand serviteur de l’Etat, éveilleur de consciences, habile négociateur, esprit indépendant aux idées parfois radicales… tels sont les commentaires qui reviennent le plus souvent parmi la pléiade d’hommages rendus à cet homme politique atypique, dont la haute silhouette et les propos tranchants et parfois cassants en imposaient.
Né en 1918 à Tunis, Edgard Pisani entre dans l’histoire lors de la libération de Paris, en contribuant à libérer la préfecture de police. Michel Piccoli jouera son rôle dans le film Paris brûle-t-il ? Il est nommé à 26 ans sous-préfet de Haute Loire puis de Haute Marne, département dont il sera en 1954 le sénateur. C’est aussi le département du général de Gaulle. Ce dernier lui proposera en 1961 de devenir son ministre de l’Agriculture. Durant plus de cinq ans, – le record de longévité sous la Vème République à ce poste -, il va mettre en place les lois d’orientation agricole, qui vont profondément transformer le paysage agricole français, et piloter les débuts de la PAC. Face aux caciques de la FNSEA, peu portés sur les réformes gaullistes, il s’appuie sur la jeune génération des syndicalistes emmenée par Michel Debatisse. « Les plus grandes joies, confiera-t-il, que je retire de mon séjour rue de Varenne me viennent de mes relations avec les jeunes agriculteurs tous issus de la JAC. »
Plus gaullien que gaulliste, il quitte en 1967 le gouvernement, en désaccord avec Georges Pompidou, puis se rapproche en 1974 du Parti socialiste. En 1981, François Mitterrand le nomme commissaire européen au Développement. En 1984, il devient Haut-Commissaire chargé du sensible dossier de la Nouvelle Calédonie, au bord de la guerre civile. Il tente d’apaiser les tensions, amorce la négociation en faveur d’un rééquilibrage économique entre communautés caldoche et kanak, préparant ainsi le terrain aux accords que signera Michel Rocard en 1988. Dans les années 1990, il mettra ses talents de négociateur au service d’une médiation entre les Touaregs et le gouvernement de Bamako.
Par la suite, Edgard Pisani deviendra une sorte d’éveilleur de consciences, alimentant le débat sur un projet politique à réinventer. Du développement de l’Afrique à la dénonciation de la professionnalisation de la communication politique, en passant par la nécessaire évolution des institutions, l’Europe ou les problèmes d’éducation, cet iconoclaste suscitait le débat d’idées. A propos de l’Europe, il écrit dans son dernier livre Croire pour vivre, compilation de ses méditations politiques, comme pour anticiper le Brexit : « L’Europe a été pensée, elle est pensée sur des schémas périmés. Ni fédération, c’est trop ; ni confédération, ce n’est pas assez. Il faut inventer autre chose. » Il se passionnait toujours pour la question agricole et avait publié en 2004 Le vieil homme et la terre, livre dans lequel il exprimait une vision plutôt pessimiste de l’avenir : « Ce qui se passe, aujourd’hui, m’inspire plus d’inquiétude que d’espoir. A force de vouloir forcer la terre, nous prenons, en effet, le risque de la voir se dérober. A vouloir le marché, nous faisons fi du besoin que tous les peuples ont de vivre à leur manière du travail de leurs terres. A industrialiser le travail agricole, nous chassons des paysans dont les villes et les usines ne savent que faire. »
Trop c’est trop…
En 2014, l’écrivain Jean-Louis Fournier pointait du doigt non sans humour dans un magnifique petit livre Trop les travers de notre société de consommation. Trop de tout, de quoi nous donner le tournis, mais aussi trop de déchets en aval. La semaine dernière l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), chiffrait notre gaspillage alimentaire à 108 € par personne et par an, 16 milliards d’euros pour la France, soit l’équivalent de 20 milliards de repas (à titre de comparaison les restos du cœur en ont distribué l’an passé 130 millions). A tous les stades, on gaspille : à la production 32 % des dix millions de tonnes de nourriture parties à la poubelle, à la transformation (21 %), à la distribution (14 %) et à la consommation (33%). Bref nous sommes tous responsables et tous coupables.
Les chiffres au niveau mondial sont encore plus sidérants. Selon les Nations Unies, un tiers de la production agricole, soit 1,3 milliard de tonnes de nourriture, est gaspillé. C’est en tonnage deux fois la production mondiale de blé et trois fois celle de riz. En diminuant même de peu ce gaspillage, on pourrait nourrir plus que convenablement les 900 millions d’habitants de la Terre qui ne mangent pas à leur faim. Pour la plupart, paradoxalement, des travailleurs de la terre !
Le gaspillage se situe aussi en amont. Que de travail fourni, que d’énergie consommée, que de CO2 rejeté, que d’eau utilisée… pour rien ! Jeter 100 grammes de viande, c’est gâché les 1 300 ou 1 500 litres d’eau dont a besoin l’animal jusqu’à notre assiette, soit la consommation domestique quotidienne d’une famille de cinq personnes. Une baguette de pain à la poubelle, ce sont 250 litres qu’on laisse filer. « Ce qui me scandalise, a dit un jour Mère Teresa, ce n’est pas qu’il y ait des riches et des pauvres : c’est le gaspillage. »
Le TAFTA (1) en panne !
La négociation pour constituer un grand marché commun nord-atlantique de 820 millions de consommateurs a du plomb dans l’aile. La récente visite à Hanovre de Barack Obama, qui espère bien conclure la négociation avant la fin de son mandat en janvier 2017, et le soutien d’Angela Merkel à ce traité n’y changeront rien. Paradoxalement, c’est l’opinion publique allemande qui est la plus en pointe contre ce traité. Une pétition a recueilli 3,5 millions de signatures et seuls 17 % des Allemands soutiennent le projet (ils étaient 55 % en 2014). Même évolution aux Etats-Unis où seuls 15 % des Américains pensent que cette négociation est une bonne chose. Plus surprenante, la France contestataire, souvent en pointe dans la contestation altermondialiste, apparaît en retrait, occupée, il est vrai, qu’elle est avec la loi El Khomri. Pourtant la France a plus à perdre qu’à gagner, notamment sur l’épineux dossier agricole, qui pourrait mettre en cause les Indications géographiques protégées et en péril un secteur de l’élevage déjà mal en point. Selon l’hebdomadaire Marianne (2), un document publié fin décembre par le ministère américain de l’Agriculture montre que l’agriculture américaine serait la grande bénéficiaire avec plus de 10 milliards d’euros contre seulement 2 milliards pour l’européenne.
Des deux côtés de l’Atlantique, « la mondialisation heureuse » chère à Alain Minc n’est plus ce qu’elle était. Après l’échec du cycle Doha à l’OMC et aujourd’hui l’impasse de la négociation transatlantique, les vents semblent avoir tourné. Comme en témoigne l’attitude de François Hollande, qui, en 2014, pensait qu’il fallait aller vite sur ce projet, et se dit aujourd’hui prêt à utiliser son véto, comme l’avaient fait en 1962 le général de Gaulle, en disant non au projet de partenariat transatlantique proposé par Kennedy, et, en 1998, Lionel Jospin en enterrant l’Accord Multilatéral sur l’Investissement (AMI).
1 : Partenariat transatlantique du Commerce et de l’Investissement
2 : Marianne numéro du 15 avril 2016
Casse-tête
Je vous écris des « Hauts de France », nouvelle appellation du Nord-Pas-de-Calais-Picardie, préférée à « Terres du Nord » et « Nord de la France », où ne figurent ni le Nord, ni la Picardie pour ne froisser personne, dans cette région aux équilibres (ou aux déséquilibres) si fragiles : deux tiers de la population et un tiers du territoire ainsi que la capitale pour le Nord, un tiers de la population et deux tiers du territoire ainsi que le président pour la Picardie. Je le conçois, le Nord n’attire guère, comme nous le firent comprendre nos amis bretons qui rebaptisèrent les Côtes du Nord en Côtes d’Armor. C’était, il est vrai, bien avant le succès du film Bienvenue chez les Chtis aveccette fameuse séquence de Michel Galabru, « Le Nooord… il y fait – 40°… »
Après tout, si l’on avait voulu faire un peu plus « fun », comme l’on dit aujourd’hui, « Pays des Chtis » n’aurait pas été si mal. D’autant que la langue chti n’est qu’un patois de la langue picarde. Cela n’aurait donc guère froissé les Picards. A la nuance près que des trois départements qui constituaient la Picardie, seule la Somme a une véritable identité picarde. Surtout ne dites pas à un producteur de Champagne de Château-Thierry (le bas de l’Aisne) qu’il est picard, il tombe en syncope. Alors nordiste !, je ne vous dis pas.
A mon goût, Hauts de France fait un peu prétentieux ! A l’oreille, Hauts de France devient vite Eaux de France. Enfin le qualificatif haut, qui désigne le relief plus que la position géographique, n’est guère adapté à l’un des territoires les plus proches du niveau de la mer, et qui n’a rien à envier au plat pays d’outre-Quiévrain. Avec comme seuls horizons, comme le chanterait Brel, les terrils, les beffrois et les flèches des cathédrales gothiques dont cette montagne couronnée de Laon qui surplombe les grandes plaines du Nord-Est et ne rencontrent guère de véritables reliefs avant la Biélorussie… Enfin, dernière inquiétude : comment vous, habitants des « Terres du Milieu » ou du « Bas de la France », allez-vous nous appeler : les « Hautistes », les « Hautains » ou les « Hauteurs » ? Tout cela n’est guère flatteur !
70 ans qui ont bouleversé la planète agricole…
Porter un regard sur les sept dernières décennies, c’est constater la vertigineuse accélération de l’histoire. En effet le monde a plus changé, au cours des 70 dernières années que depuis l’Antiquité. Il a changé en mal, de l’horreur nazie jusqu’au terrorisme de Daech en passant par le Goulag soviétique… comme en bien, de la conquête de l’espace aux découvertes médicales avec l’allongement de la durée de vie en passant par l’amélioration de la condition féminine… Le regard du passé semble encore plus vertigineux lorsque l’on observe le grand chambardement de la France rurale. Le sociologue Henri Mendras écrivait que le paysan de 1940 vivait comme celui d’Hésiode.
Ainsi donc en à peine trois générations l’agriculture a connu une transformation plus considérable qu’entre la naissance de l’agriculture, il y a dix millénaires dans le Croissant fertile, et la Seconde Guerre mondiale. Bouleversement démographique d’abord : on est passé de plus de quatre millions d’actifs dans l’agriculture à moins de 500 000 aujourd’hui. Bouleversement sociologique : on est passé d’un monde encore majoritairement rural à un monde urbanisé, dans l’espace comme dans les esprits. Bouleversements technologiques : une vache qui donnait 1 200 litres par lactation au lendemain de la guerre en produit aujourd’hui huit fois plus, tandis que, des années 1960 aux années 1990, le rendement en blé augmentait d’un quintal par an ! Bouleversement professionnel, on est passé de l’état de paysan au métier d’agriculteur, de l’exploitation familiale à des structures juridiques nouvelles.
Pourtant au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la France est meurtrie, traumatisée par la débâcle de 1940. Elle est nettement en retard par rapport aux pays voisins. Malgré le plan Marshall et l’arrivée de tracteurs américains, la mutation est lente et la production en panne. A la fin des années 1940, la France importe près de la moitié de ses besoins en blé des Etats-Unis. Et les tickets de rationnement perdureront jusqu’en 1949. Le tracteur, symbole de la modernisation, a du mal à s’imposer, même si, au sein du Commissariat au Plan dirigé par Jean Monnet, l’agronome René Dumont fait placer le machinisme agricole parmi les priorités de la nation.
Dès les années 1960, tout s’accélère, avec l’avènement de la Cinquième République et la construction européenne. L’objectif des nouveaux gouvernants est de moderniser l’agriculture pour développer l’industrie. Le Premier ministre, Michel Debré, et le ministre de l’Agriculture, Edgard Pisani, s’appuient sur les jeunes agriculteurs, formés par la JAC et font voter les lois d’orientation de 1960 et 1962 qui vont moderniser l’agriculture pour une génération, et permettre l’installation de jeunes agriculteurs sur des exploitations considérées comme viables. C’est la fin des paysans et l’accélération de l’exode rural, que chante Jean Ferrat avec La Montagne. Dans ce contexte la France impose sa vision à l’ensemble de ses partenaires, avec le soutien de Sicco Mansholt, le Commissaire européen à l’Agriculture, dans la construction de la PAC qui sera durant deux décennies la seule politique sectorielle véritablement intégrée.
L’heure est donc au productivisme. Les pouvoirs publics comme la société demandent aux paysans français de nourrir le pays à bas prix. Ce qu’ils feront presque trop bien ! Groupes de vulgarisation, Centres d’études techniques agricoles, développement de l’enseignement agricole contribuent à la formation des nouvelles générations d’agriculteurs qui se heurtent souvent à leur père. Les engrais, la sélection variétale des semences, la mécanisation, le développement de l’insémination artificielle, la génétique animale, la création de CUMA… contribuent au succès de l’agriculture française, qui, très vite, rattrape son retard et s’impose comme la principale agriculture des Six qui constituent alors la Communauté économique européenne. Les agriculteurs sont les Japonais de l’économie française, écrit alors l’économiste Michel Albert. Les céréales françaises dament parfois le pion aux céréales américaines sur les marchés mondiaux et Jean-Baptiste Doumeng fait fortune dans le commerce agro-alimentaire avec les pays de l’Est.
Mais très vite la machine s’emballe. Les excédents grèvent le budget européen, en particulier le lait, dont la production sera contingentée, et les céréales, dont les prix de soutien vont diminuer. Les crises monétaires remettent en cause l’unité des prix au niveau européen, avec l’instauration des fameux montants compensatoires monétaires. Les chocs pétroliers accroissent les charges. Le rapport de forces au sein des filières est bouleversé avec le poids accru des industries d’amont et d’aval, et surtout par la suite de la grande distribution dont le développement est soutenu par les pouvoirs publics pour lutter contre l’inflation. Dans les années qui suivent la grande distribution s’accaparera la plus grosse partie de la valeur ajoutée. Les trente glorieuses qui, en fait, n’auront été que vingt se terminent, amorçant une période de ruptures avec l’émergence de deux mouvements d’opinions qui vont transcender les partis politiques, l’écologie et le libéralisme économique.
Après mai 1968 et la remise en cause de la société de consommation, les mouvements écologistes font entendre leur voix. Un livre Le Printemps silencieux de Rachel Carson, best-seller mondial, témoigne des dégâts du DDT sur la faune. Plus tard l’affaire des veaux aux hormones suscite la méfiance des consommateurs. D’autant que les crises sanitaires se multiplient, jusqu’à l’épisode tragique de la vache folle. Côté économique, après les élections de Margareth Thatcher et Ronald Reagan, les monétaristes ont pris le dessus sur les keynésiens qui, jusqu’alors, avaient marqué les politiques économiques des pays occidentaux. C’est la fin de l’Etat-providence et de l’économie sociale de marché, qu’accentueront la chute du mur de Berlin et la dislocation de l’empire soviétique. L’économie financière s’impose à l’économie réelle. L’heure est à la dérégulation. La PAC n’y échappe pas. Les négociations du GATT puis de l’OMC imposent en 1992 à l’Europe qui s’élargit une réforme drastique, marquée par le gel d’une partie des terres. Premiers pas vers un « détricotage » de la PAC qui annonce la fin à terme de deux de ses piliers que sont le tarif douanier commun et les organisations communes de marché et ouvre la porte à une concurrence exacerbée entre producteurs des différents Etats-Membres.
Cette évolution suscite bien des inquiétudes. Alors que les nouvelles technologies du vivant pourraient encore concentrer un peu plus la production, l’on s’inquiète du devenir des territoires ruraux. Les services publics désertent de plus en plus les campagnes. En 1991, Raymond Lacombe sensibilise l’opinion publique en organisant avec succès le dimanche des terres de France qui rassemblera 300 000 ruraux venus de toutes les provinces sur le pavé parisien.
Car l’agriculture est plus que l’agriculture, comme le note Edgard Pisani dans Le vieil homme et la terre. Paradoxalement, alors que le nombre d’actifs ne cesse de baisser, que sa contribution au PIB s’effrite, l’agriculture se trouve plus que jamais au cœur des enjeux de société. Enjeux géopolitiques, économiques et sociaux avec la mondialisation, les défis Nord/Sud, la question de l’emploi, l’avenir de l’Europe, la financiarisation de l’agriculture qui se traduit par les dérives spéculatives sur les marchés mondiaux et l’accaparement des terres, notamment dans le tiers monde, alors que le nombre de paysans n’a jamais été aussi élevé dans le monde… Enjeux sanitaires avec la sécurité alimentaire. Enjeux territoriaux avec les déserts ruraux et la « métropolisation » du territoire… Enjeux technologiques et éthiques liés aux nouvelles technologies du vivant comme la transgénèse ou le clonage… Enjeux culturels avec la question des paysages, des terroirs, du bio et de la qualité gastronomique… Enjeux environnementaux, de la question de l’eau à la dégradation des sols, du réchauffement climatique à la protection de la biodiversité… Entre vaches folles et Dolly, malbouffe et gastronomie, grande distribution et circuits courts, comme les AMAP, productions intensives et agriculture biologique, mode de production familial et mode de production industriel, entre fonction nourricière et diversifications dans la production énergétique, la société s’interroge, les agriculteurs aussi.
Pour gérer la complexité et la diversité, autorités publiques et organisations professionnelles ne sont pas outillées, se contentant le plus souvent de gérer le quotidien et de communiquer face à une crise d’identité majeure qui se manifeste sous différents aspects, comme le refus de l’Europe. Après en avoir été les pionniers, les agriculteurs ont été la catégorie socioprofessionnelle qui a voté le plus contre la ratification des traités européens. Ou encore, le vote Front national qui ne cesse de croître au sein d’une population longtemps rétive aux idées d’extrême droite. Et, plus tragiquement, un taux de suicide des agriculteurs supérieur aux autres catégories socioprofessionnelles. Disparition du lien entre famille et exploitation, problèmes de transmission, grande diversité de situations, marginalisation des agriculteurs à la fois démographique, économique et social… contribuent à cette perte de repères. Plus anecdotique mais oh combien révélateur le développement (notamment dans les médias) du thème de l’agriculture urbaine témoigne de cette perte de repères. Il y a un siècle Alphonse Allais voulait mettre les villes à la campagne parce que l’air y était de meilleure qualité. Aujourd’hui l’agriculture urbaine se veut être un facteur le lien social dans les villes, tandis qu’à la campagne le lien social se délite.
Dans ce contexte complexe, aux logiques souvent contraires, saurons-nous gérer la diversité… ? D’autant que l’agriculture semble à contre-courant du monde d’aujourd’hui : une activité qui réclame du temps long dans un monde qui s’accélère de manière vertigineuse ; une activité sédentaire dans un monde qui se nomadise ; une activité ancrée dans les territoires au sein d’un monde globalisé fonctionnant en réseau ?
« Brexit », un mal pour un bien ?
« Brexit » ou pas ? Les électeurs britanniques en décideront le 23 juin prochain. Reconnaissons toutefois que, depuis leur adhésion à la Communauté européenne en 1972, les Britanniques ont toujours eu un pied dedans et un pied dehors. Après avoir combattu la construction européenne de l’extérieur en créant l’Association européenne de libre échange pour contrer le Marché commun, ils l’ont miné de l’intérieur, ne prenant que ce qui les arrangeait, ne cessant de quémander clauses d’exception et dérogations : depuis James Callaghan refusant d’intégrer le Système monétaire européen jusqu’au récent chantage de David Cameron, en passant par Margaret Thatcher obtenant le rabais de sa contribution au budget européen, John Major mettant son veto à la candidature à la présidence de la Commission de Jean-Luc Dehaene, ancien premier ministre belge, jugé trop fédéraliste, et Tony Blair, qui, sous des allures d’europhile, contribua au détricotage de la PAC.
N’appartenant ni à la zone euro, ni à la zone Schengen, n’ayant pas signé la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le Royaume Uni a toujours favorisé le processus d’élargissement pour éviter tout approfondissement. Au fond, les Britanniques ont fait de cette Union européenne une zone de libre-échange, pour les produits mais pas forcément pour les hommes, comme le montrent les récentes dérogations accordées à David Cameron à propos de la protection sociale des travailleurs venus de l’Est.
« Nous sommes du côté des Européens mais nous n’appartenons pas à l’Europe », avait prévenu, dès 1946, Churchill. De Gaulle, qui avait à deux reprises mis son veto à leur adhésion, l’avait bien compris. Alors un « Brexit » ne serait-il pas l’occasion pour les Européens (les Six des origines plus l’Espagne et le Portugal) d’une remise à plat d’une Europe en voie de décomposition, comme le montrent les actuels relents nationalistes face aux migrants ?